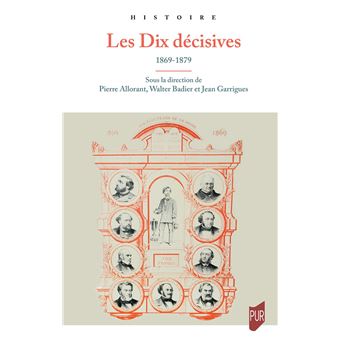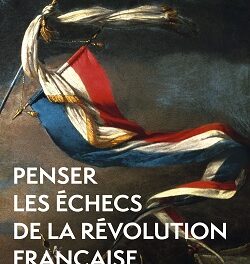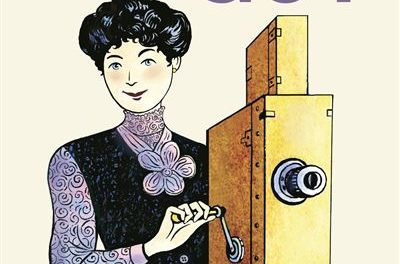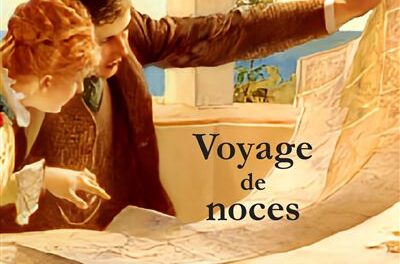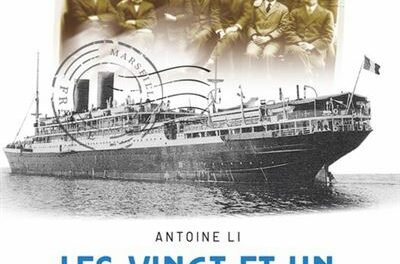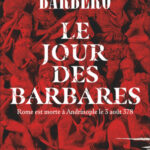L’ouvrage Les Dix décisives, publié sous la direction de Pierre Allorant, Walter Badier et Jean Garrigues, constitue l’une des dernières parutions des Presses Universitaires de Rennes, dans la collection « Histoire », en 2022.
Pierre Allorant, Walter Badier et Jean Garrigues : trois enseignants-chercheurs membres du CHPP (Comité d’Histoire Parlementaire et Politique)
Pierre Allorant (60 ans) est professeur d’histoire du droit et des institutions à l’université d’Orléans (membre affilié du laboratoire POLEN EA 4710, équipe CEPOC) ainsi que doyen de la faculté de droit d’Orléans, depuis novembre 2016. De plus, il est secrétaire général et membre du comité scientifique de la revue Parlement[s]. Revue d’histoire politique.
Walter Badier (43 ans) est maître de conférences en Histoire contemporaine à l’université d’Orléans (Laboratoire ÉRCAÉ – EA7493) au sein de l’INSPE Centre-Val de Loire. En juin 2020, il a été nommé directeur adjoint à l’INSPE (Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation) CVL, à Orléans. En outre, il est secrétaire général et membre du comité de rédaction de la revue Parlement[s]. Revue d’histoire politique, depuis 2007.
Jean Garrigues (62 ans), enfin, est professeur en Histoire contemporaine à l’université d’Orléans (laboratoire POLEN EA 4710-CEPOC). De plus, il est directeur de la publication de la revue scientifique Parlements[s], Revue d’histoire politique (depuis 2003), directeur des collections Cliopolis et Polen (depuis 2014), membre des conseils scientifiques des Rendez-vous de l’histoire (depuis 2006). De surcroît, il est également président du Comité d’histoire parlementaire et politique (CHPP) (depuis 2002). Enfin, il est consultant régulier sur Public-Sénat, LCP, France Inter, I>TV, LCI, La Cinq et BFM.TV.
Les Dix décisives (1869-1879) : le prolongement du colloque de septembre 2019
Cet ouvrage est la publication des actes du colloque intitulé « La décennie décisive : 1869-1879 », qui s’est déroulé du 2 au 4 septembre 2019, dans les locaux du Conseil d’État, situés dans le 1er arrondissement de Paris. Il s’agit d’un partenariat avec deux importants centres de recherche, le Comité d’histoire parlementaire et politique (CHPP) et le laboratoire POLEN-CEPOC (Pouvoirs, Lettres, Normes — Centres d’études politiques contemporaines) de l’université d’Orléans, eux-mêmes soutenus par le Sénat, le LabEx EHNE (Écrire une Histoire nouvelle de l’Europe), le Centre d’Études des Mondes Moderne et Contemporain (CEMMC) de l’université de Bordeaux et, enfin, le centre Maurice Hauriou pour la recherche en droit public de l’université Paris Descartes. Ensuite, plusieurs membres éminents du comité d’histoire du Conseil d’État et de la juridiction administrative, Éric Anceau, Jean-Pierre Machelon et Jean Massot, ont participé à ce colloque.
Cent cinquante ans après l’effondrement du Second Empire, de l’écrasement de la Commune de Paris et de la lente et incertaine conquête de la République, la décennie 1869-1879 mérite d’être revisitée. Le temps est venu d’offrir une synthèse renouvelée, prolongée d’une réflexion mémorielle sur les ressorts de l’établissement de « la plus longue des Républiques ». Quel est le moment décisif ? Sans doute celui durant lequel les choses se décident, où les acteurs sortent du provisoire, saisissent l’opportunité de l’instant de la décision. Les « Dix décisives » s’inscrivent en amont de l’installation durable de la Troisième République, enfin solidement aux mains des républicains : l’alliance politique et intellectuelle entre républicains modérés et libéraux orléanistes, préparée par une maturation et des échanges intellectuels, a servi de clé de voûte à la fondation durable de la République parlementaire en France.
Composé au total de 31 contributions, l’ouvrage est divisé en 5 parties comportant chacune une introduction. Outre un avant-propos de Martine de Boisdeffre (p. 7-10) et une introduction générale signée de Pierre Allorant, Walter Badier et Jean Garrigues (p. 11-16), les articles se répartissent comme suit : 6 pour la partie I (p. 17-92), 6 pour la partie II (p. 93-172), 6 pour la partie III (p. 173-252), 7 pour la partie IV (p. 253-340) et, enfin, 6 pour la partie V (p. 341-420). Puis, suivent une conclusion rédigée par Jean-Pierre Michalon (p. 421-428) ainsi qu’une chronologie des « Dix décisives » (p. 429-432), un index des noms de personnes (p. 433-440) et de lieux (p. 441-444), les auteurs (p. 445-446) et, enfin, la table des matières (p. 447-450).
« Parcours de grands acteurs : une génération politique des Dix décisives ? »
La première partie, intitulée « Parcours de grands acteurs : une génération politique des Dix décisives ? » (p. 17-92), composée de 6 communications, s’attache à 6 hommes politiques des années 1869-1879 : Jules Simon, Etienne Lamy, Auguste Paris, Oscar Bardi de Fourtou, Charles de Freycinet et, enfin, Georges Laguerre.
Comme le montre Thomas Brantôme (Maître de conférences en histoire de droit et des institutions, université Paris Descartes), dans son article intitulé Jules Simon (1814-1896), intellectuel organique du républicanisme libéral sous le Second Empire (p. 21-34) -, Jules Simon a été adulé de la jeunesse républicaine sous le Second Empire. Mais, il souffre d’un positionnement original, à la confluence du libéralisme et du républicanisme. Profondément conservateur autant que profondément républicain, Jules Simon demeure – en cohérence avec lui-même – l’adversaire des « trois absolutismes » traditionnel, empirique et révolutionnaire socialiste. Jules Simon forge son républicanisme libéral, dans son « exil intérieur », sous le Second Empire. Vieux républicain libéral et conservateur, autant attaché à la liberté qu’à l’ordre, Jules Simon participe à l’ancrage de l’idée républicaine dans les profondeurs de la France.
Jean-Louis Clément (Maître de conférences HDR en histoire contemporaine, IEP de Strasbourg), avec sa contribution Etienne Lamy, un catholique libéral républicain (1868-1879) (p. 35-44), évoque la deuxième génération de catholiques libéraux, – après celle des fondateurs avec Lamennais, Lacordaire et Montalembert -, qui est très diverse, entre le républicain Lamy, l’orléaniste Piou et le légitimiste Viollet. Le républicanisme libéral d’Etienne Lamy n’est certes pas novateur, mais rompt avec le cléricalisme par son approche opportuniste qui sépare temporel et spirituel.
Avec Auguste Paris, parlementaire, debater et ministre au temps de la décennie décisive (p. 45-56), Jean-Marc Guislin (Professeur d’histoire contemporaine, université Charles de Gaulle-Lille 3) choisit un notable d’Arras, qui n’est qu’un « second couteau », mais cet avocat se révèle un parlementaire très actif, un conciliateur du centre droit qui pratique la diatribe parlementaire, mais travaille activement au sein de la commission des Trente et, en tant que rapporteur, sur la loi électorale et sur les lois constitutionnelles, et encore sur la loi de liberté de l’enseignement supérieur.
S’il échoue à être choisi parmi les sénateurs inamovibles, il prend sa revanche au scrutin sénatorial dans le Pas-de-Calais et entre comme ministre au cabinet Broglie-Fourtou, s’opposant à l’amnistie des Communards et défendant l’influence de l’Église catholique sur la société. Bien que dynamique, Auguste Paris est sans illusion sur le devenir de ses idées et se soumet à la victoire de la lecture parlementaire des institutions.
Avec son Fourtou comme fédérateur des droites conservatrices dans les années 1870 (p. 57-70), Thierry Truel (Docteur en histoire, professeur d’histoire-géographie à l’université de Bordeaux) nous donne à voir un Oscar Bardi de Fourtou, réduit à sa caricature d’homme de droite, à poigne, rétablissant de fait la candidature officielle, et qui tente à trois reprises – lors de la décennie décisive – de réaliser l’union des droites. Le jeune député périgourdin apparaît comme un recours pour la cause conservatrice avec la crise du 24 mai 1873 et connaît son apogée politique et ministérielle, place Beauvau, au moment clé de la crise du Seize-Mai 1877. Ultime recours des droites contre l’avènement du régime républicain, Fourtou est l’homme de l’autorité et du compromis.
Avec Les « décisives » des modérés. Charles de Freycinet au risque du républicanisme (p. 71-82), Julien Bouchet (Professeur agrégé et docteur en histoire, université Clermont-Auvergne) démontre que Charles de Freycinet, pourtant républicain du lendemain, joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre du régime de 1875. Cet ingénieur X-Mines, proche d’Émile Ollivier sous l’Empire libéral, préfet puis ministre de Gambetta lors de la Défense nationale, à la Guerre puis aux Affaires étrangères, peine à entrer au Parlement mais devient, dès 1880, président du Conseil après avoir été ministre de Jules Dufaure. Ce libéral modéré s’enracine dans le paysage politique national en s’appuyant sur son expertise et sur son goût de la décision exécutive propice et prudente. Il devient incontournable dans les combinaisons ministérielles et, au Sénat, jusqu’à la Grande Guerre.
Enfin, avec Apprentissage, réception et diffusion d’une culture républicaine. La jeunesse au service de la nation, l’exemple de Georges Laguerre (1876-1880) (p. 83-92), Julien Rycx (Professeur agrégé, Doctorant à l’université Charles de Gaulle-Lille 3) termine et complète cette galerie de portraits des acteurs de la décennie, comme incarnation d’une nouvelle génération républicaine, formée dans les réseaux de sociabilité habituels de la République des avocats, du lycée Condorcet à la Molé-Tocqueville. Secrétaire d’Adolphe Thiers et ami de Stephen Pichon, l’« Éloquent Laguerre » est secrétaire de la Conférence du stage, et accède au Parlement avec pour bagages son engagement et ses idéaux maçonniques qui viennent nourrir ses convictions sociales.
« Réseaux, courants et recompositions des familles politiques »
La deuxième partie est dévolue aux « Réseaux, courants et recompositions des familles politiques » (p. 93-172), avec 6 contributions, permanence des usages politiques s’accompagnant d’évolutions des cultures et des pratiques dans le champ politique français.
Selon Jean El Gammal (Professeur d’Histoire contemporaine, université de Lorraine), dans Les cultures politiques en France de 1869 à 1879 (p. 97-106), le XIXe siècle est marqué par l’émergence, dans l’héritage contesté des affrontements idéologiques et des expérimentations parlementaires du quart de siècle de la Révolution française et de l’Empire, de courants et de familles politiques en cours de structuration.
Dans Une décennie doublement décisive pour le système de gouvernement français. Le retour et l’inflexion majeure du parlementarisme (1868-1879) (p. 107-124), Armel Le Divellec (Professeur de droit public à l’Université de Paris II (Panthéon-Assas), Directeur du Centre d’études constitutionnelles et politiques) montre qu’une culture politique républicaine infuse dans la société grâce aux cercles de sociabilité et à des vecteurs comme la presse ou la littérature.
Si « l’Année terrible » instaure une éphémère union nationale, les élections de février 1871 masquent les vrais choix de régime ou de dynastie, peu avant que la Commune de Paris ne constitue un laboratoire de culture politique pour les familles de la gauche autour de la fête, de la laïcité, du genre. Si les cultures de droite échouent sur le « Grand refus » du comte de Chambord, elles se retrouvent dans des valeurs conservatrices d’Ordre moral.
Avec Une décennie décisive pour la genèse d’un champ politique en France ? (p. 125-134), l’évolution libérale et parlementaire du Second Empire acclimate, d’après Christophe Voilliot (Maître de conférences HDR en science politique, Sophiapol – université Paris-Nanterre), des pratiques gouvernementales que la Troisième République va prolonger au cours de sa première décennie d’existence.
L’équilibre institutionnel évolue progressivement vers un « parlementarisme absolu » déséquilibré au détriment de l’exécutif, dénaturation du dualisme pensée, en amont de la crise du 16 mai 1877 et transcrit, dès 1875, dans des lois constitutionnelles marquées par l’indétermination. Les élites françaises ont rencontré des difficultés à penser sereinement un système parlementaire de gouvernement obnubilées par la nature du régime, après la trop brève existence de la Seconde République et le coup d’État du Prince-Président.
Avec Alfred Naquet, La république radicale et la théorisation du régime d’assemblée (p. 135-148), Frédéric Rouvillois (Professeur de droit public, université de Paris) expose que ce compromis libéral, imposé par l’alliance stratégique de tous les républicains modérés, est immédiatement contesté par une conception radicale d’une République absolue portée à gauche par Alfred Naquet, théoricien du régime d’assemblée sur le modèle conventionnel de la constitution montagnarde de 1793. Le pouvoir législatif monocaméral, préservé de toute menace de dissolution subordonne l’exécutif incarné par un président du conseil sans portefeuille, responsable et révocable, et une garantie constitutionnelle sous la forme d’une Cour suprême politique.
Dans L’impossible Troisième Restauration. Les dernières années décisives (1869 à 1871) du journaliste et conseiller du comte de Chambord, Pierre-Sébastien Laurentie (p. 149-160), Estelle Berthereau (Maître de conférences d’histoire médiévale, université d’Orléans, Polen-Cesfima) explique que, dans l’entourage du comte de Chambord, Pierre-Sébastien Laurentie tente de rendre acceptable une troisième Restauration monarchique. Les divisions et la désorganisation des légitimiste entraînent le recul de leurs journaux et de leur influence, ce dès l’empire libéral où les libéraux orléanistes escomptent tirer profit de « l’état de torysme bonapartiste ». L’occasion manquée des lendemains de Sedan puis de l’Assemblée de Bordeaux annoncent l’échec final, précipité par la peur de la Commune et par l’habileté de Thiers.
Dans Le prince et le parti. Le Prince impérial et les bonapartistes : errements, espoirs et paradoxes d’une survie politique (p. 161-172), Maxime Michelet (Doctorant en Histoire contemporaine à la Sorbonne) prouve que les débuts incertains de la République redonnent un espoir de survie politique aux tenants d’une autre restauration princière au bénéfice de la dynastie bonapartiste, dont les bastions de Corse, de Charente ou du Lot résistent à la déchéance de Napoléon III. « Prince possible » par sa popularité dans les campagnes et sa beauté charismatique, par l’impossibilité d’une restauration monarchique, le Prince impérial se comporte davantage en chef dynastique qu’en chef politique au sein de son parti.
« Paris et la province : lieux et échelles de nouvelles pratiques »
La troisième partie, « Paris et la province : lieux et échelles de nouvelles pratiques » (p. 173-252), est composée de 6 autres articles. La situation du pays à l’échelle départementale, c’est-à-dire ce lieu de dialogue entre les notables provinciaux et les représentants préfectoraux déconcentrés de l’exécutif national, est bigarrée.
Dans Bonapartisme et bonapartistes. L’exemple de la Corse entre 1869 et 1879 (p. 179-192), Jean-Paul Pellegrinetti (Professeur en histoire contemporaine, université Côte d’Azur Nice, Directeur CMMC) expose que la Corse, blessée de la « légende noire » napoléonienne répandue après 1815, souffre à nouveau en 1871 de l’attribution de la responsabilité de la guerre et de la débâcle militaire à la dynastie impériale. Mais les électeurs insulaires restent fidèles au parti et aux leaders bonapartistes : l’île de Beauté demeure un bastion et une terre de refuge électoral pour les anciens hiérarques du Second Empire.
Cette force des réseaux clientélistes et claniques des grands notables perdure dans la première décennie de la Troisième République. Au sein du bastion insulaire bonapartiste, les dissensions opposent une aile droite conservatrice et cléricale à une aile gauche démocratique. Ces failles profitent d’abord au républicain Limpérani, puis au prince Jérôme, enfin à Charles Bonaparte, descendant direct de Joseph Bonaparte, frère de Napoléon Ier. Il faut attendre 1881 pour que le républicain opportuniste ajaccien Arène acclimate, à la République modérée, les villages corses.
Avec Les « petites patries » et la naissance de la Troisième République. Des années décisives ? Le cas du comté de Nice, 1869-1879 (p. 193-206), Henri Courrière (Docteur en histoire, chercheur associé au CMMC (EA 1193, université de Nice Sophia Antiopolis) prouve que les tensions entre intégration nationale et identité des « petites patries » se retrouve dans le comté de Nice, cas atypique puisque rattaché définitivement à la France, depuis 1860. Un patriotisme municipal très ancré soutient l’émergence d’un « parti niçois ». La décennie est décisive dans le processus d’intégration du comté de Nice à la France et à la République ainsi que de conciliation progressive des intérêts urbains et de l’administration préfectorale républicaine.
Alors que la République autoritaire de la Défense nationale crispe les positions, la République conservatrice de Thiers commence à réaliser la conversion des élites locales, accélérée par le rejet de l’Ordre moral. Le tournant de la crise du Seize-Mai 1877 précipite le déclin du parti niçois et la victoire d’un nouveau républicanisme niçois parachevé aux municipales de 1878. Ainsi, la Troisième République accepte l’existence des « petites patries » à condition qu’elles restent subordonnées à la grande, excluant autonomisme ou tentation de l’italianité.
Dans La politique en abyme. L’imbrication des conflits nationaux et des rivalités municipales dans les campagnes du Lot (1869-1879) (p. 207-216), l’étude des luttes politiques dans le Lot permet, à François Ploux (Professeur d’histoire contemporaine, université de Bretagne-Sud, Temos – CNRS, FRE 2015), de saisir l’imbrication croissante des micro-rivalités communales, autour de l’enjeu municipal, et des grands conflits nationaux. Le suffrage universel expérimenté sous le Second Empire à la suite de la Seconde République, politise les affrontements villageois, exacerbés par la vitalité de la sociabilité et par l’encastrement du politique et du social.
« Petite Corse », le Lot résiste à la républicanisation jusqu’en 1889, et l’articulation des oppositions de « coteries » et des luttes de partis prend pour terrain et cadre la scène municipale. Ainsi, chaque secousse politique d’ampleur nationale exacerbe les conflits internes à chaque commune. Les enjeux se redéfinissent et colorent les luttes de factions locales, relayant et filtrant à la fois la politique nationale, désormais inscrite dans le paysage municipal.
Avec La réception de Léon Gambetta entre 1869 et 1879 (p. 217-228), Aude Dontenwille-Gerbaud (Maîtresse de conférences en histoire contemporaine, université Paris-Est Créteil) indique que le moment de la rencontre entre Léon Gambetta avec l’opinion française est un « événement discursif » majeur, qui interroge la réception du discours de Gambetta par des publics très diversifiés, de l’Assemblée nationale aux préaux de chefs-lieux de canton. Durant cette décennie charnière, le corpus considérable de discours donne lieu à des réactions contrastées, à mesure que l’usage de ses qualités oratoires évolue.
La forme que prend son éloquence dépasse le cadre parlementaire afin de toucher un public populaire, d’entrer en interaction avec son auditoire formé de paysans et de membres des « couches nouvelles ». Usant d’un registre ironique pour provoquer l’hilarité de son public et disqualifier l’adversaire (l’Ordre moral), Gambetta incarne la République, l’idée républicaine, et la nouvelle norme qui conduit un leader charismatique à descendre du perchoir de l’Assemblée pour convaincre l’électorat populaire provincial.
Dans Paris l’acteur républicain (1871-1878) (p. 229-240), Yvan Combeau (Professeur d’histoire contemporaine, université de La Réunion) enseigne que Paris demeure un acteur républicain majeur, du 4 septembre 1870 à la victoire définitive des républicains. Les débats de l’Assemblée de Versailles rencontrent le discours conservateur de la presse de province pour cibler Paris comme l’adversaire d’une pacification et d’une modération du pays d’où la décapitalisation et le morcellement opérés par la loi d’avril 1871 qui dépolitise les élections municipales.
Toutefois, les municipales de juillet 1871 ouvrent une troisième voie d’apaisement avec l’élection à la présidence du conseil municipal de Paris, de Vautrain, incarnation d’une modération républicaine municipaliste compatible avec le gouvernement Thiers. Les élections municipales de 1878 renforcent l’ancrage républicain dans une capitale contrôlée où les radicaux percent. Le vote de l’amnistie des communards et la restitution du statut de capitale à Paris amorcent un retour à la normale, bien que le statut de Paris reste durablement corseté par le refus de l’autonomie municipale et d’un maire de plein exercice.
Avec L’Union libéral et démocratique de Seine-et-Oise. Un journal de campagne (p. 241-252), Nicolas Stromboni (Doctorant, université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines – Paris-Saclay) dépeint qu’en périphérie de Paris, en Seine-et-Oise, le rôle politique de la presse départementale est renforcé, dès 1867, par la suppression de l’autorisation préalable et de l’avertissement. Le foisonnement des organes d’opposition permet de contester l’influence des notables traditionnels, puis participe à l’affermissement de la République. Ainsi, L’Union libérale et démocratique de Seine-et-Oise, bihebdomadaire créé en 1868 par des libéraux, structure et participe aux campagnes électorales républicaines dans ce vaste département, à la fois, proche de Paris et pour partie rural, jusqu’à son déclin et sa disparition en 1882, victime de son excès de modérantisme.
Quelle empreinte de la décennie sur le modèle républicain ?
La quatrième partie, intitulée « Quelle empreinte de la décennie sur le modèle républicain ? » (p. 253-340), et constituée de 7 communications, interroge l’empreinte des années 1870 sur le modèle républicain français, à travers l’étude du fonctionnement des pouvoirs exécutif et législatif.
Avec La décennie décisive de l’administration parlementaire ? (p. 259-268), Pierre Michon (Docteur en histoire, rédacteur des débats du Sénat) enseigne que l’administration des assemblées parlementaires est méconnue, alors que les bureaux qui administrent les assemblées gagnent en autonomie et clarifient leur rôle, de l’Empire libéral à l’établissement de la Troisième République. Marqués par les usages traditionnels, les serviteurs des assemblées enregistrent les évolutions, subissent les événements mouvementés de la décennie. Le point de départ est la réforme opérée par le sénatus-consulte du 8 septembre 1869 qui rend aux assemblées la faculté d’élaborer leur règlement intérieur, d’organiser leurs bureaux.
Mais les bouleversements de 1870-1871 font des employés des assemblées des témoins de l’irruption du public au Palais-Bourbon puis au Sénat. En réalité, l’administration des chambres est héritière de legs « inavouables », de l’Empire libéral en remontant aux monarchies censitaires, le changement majeur étant que désormais le pouvoir dominant, voire la souveraineté de la nation, résident dans le travail de législation et de contrôle des deux chambres.
Avec Quelle constitution pour la république conservatrice ? (p. 269-282), Alain Laquièze (Professeur de droit public, université de Paris) signale que la question de la nature de la Constitution à adopter pour consolider la « République conservatrice » obsède les modérés et les libéraux, soucieux avant tout de pérenniser le régime. Cet abandon de l’ambition progressiste et démocratique de la promesse républicaine est porté par le centre gauche, soucieux de mettre un terme au provisoire, grâce à la conjonction des centres. De fait, ce projet politique est aussi un projet constitutionnel qui passe par le renoncement à toute restauration monarchique, l’acceptation du suffrage universel et l’adoption d’un régime parlementaire équilibré, tournant le dos au modèle conventionnel de 1793.
Le modèle américain est vanté par Laboulaye et exerce sa séduction sur Thiers, mais la crainte d’un nouveau 2 Décembre contribue à l’écarter, comme le modèle suisse trop proche de celui de l’an III et peu adapté à un grand pays de centralisation. Le rejet d’un régime d’assemblée et la volonté d’un équilibre des pouvoirs sont portés par les orléanistes Broglie et Prévost-Paradol, et le projet Thiers-Dufaure implique une conception minimaliste à l’anglaise de lois constitutionnelles pragmatiques établissant le bicaméralisme, un Président de la République autonome et qui gouverne, fort de son élection par un Congrès plus large que le collège des parlementaires, et un droit de dissolution des représentants. Cette « monarchie républicaine », représentative et rassurante, a traversé l’histoire constitutionnelle jusqu’à 1958.
Avec La décennie 1869-1879 au Quai d’Orsay. Les fondements d’une diplomatie républicaine ? (p. 283-296), Isabelle Dasque (Maître de conférences en histoire contemporaine, université de Paris-Sorbonne) décrit qu’au Quai d’Orsay, la décennie 1869-1879 pose les jalons d’une diplomatie républicaine et d’une amélioration du recrutement et du déroulement des carrières sur des critères plus démocratiques. Si l’aristocratie demeure prépondérante, une ouverture s’opère au profit de la bourgeoisie des talents. Politiquement, les « républicains de la veille » forment une exception au milieu d’une majorité de conservateurs le plus souvent attachés aux anciens régimes monarchiques, y compris bonapartiste.
À l’inverse d’autres grands corps, le Quai d’Orsay est peu épuré, la continuité l’emporte sur fond de solidarité familiale et de réseaux amicaux, avec une implantation renforcée du centre gauche, en particulier des réseaux gambettistes. En parallèle, la modernisation de la Carrière s’opère à partir des préconisations de la Commission de révision des services administratifs de 1871, avec pour modèle méritocratique le consul, et pour objectif des conditions de recrutement et d’avancement soustraites à l’arbitraire, fondées sur la maîtrise du droit public, de l’histoire politique et des langues vivantes.
Dans Le duc Decazes au Quai d’Orsay (p. 297-308), Yves Bruley (Maître de conférences, École Pratique des Hautes Études – EPHE, PSL) expose que le duc Decazes, bien qu’archétype de la « République des ducs » et ami du duc de Broglie, met en place des réformes prudentes, mais positives dans le sens de professionnalisation. Mais il résiste également à certains discours républicains, sort la France du « recueillement » diplomatique et laisse ainsi son empreinte, permettant de faire à nouveau entendre la voix de la « Grande Nation », de la conférence de Constantinople au Congrès de Berlin.
Avec Dufaure et la réforme de la justice (p. 309-318), Jean-Pierre Machelon (Professeur émérite et doyen honoraire de la Faculté de droit de l’université Paris-Descartes, Directeur d’études émérite de l’École pratique des Hautes Études – Section des sciences historiques et philologiques) indique que Jules Dufaure est un personnage central de la République conservatrice, même s’il réforme moins la Justice qu’il ne contribue à faire évoluer son fonctionnement et la magistrature.
Vieux routier de la politique, républicain modéré et libéral proche de Thiers, avocat consacré, Jules Dufaure occupe plus de cinq ans le poste de Grade des sceaux, tout en présidant la jeune Société de législation comparée, et en soutenant les débuts de la Société générale des prisons. Son bilan réformateur législatif est toutefois par les contraintes de la situation politique, alors que son influence sur la gestion de la Chancellerie est plus palpable, avec en particulier la création du Bulletin officiel du ministère de la justice, la protection de la magistrature des remous politiques et l’introduction pragmatique du concours de recrutement, prélude au décret Sarrien de 1906, qui réglemente le recrutement et l’avancement des magistrats.
Dans Le contrôle judiciaire de l’imprimé à l’aube de la Troisième République. Hésitations juridictionnelles au sein d’une République en construction (p. 319-330), Clémence Faugère (Doctorante et ATER en Histoire du droit, Institut de recherche Montesquieu, université de Bordeaux) démontre que les magistrats jouent un rôle essentiel dans le contrôle de l’imprimé à l’aube de la Troisième République.
Le juge judiciaire exerce un contrôle de l’écrit, potentiellement subversif, à travers deux infractions, l’outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs créé par la loi du 17 mai 1819, et la répression de la diffamation, moyen de protection de la vie privée et de la vertu collective. Ce contrôle de l’imprimé révèle la relation complexe de la jeune Troisième République avec l’institution judiciaire et la presse, et la recherche d’un modèle conservateur fondé sur la moralité et publique.
Dans Les Dix décisives de la liberté de l’enseignement supérieur (1869-1879) (p. 331-340), Éric Anceau (Maître de conférences HDR en histoire contemporaine – université de Paris-Sorbonne) montre que, liberté bien plus controversée que celle de la presse, la liberté de l’enseignement supérieur est pourtant reconnue par la Seconde République et devient un enjeu primordial, sous l’Empire libéral, pour le niveau supérieur post-bac. Mais les débats ne peuvent aboutir du fait de la débâcle militaire de 1870, et une solution en droit positif n’est adoptée qu’avec la Troisième République.
Premières élections législatives libres, celles de mai-juin 1869 mettent la question de la liberté de l’enseignement en débat, portée par les légitimistes, les orléanistes et les dynastiques libéraux, vainqueurs du scrutin et dont beaucoup se retrouvent au gouvernement autour d’Émile Ollivier. La commission extraparlementaire sur la liberté de l’enseignement supérieur s’ouvre à douze professeurs de l’enseignement supérieur, à des représentants des confessions dominés par l’Église catholique. La question est tranchée, en 1875, à l’issue de débats d’une haute tenue. La loi Ferry sera moins libérale, nouvel élément de continuité entre deux grands ministres et deux périodes, de l’Empire libéral à la République opportuniste.
« Modèles comparés et regards croisés »
La cinquième partie, dévolue aux « Modèles comparés et regards croisés » (p. 341-420), avec 6 contributions, revisite la décennie par le recours à la méthode comparée et aux regards croisés est-européens et bismarckien, tant il est difficile de sortir du syndrome de l’obsession allemande de la pensée française.
Avec La société de législation comparée durant les Dix décisives : un vivier pour la République (p. 345-362), Pierre Allorant (Professeur d’histoire du droit et des institutions, université d’Orléans, POLEN et CHPP) et Walter Badier (Maître de conférences en histoire contemporaine, université d’Orléans, ERCAE et CHPP) exposent que, contemporaine de l’Empire libéral, la Société de Législation Comparée, créée à l’initiative de deux jeunes juristes libéraux et républicains, incarne la « décennie décisive », son unité d’atmosphère intellectuelle et les ruptures opérées par la guerre, la déchéance du Second Empire, puis l’utilisation de ce vivier de juristes libéraux par la République conservatrice et de centre gauche, de Dufaure à Gambetta, dans le corps préfectoral, la magistrature, les cabinets ministériels et à l’Assemblée nationale.
Ainsi, cette société savante, qui se prétendait apolitique, devient un véritable think tank libéral, dont les travaux préparatoires facilitent l’accouchement des projets législatifs, particulièrement autour du ministère de la Justice.
Avec La méthode comparative et européenne de Théophile Roussel dans la construction de la législative hygiéniste de la Troisième République (1869-1879) (p. 363-372), Cédric Maurin (Doctorant à Sorbonne-université) explique que, dans le même esprit comparatiste et européen que la Société de législation comparée, Théophile Roussel expérimente une méthode apte à construire une législation hygiéniste pour la France républicaine. Issu d’une famille légitimiste, ce médecin se convertit au républicanisme, lors de ses études, avant d’être parlementaire à deux reprises, en 1849 puis au début de la Troisième République.
« Maître de granit » en Lozère, notable bien ancré dans le territoire, républicain libéral passionné d’agriculture, il mène des combats contre l’alcoolisme et pour l’assistance médicale dans les campagnes. Sa loi sur la Protection des enfants du premier âge du 23 décembre 1874, votée à l’unanimité, permet de comprendre sa méthode de travail d’expertise à la fois historique, statistique et comparée, à partir de tours d’horizon et d’études législatives sur l’Angleterre, mais aussi la Belgique, la Hollande et la Prusse. Cette loi préfigure la « nébuleuse réformatrice », de la fin du XIXe siècle, en matière de santé publique.
Dans Les Dix décisives vues d’ailleurs. Modes et inspirations de la modernisation politique roumaine (p. 373-384), Raluca Alexandrescu (Maîtresse de conférences en sciences politiques, université de Bucarest) présente comment l’expérience politique et constitutionnelle, saccadée et diverse qu’éprouve la France des « Dix décisives », est regardée avec attention, et parfois prise pour modèle, singulièrement au sud-est de l’Europe.
En Roumanie, sous forte influence française depuis 1859, les réformes et la structuration de la vie politique empruntent beaucoup d’éléments à la France, des discours à la pratique et aux formes de représentation. Les difficultés d’adaptation de ce modèle entretiennent des tensions entre l’adoption de la modernité politique occidentale fondée sur la nation intégrative et une conception individualiste libérale.
Avec Bismarck et la « républicanisation » de la France. Les débuts décisifs de la décennie 1870 (p. 385-394), Stéphanie Burgaud (Maître de conférences en histoire contemporaine, IEP de Toulouse) atteste, qu’au cours de la décennie qui englobe la débâcle face à la Prusse, la position de Bismarck face à la républicanisation de la France ne peut qu’être décisive. La question du régime politique de la France, comme en 1814, redevient centrale en Europe et particulièrement dans la politique extérieure bismarckienne.
La chute du second Empire n’arrange pas le chancelier de fer, qui s’inquiète par ailleurs du panslavisme russe. Pour pérenniser l’isolement diplomatique de la France, la pire solution serait l’établissement d’une monarchie orléaniste, parlementaire et libérale, très acceptable pour l’Angleterre et les monarchies continentales. Thiers incarne un bon compromis, d’autant que son armée professionnelle semble incompatible avec une revanche. À l’inverse, Mac-Mahon inquiète, d’autant que l’Ordre moral catholique séduirait la Bavière, menaçant la récente unité allemande dans le contexte du Kulturkampf.
Après des campagnes de presse, le chancelier utilise la menace d’une guerre lors de la crise de 1875 pour tenter, en vain, d’isoler la France, soutenue par les Anglais et les Russes en une préfiguration de la Triple Entente.
Dans sa communication 1869-1879 : aux sources du nationalisme ? (p. 395-406), Fabien Conord (Professeur en histoire contemporaine, université Clermont-Auvergne, CHEC) montre qu’après la défaite de 1870, la fascination des intellectuels français pour l’Allemagne se focalise sur la Prusse, son histoire, son système d’enseignement. Mais pour beaucoup de républicains, c’est l’empire et le bonapartisme qui ont trahi et trompé les Français, tel Bazaine dont le procès passionne la presse, fin 1873.
Les légitimistes, ultramontains, plus romains que Français, ne sauraient être de bons patriotes. La défense de la République et de la Patrie ne font qu’un, face au péril du germanisme. La France républicaine de Gambetta doit reprendre son rang et rayonner dans le monde, en s’appuyant sur les peuples latins et slaves et en développant une politique coloniale. Le rayonnement de la science française, le développement de l’instruction publique constituent des leviers du relèvement de la France, prudente et réformiste.
Dans son article La naissance du national-républicanisme (p. 407-420), Jérôme Grévy (Professeur en histoire contemporaine, université de Poitiers) démontre que la décennie décisive se situe aux sources d’un « national-républicanisme » français. Distingué par Littré du chauvinisme, le nationalisme des lendemains de la défaite est défensif, héritier du patriotisme démocratique et ouvert de la Révolution française mais teinté du désir de la Revanche, faisant le pont vers le nationalisme fermé de l’Action française, par exemple avec Paul Déroulède, mais aussi dans les discours de Léon Gambetta et de Victor Hugo.
Ainsi, le nationalisme qui émerge lors du boulangisme emprunte beaucoup au radicalisme d’un Rochefort, populaire, anticlérical et antiparlementaire, héritier de la Commune. L’hostilité au compromis institutionnel de 1875 avec les orléanistes alimente un radicalisme intransigeant, alors que la déception face à l’évolution de Gambetta conduit Juliette Adam aux limites du chauvinisme. La cristallisation nationaliste, qui s’opère au moment du boulangisme, puise ses racines dans les Dix décisives.
Les Dix décisives (1869-1879) : Une synthèse renouvelée sur la première décennie de la IIIe République
Les actes du colloque sur La décennie décisive jettent une lumière nouvelle sur les quelques années d’interrègne qui ont suivi l’écroulement du Second Empire. Longtemps incertaine, l’orientation constitutionnelle et politique du pays s’est fixée entre 1870 et 1879, suivant une logique quelque peu souterraine, mais avec un résultat patent. Lorsque s’achève la décennie 1870, la République peut enfin s’installer. Une page surchargée, et souvent raturée, de l’histoire contemporaine de la France a été tournée. Les grandes lignes d’un nouveau mode de gouvernement sont fixées pour longtemps.
La marque des années 1870, dans l’histoire de la République, n’en est pas moins réelle. Des transformations durables ont été amorcées. Un cadre constitutionnel nouveau a été installé. En divers domaines, des voies réformatrices ont été ouvertes ; d’autres, à peine tracées, se sont profilées en pointillé. Une nouvelle culture politique a commencé à s’imposer.
De tels moments sont rares. Ce n’est que plus d’un demi-siècle après, à partir de 1930, que le pays connaîtra, dans un autre sens, un basculement d’une ampleur comparable. Une seconde décennie décisive apparaîtra comme le pendant négatif de la première. Elle en différera à tous égards, à l’image des périodes « critiques » qui s’opposent aux périodes « organiques », propices aux constructions durables. Les plus lucides des contemporains purent alors pressentir que la défaillance des élites et la « décadence » du régime politique conduiraient à « l’abîme ». Tous durent bientôt constater la fin de cette République dont la polyphonie du présent ouvrage, évoque de manière très complète les commencements et les promesses.
Ainsi, cet ouvrage s’adresse aussi bien aux enseignants-chercheurs s’intéressant à de nouveaux champs historiques que les érudits locaux et les étudiants en histoire cherchant de nouveaux sujets de Master 1 et 2, voire de thèse.