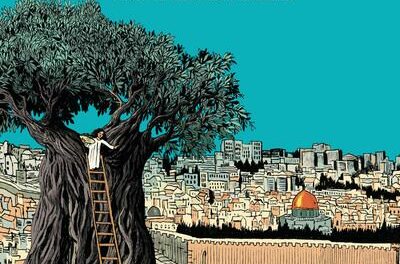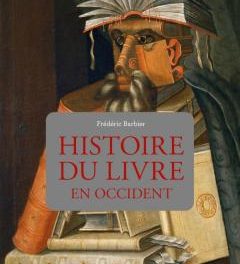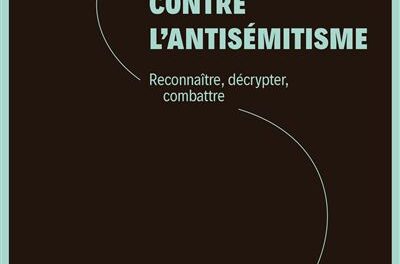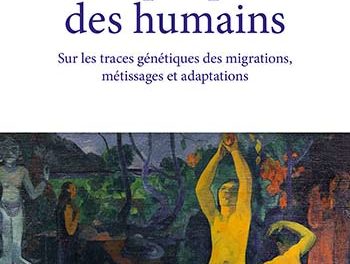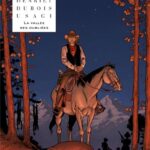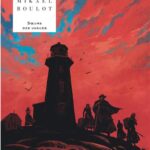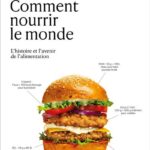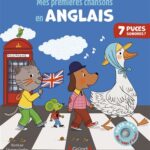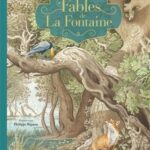Il faut être prêt à s’engager dans une longue lecture pour venir à bout des 653 pages de cette vaste étude portant sur un espace aussi étendu que souvent ignoré : la moitié nord du continent européen. Pourquoi ce sujet ? Parce qu’il s’agit d’une zone souvent imaginée comme occupée par des populations pauvres, arriérées, voire barbares et souvent repoussées dans les marges du monde « civilisé ». Ce que montre Les mondes du Nord, c’est précisément que ces régions n’ont rien de sauvage !
L’ouvrage est écrit par 4 spécialistes de cette aire sur une très longue durée.
- Vivien Barrière est maître de conférences en histoire et archéologie à l’Université de Cergy. Ses recherches portent surtout sur les changements induits par la présence romaine dans la partie occidentale de l’Empire.
- Stéphane Coviaux enseigne l’histoire en classes préparatoires au lycée Fénelon de Paris. Il s’intéresse à la Scandinavie ancienne et à la christianisation de cette région.
- Alban Gauthier est professeur d’histoire médiévale à l’Université de Caen-Normandie. Ses travaux portent sur l’histoire des îles britanniques à la fin de l’Antiquité romaine et au début de la période médiévale.
- Anne Lehoërff est professeur des universités à l’Université de Cergy. Elle est spécialiste de la préhistoire.
L’ouvrage dans son ensemble apporte une somme de connaissances très précises et très claires sur la longue histoire de l’Europe du Nord, de la préhistoire (800 000 avant l’ère commune) jusqu’au Xe siècle. Il montre en particulier le développement souvent connecté de plusieurs civilisations à travers la recherche des flux de communication et des réseaux d’échange et d’influence. Le plus important est que les auteurs proposent de décentrer le regard afin de changer notre représentation du monde. Ici, ce n’est pas la Méditerranée qui est au centre, mais un autre espace maritime tout aussi dynamique, parcouru et traversé : l’espace de la Manche, de la Mer du Nord et de la mer Baltique, les frontières naturelles de ces mers étant repoussées très en avant des terres insulaires ou continentales grâce aux nombreuses embouchures de fleuves qui permettent la pénétration des personnes, des marchandises des cultures en profondeur. La Méditerranée est plutôt une périphérie d’un territoire dont le centre se trouve entre le 50e et le 70e parallèle. L’ouvrage dessine alors une nouvelle carte du monde. Les « mondes du Nord » s’étendent en effet de l’Islande à la Carélie, de la Bretagne actuelle à l’Autriche, des archipels du nord de l’Ecosse aux rives de la Loire, en évoquant aussi quand il en est besoin des connexions avec le monde byzantin, avec les plaines russes et même avec l’Arabie et l’Inde !
Dans cette vaste aire régionale, ce sont les peuples souvent mis en exergue dans les histoires communes qui deviennent le centre de l’attention. Les textes latins (antiques ou médiévaux) ne font mention des Nords que pour faire intervenir une menace : celle des Cimbres et des Teutons, celle des Alamans et des Saxons, celle des peuples Vikings. Le Nord apparaît comme un monde barbare face à la civilisation développée autour de la Méditerranée, lors des récits des « grandes invasions ». En réalité, les Européens du Nord ont une histoire très riche et passionnante.
Les Mondes du Nord. De la préhistoire à l’âge viking fournit donc une somme de savoirs que les auteurs ont souhaité mettre à la portée de tous, pour inciter les lecteurs à s’intéresser aisément à cette région et à la longue durée des civilisations de l’Europe du Nord. Le livre se compose de 26 chapitres en près de 550 pages ; s’y ajoutent 5 textes en annexes (« Les Nords au regard de l’archéologie des périodes anciennes » ; « Langues et écritures du Nord » ; « Des sources trop rares ou trop tardives ? » ; « Décrire le Nord, de l’Antiquité au XIIe siècle » ; « Usages et mésusages des Nords anciens »), un glossaire, plusieurs arbres généalogiques, des choix de sources, une riche bibliographie de 26 pages et plusieurs index (des noms de personnes, des noms de lieux, des noms de peuples). Des encarts en couleur, rassemblés à chaque tiers du livre, ajoutent de belles illustrations sur les sources archéologiques. Enfin, à l’intérieur des chapitres, de nombreuses photographies en noir et blanc, des plans, des schémas et des cartes de très bonne qualité guident le lecteur et l’aident à localiser l’ensemble des lieux et des peuples cités. Le tout forme une encyclopédie très facile à utiliser.
On reconnaît facilement l’approche braudélienne et les 3 temps :
- Le temps géologique et structurel en découvrant la transformation du continent au cours des périodes de glaciation et aux changements climatiques débutés il y a 3 millions d’années. Cette approche fait la part belle à la re-création, par les fouilles archéologiques, géologiques et par la description, des paysages du continent européen lors des périodes les plus reculées. La carte de l’évolution du Doggerland, cette terre glacée émergée qui reliait alors en un seul espace la France, l’Angleterre et les terres scandinaves entre 21 000 et 7 000 avant notre ère est très explicite.
- Le temps civilisationnel est marqué par plusieurs phases : celle des premières migrations de l’Homo Erectus depuis l’Afrique, celle de la colonisation de l’Europe par Neandertal puis Sapiens, en adoptant une chronologie différenciée selon les découvertes et les sites archéologiques ; celle des celtes ; celle des peuples romanisés ; celle des Francs ; celle des vikings norrois… Il est aussi intéressant de voir que les auteurs superposent, sans jamais perdre le lecteur et en chassant toutes les confusions, ces périodes civilisationnelles à d’autres âges : le Mésolithique, le Paléolithique dont le Magdalénien, le Néolithique ; l’âge du Bronze, l’âge du Fer ; l’âge de Hallstatt, l’âge de la Cène…
- Le temps événementiel qui apporte une vision historique plus simple et plus classique : celle de la conquête de la Bretagne par les Romains et les résistances qu’ils y rencontrent ; celle des relations entre Charlemagne et les peuples danois et scandinaves… Une part importante de l’ouvrage aborde l’histoire des îles britanniques et irlandaises de manière très précise, à la fois pour elle-même et dans l’analyse des relations avec les peuples du continent ou avec les vikings. Cela est vraiment très riche, surtout si le lecteur ne connaît pas cette histoire. Il y trouvera une foule d’informations.
Dans son ensemble, l’ouvrage se caractérise par la volonté de promouvoir la région du Nord de l’Europe. A la fin de la lecture, il devient évident que la place de la Méditerranée a été surévaluée par rapport aux dynamiques qui marquent les espaces plus septentrionaux. Nous finissons captivés par l’intensité des flux d’échanges, les voyages individuels ou de peuples, ainsi que les transferts culturels qui ont façonné la région. Les auteurs nous font suivre des voyages passionnants, comme cet « homme de Cheddar » (ayant vécu au 8e millénaire avant notre ère) retrouvé en Grande-Bretagne mais dont l’ADN correspond à d’autres ADN originaires des Pays-Bas ; ou cet archer (ayant vécu vers 2300 avant l’ère commune) dont le squelette a été retrouvé dans la tourbe du Wiltshire : l’analyse des isotopes de strontium dans l’émail de ses dents montre qu’il est originaire dans les Alpes ! On lit avec simplicité l’organisation commerciale du monde viking, en suivant la carte des emporia, l’importance des détroits et les découvertes « exotiques » faites dans des nécropoles danoises. L’aventure du casque de Sutton Hoo, retrouvé dans une nécropole de l’Est de l’Angleterre, met en évidence des connexions fascinantes avec le reste du monde connu. Assurément, l’économie-monde méditerranéenne n’a rien à envier au Nord de l’Europe !
Pour parvenir à nous en convaincre, les auteurs utilisent des procédés d’écriture et d’explicitation aussi efficaces que pédagogiques :
- de nombreuses descriptions de paysages et des références aux transformations du climat
- des méta-narrations documentées par les fouilles archéologiques et les progrès de l’analyse chimique des ossements ou de la dentition,
- des récits de l’histoire de ces découvertes et de leurs interprétations,
- des illustrations (photographies, dessins, reproductions, cartes…) commentées …
Le grand espace maritime de l’Europe du Nord est simplement structuré entre deux mers : la mer du Nord et la mer Baltique.
La première apparaît comme un espace ouvert, dans lequel les circulations commerciales et les échanges ont été faciles. La Mer du Nord connecte les îles britanniques, les côtes norvégiennes, les fleuves du Nord du continent ainsi que l’espace Atlantique.
La Baltique est plutôt décrite comme une mer fermée. Cela ne veut absolument pas dire qu’elle est isolée du reste du monde connu. Bien au contraire, l’espace des Varègues est lui aussi connecté au continent, davantage par des voies fluviales et terrestres que par des échanges maritimes entre des fjords protégés mais couverts de glace une partie de l’année (même si ceux-ci ne sont pas négligés).
Les chapitres écrits par les 4 auteurs sont très complets. Certains de ces chapitres sont de facture classique et portent sur des sujets « faciles », c’est-à-dire connus : les 4 chapitres sur la conquête romaine du Nord, sur l’organisation des provinces du Nord de l’Empire, sur les relations entre Rome et ses voisins septentrionaux et sur la fin rapide de la présence romaine dans ces régions éloignées de l’Italie abordent par exemple les thématiques de la romanisation, les différents statuts des citoyens, la conquête de la Bretagne, le contrôle difficile du limes rhénan ou encore les révoltes celtes. Ce sont des sujets après tout bien connus. Ils ont cependant le mérite de présenter un état des lieux très précis de la question. D’autres chapitres sont écrits dans le même esprit : ils traitent des royaumes francs de Clovis aux successeurs de Charlemagne ; d’autres traitent de la christianisation du Nord, du développement du monachisme irlandais, des campagnes d’évangélisation des marges barbares à partir du VIIIe siècle ou encore de la constitution de grands royaumes chrétiens entre Francie, Normandie et Angleterre.
Certains de ces sujets peuvent sembler maîtrisés par les lecteurs, mais là encore, les auteurs apportent des récits clairs et imagés, ainsi que des détails et des analyses historiographiques neuves. Parmi ces chapitres, nous pouvons citer ceux sur la fin de la domination romaine et sur les « invasions barbares », qui sont plutôt considérées comme des « vagues d’intégration » ; celui sur le rôle des Frisons dans la navigation en mer du Nord ; celui sur le « premier âge viking ».
D’autres chapitres sont plus surprenants parce que les thèmes qu’ils abordent ne sont pas forcément maîtrisés, même par des lecteurs passionnés d’Antiquité. C’est l’effet du décentrement du regard qui définit leur intérêt. C’est le cas des chapitres qui traitent de l’émergence des royaumes et d’une réorganisation politique autour de la mer du Nord du Ve au VIIIe siècle ; des passages récurrents sur la vigueur des royaumes qui se constituent en Angleterre, en Galles et en Irlande ; des descriptions des tracés changeants des routes commerciales fluviales et terrestres entre le Nord de l’Europe et la Méditerranée ou les périphéries asiatiques, depuis la Néolithisation jusqu’aux échanges commerciaux des VIIe-IXe siècles.
Il faut signaler les nombreux développements sur l’histoire des îles britanniques (de l’Angleterre aux îles Shetland, de l’estuaire de la Tamise au pays de Galles et à l’Irlande) sous l’Antiquité romaine et le Haut Moyen Age. Ces passages sont très précis et très agréables pour celui qui n’en a jamais entendu parler. Là encore, le récit très imagé, les cartes et les photographies guident très simplement le lecteur. Même sil faut rester concentré pour suivre le fil de cette histoire, les textes sont plutôt accessibles aux non-spécialistes. De même, les chapitres sur les Frisons, les Norrois et les Varègues (pour simplifier, les Vikings) sont tellement structurés qu’il y a peu de risques de confusions entre les peuples, les régions ou les périodes. Le lecteur peut donc y prélever une myriade d’éléments sur les civilisations, sur les techniques, sur les explorations, sur les migrations, sur les découvertes, sur les implantations, sur les influences « vikings » (y compris dans les langues anglo-saxonnes).
Les développements sur les Vikings sont très nombreux et très précis. Ils mettent en évidence la diversité des peuples scandinaves, allant jusqu’à recréer une géopolitique de la mer du Nord et surtout de la Baltique entre les IXe et XIe siècles. Loin de la Méditerranée transformée en un « lac musulman/fatimide », cette période devient cruciale en Europe du Nord puisqu’elle voit l’apogée de l’empire carolingien (qui a aussi co-existé avec plusieurs royaumes d’Angleterre et du Danemark) puis son remplacement par différents royaumes concurrents, avant la création d’un nouvel Empire germanique en 962. Les derniers chapitres décrivent les relations commerciales, militaires, diplomatiques, religieuses, entre différents Etats médiévaux de l’Angleterre à la Germanie, puis dans le Nord, « espace de conflits et de rivalités ». L’ouvrage se conclut en mettant en scène l’influence des derniers raids vikings du XIe siècle sur la consolidation des grandes monarchies chrétiennes.
Les passages les plus stimulants sont ceux qui apportent une vision globale et connectée des « mondes du Nord » avec le reste du « monde », connu ou non. Dès les premières pages sont décrites les longues migrations de peuples venus d’Asie pour coloniser la Scandinavie. On découvre ensuite l’importance des navigations de découverte, par bateau, avant l’invention de la roue. Dans la suite de l’histoire, plusieurs chapitres très riches portent sur des échanges marchands surprenants : ainsi ce « Bouddha de Helgö », une statuette de bronze datée de la fin du Ve siècle, représentant Bouddha, fabriquée dans une région du Pakistan ou du Cachemire, et retrouvée dans une île du lac Mälar en Suède) ; ces pièces de « l’échiquier de Lewis » (du nom de l’île d’Ecosse où elles ont été exhumées) fabriquées en Norvège au XIIe siècle dans de l’ivoire de morse ; cet ensemble d’objets vikings découverts sur les rives du Dniepr, en Ukraine.
Plusieurs chapitres ou sous-chapitres apportent des éléments précis et très accessibles sur les échanges au long cours dans des périodes reculées et dans des espaces a priori isolés. On découvre alors que le Nord était aussi connecté que la Méditerranée. Les fleuves, en particulier, ont servi de portes d’entrées aux flux marchands ; l’agentivité des négociants, des explorateurs et des conquérants est aussi convoquée pour retracer des parcours incessants. Une sous-partie traite par exemple des vagues de migrations et des diffusions des techniques de la métallurgie au cours de « l’âge du bronze connecté ». Le chapitre « Les celtes anciens à la veille de la conquête romaine » montre que l’Europe n’a pas seulement reçu les influences de l’Orient ou de l’Afrique, mais insiste aussi sur toute l’importance de la Scandinavie comme source d’apports culturels en Europe méridionale notamment grâce à une carte commentée des « principaux sites de l’âge du fer ». Le chapitre « Un Nord aux dimensions mondiales » connecte la Baltique norvégienne à l’Atlantique Nord, aux îles Féroé, à l’Islande, au Groenland et au Vinland (la baie du Saint-Laurent) et décrit certains ports (appelés emporia) comme des « plaques tournantes » du commerce. Le chapitre suivant traite de la « diaspora viking ». Cartes à l’appui, les auteurs démontrent très efficacement l’intégration de l’Europe du Nord dans une perspective globale.
Un autre effort à noter a été porté sur la déconstruction des mythes historiques sur les « mondes du Nord », sur les « mondes clos »,sur « les celtes », sur la « christianisation des païens » ou plus généralement sur les « Vikings ». Historiographiquement à jour, et appuyé sur de nombreuses fouilles archéologiques récentes, les auteurs sont capables de raconter les tergiversations historiographiques depuis le XIXe siècle et de fournir les conclusions actuelles.
***
En résumé, Les mondes du Nord. De la Préhistoire à l’âge viking est une lecture particulièrement riche portant sur une aire d’étude très étendue et dans la longue durée. C’est une somme qui ne doit pas être lue d’un seul tenant, mais par morceaux, par thèmes, tout en gardant à l’esprit que chacune des parties participe à une logique qui structure l’ensemble : l’idée que les « mondes du Nord » ne sont en aucun cas des espaces isolés, sauvages, ni des territoires moins dynamiques ou intégrés que l’aire méditerranéenne. Ce sont au contraire des régions très riches et animées. Elles ne sont jamais exclues de la Grande Histoire de l’Occident, jusqu’à s’intégrer de diverses manières à une histoire du monde global.