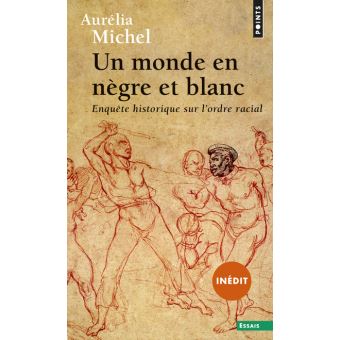Il est dommage que, dans son avant-propos, l’auteureAurélia Michel, Maîtresse de conférences en histoire à l’Université Paris-Diderot est membre du Centre d’études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques. Elle est spécialiste de l’étude des sociétés urbaines en Amérique latine, du Brésil post colonial et contemporain., qui veut rétablir des vérités, véhicule des contre-vérités à propos de l’enseignement de la traite négrière. Non cet enseignement n’a pas été introduit par la loi Taubira en 20011, il est inscrit dans les programmes et les manuels2 depuis beaucoup plus longtemps.
Dans son introduction Aurélia Michel interroge les mots : race, Blanc, « nègre »3. Elle montre la rupture sémantique entre XVIIIe et XIXe siècle et réaffirme le poids de l’histoire dans les définitions de ces mots qui expriment la domination née de l’économie de plantation, des constructions politiques.
Ce choix étymologique induit le plan de l’ouvrage en trois parties : Esclavages et Empires, Période nègre, Le règne du Blanc.
Esclavages et Empires
L’auteure rappelle le caractère extrêmement répandu dans le temps, de l’Antiquité à nos jours, comme dans l’espace de la réalité de l’esclavage. Elle en définit les limites institutionnelles, la grande variété de statuts réels à partir des travaux de l’anthropologue Claude Meillassoux4 qui semble avoir beaucoup influencé l’auteure. Elle propose une analyse de la signification sociale de l’esclavage : étranger, travail pour la société qui l’emploie, extérieur à la parenté, véritable clé de lecture de l’ensemble de cet ouvrage.
L’auteure montre le recours permanent à de nouveaux esclaves qui s’accompagne de trois phénomènes : dépersonnalisation, désexualisation et décivilisation, violences à la fois réelles et symboliques. Elle corrèle l’esclavage à la guerre, au marché et à la construction d’empires.
L’esclavage en Afrique subsaharienne remonte à l’Antiquité (évocation des marchés aux esclaves du Caire) et perdure en terre musulmane avec le premier développement des routes de traite. Les cités italiennes entrent en scène dès le XIIe siècle (Venise) avec un commerce vers l’Europe orientale. L’auteure montre les conséquences au sud du Sahara avec la constitution d’États de traite (Royaume du Ghana, Kanem puis Empire malien, Songhaï) qui prospèrent en alimentant les marchés aux esclaves des Almoravides, des Almohades ou el Andalus.
Une seule source pour cette première partie : Claude Meillassoux, on peut regretter l’absence de renvois vers d’autres auteurs, par exemple Alain Testart5.
Dans le chapitre trois il est question de la mise en relation de la construction de l’Europe avec l’esclavage. Si en Europe au Moyen Age l’esclavage est remplacé par le servage c’est, pour l’auteur, la nécessité de rattacher la force de travail non à un homme mais à une terre pour stabiliser le peuplement, évolution soutenue par l’Église. A partir du XIe siècle le mouvement d’affranchissements s’accompagne de la notion de travail libre, l’État moderne se met petit-à-petit en place et la « Reconquista » légitime la conquête de terres non chrétiennes, la « guerre juste » définie par Thomas d’Acquin. L’auteure voit dans ces évolutions les germes de la traite négrière. Ce détour par le Moyen Age est destiné à prouver un raisonnement assez téléologique. Après les débuts des voyages atlantiques l’auteure montre la naissance de l’économie de plantation à Sao Tomé au XVe siècle liée à l’exploitation esclavagiste et l’expansion du capitalisme marchand.
Dans le chapitre 4 l’auteure reprend le récit des « Grandes Découvertes » puis l’arrivée des premiers navires négriers non sans oublier l’existence d’une main d’œuvre européenne certes numériquement peu nombreuse, les engagés.
Période nègre
Les trois chapitres couvrent la période 1620-1794.
C’est d’abord la description de la plantation au XVIIe siècle entre Caraïbes et Brésil, la spécialité de l’auteure : propriété privée, capitaux, concentration de la force de travail et relations avec l’Europe, à la fois système de production et colonisation soutenue par les États. L’auteure décrit le rôle des Portugais, des Espagnols mais aussi des grandes compagnies notamment hollandaises ou françaises. C’est à cette époque que le terme de « noir » devient synonyme d’esclave (code noir de 1685). L’intérêt de ce chapitre réside dans la reprise assez synthétique d’éléments souvent traités séparément dans l’histoire de chaque pays européen.
L’auteure veut démontrer : « la centralité du colonialisme et de l’économie atlantique dans la structuration des économies européennes, dans celle des États et de la pensée politique et économique. Que ce soit dans sa version monarchique absolue ou libérale anglo-saxonne, la production hors d’Europe de marchandise à haute valeur ajoutée et le progrès de leur consommation en Europe ont été incontestablement un des piliers du décollage européen. » (p. 131-132).
Pour l’auteure la particularité de l’esclave de plantation est d’être soumis par la violence pour une rentabilité à court terme. Violence qui se manifeste dès la capture en Afrique et le voyage. On peut regretter que la source invoquée soit encore ici le seul Claude Meillassoux, aucun recours aux travaux de Catherine Coquery-Vidrovitch6 qui présente pourtant elle-aussi des témoignages comme celui d’Olaudah Equiano ni d’autres auteurs comme Olivier Pétré-Grenouilleau sur les traites négrières.
Sur la plantation le recours à la violence et le marronnage, l’auteure montre la contradiction entre l’esprit des Lumières et ce qu’elle nomme « la fiction du nègre »7.
Le chapitre suivant est consacré à la crise de l’économie sucrière (1750-1794) et la tentation d’une colonie de peuplement (Amérique du Nord mais aussi Amazonie), la créolisation de la population antillaise et la contestation de la traite et de l’esclavagisme au sein du mouvement Quaker. Dans le même temps la ségrégation augmente au nom de la « limpieza de sangre » qui rejoint les systèmes de classification qui apparaissent au XVIIIe siècle (Linné, Buffon). Le chapitre se termine sur la naissance d’Haïti sans que soit évoquée la première abolition de 1794 et l’action de l’abbé Grégoire.
Le règne du Blanc
Cinq chapitres pour cette troisième partie.
Le chapitre huit est consacré au racisme scientifique de la première moitié du XIXe siècle comme élément de justification des inégalités en contradiction avec les droits de l’Homme qui apparaissent en même temps. L’auteur appuie son raisonnement sur l’histoire des États-Unis, des nouveaux États d’Amérique le retour du rétablissement de l’esclavage sous Napoléon. Elle montre aussi la difficulté à prendre en compte les affranchis.
Dans un second temps L’auteure explique comment le déclin de l’économie atlantique fondée sur le sucre conduit à la colonisation comme source de matières premières et possible débouché pour la jeune industrie européenne. Elle met en évidence le parallèle entre le mouvement abolitionniste et les nouvelles conquêtes.
La période 1830-1850 est marquée par les politiques abolitionnistes : difficile rupture avec l’esclavagisme aux Antilles, débats idéologiques, contexte de violence de l’abolition de 1848 et chez certains penseurs l’idée que la colonisation peut être un moyen d’éloigner les classes laborieuses. C’est dans ce contexte de discussions sur « l’aptitude de la race nègre à la liberté » (p. 236) que naît la science des races notamment au sein de la société ethnologique de Paris. Le concept de race devient après l’esclavage la justification de l’exploitation du travail d’une catégorie, usant de la violence symbolique comme physique (travail forcé).
L’auteur décrit la reconfiguration des relations sociales dans les Amériques avant d’aborder l’exploration-exploitation de l’Afrique et plus particulièrement le développement des moyens de communication. Une approche un peu confuse où l’auteur mêle des faits, des continents, une présentation du concept de nation et les théories raciales comme « objectivation de la domination européenne » (p. 261).
Le gouvernement des races (1885-1915) qui selon l’auteure commence à la Conférence de Berlin justifie l’accaparement des terres par le discours racial. L’auteure, s’appuyant sur son domaine de recherche, décrit l’évolution des grandes exploitations et des compagnies de commerce au Brésil et dans toute l’Amérique du Sud assimilant le recours aux migrants chinois ou indiens aux esclaves car selon son raisonnement : les engagés travaillant loin de leur pays d’origine sont comme les esclaves de traite, source de l’accumulation capitalistique. D’autre part le recours au travail forcé et les codes de l’indigénat en Afrique sont des violences légalisées par le pouvoir politique excluant les populations des nouvelles colonies de la citoyenneté. La politique de race s’exprime dans les recensements (par exemple le classement ethnique des Tutsis et des Hutus) et la gestion coloniale. La focalisation sur l’explication par la race exclut de fait tout recours à des comparaisons sur la situation des dominés, sur la violence au sein des sociétés européennes comme la répression des fureurs paysannes ou des Camisards pour le XVIIIe siècle, des mouvements ouvriers du XIXe siècle. L’auteur insiste sur le renforcement du récit de la supériorité blanche comme condition indispensable au projet colonial, paragraphe où il est question de fonction de la femme blanche et de virilité au cœur du discours racial en Europe comme en Amérique, affirmations qui mal étayées par des études précises, semblent plus idéologique et renforcent, chez le lecteur, l’impression d’une histoire téléologique. Comment comprendre que l’auteur associe le sport scolaire sous la Troisième République et la ségrégation à Rio de Janeiro en 1904 comme manifestations d’une doctrine médicale raciale.
Le dernier chapitre sur le XXe siècle, Délires, démons, démocraties renforce hélas l’impression d’un raisonnement poussé à ses limites. Pour l’auteure « C’est à l’issue de la guerre que la race devient une notion populaire, durablement associée au sentiment national » (p. 304). Partant de la situation urbaine en Amérique, des villes où affluent une main-d’œuvre noire et pauvre qui ne parvient pas à la démocratisation et l’amélioration du niveau de vie, l’auteure évoque l’affaire des bonnes antillaises des années 1920 qui de fait semble une généralité française. Si au fil de la démonstration l’auteure cite les dénonciations des violences coloniales (Gide, Albert Londres) elle affirme néanmoins que tout dans l’entre-deux guerre n’est que délire raciste de la foule : Apartheid en Afrique du Sud, Ku Klux Klan. Même si quelques intellectuels au Brésil interrogent le concept de race, pour l’auteure, seuls les noirs, les indigènes, les colonisés peuvent le dénoncer ; on comprend mieux qu’elle semble, dans son avant-propos, s’excuser d’être une historienne blanche. La force de la démonstration induit que l’esclavage de la plantation atlantique qui a fait naître le racisme est la source lointaine à la fois des pogroms en Russie des années 1920, de l’invasion de la Corée par les Japonais et de la solution finale (p. 331-332).
Dans sa conclusion l’auteure reconnaît implicitement que sa lecture de l’histoire est faite selon la grille raciale ; elle en fait presque un manifeste politique « Alors, en finir avec la race pourrait devenir une proposition politique globale × […]qui pourrait inspirer de nouvelles règles dans notre rapport à l’environnement… » (p. 351).
Pour ce faire une autre idée de l’ouvrage : http://parolesdhistoire.fr/index.php/2020/02/12/89-lesclavage-et-ses-heritages-avec-aurelia-michel/
______________________________________
1Cit. P. 11
2Voir fichier joint extraits de manuels de premier et second degré
3Je respecte ici les choix calligraphiques de l’auteure
4Claude Meillassoux (1925-2005) était anthropologue, économiste, directeur de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), il a étudié les systèmes économiques des sociétés pré-capitalistes en utilisant les concepts marxistes d’infrastructure, de superstructure ou de matérialisme historique. Spécialiste de la Côte-d’Ivoire, il a notamment publié en 1992 chez L’Harmattan : Femmes, greniers et capitaux
5Alain Testart, L’institution de l’esclavage – Une approche mondiale, Gallimard, collection « Bibliothèque des sciences humaines », 2018 – certes cité en bibliographie
6Catherine Coquery-Vidrovitch, Éric Mesnard, Être esclave. Afrique-Amérique. XVe-XIXe siècle, La Découverte, 2019
7Cité p. 162