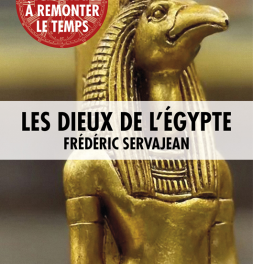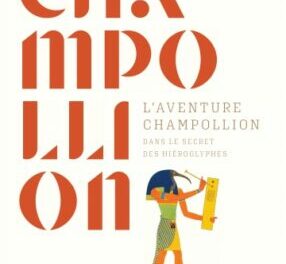Où placer la date de basculement de l’Antiquité à autre chose ?
La collection « Une année dans l’histoire » dirigée aux PUF par Florian Louis (1904. Genèse du XXe siècle) met en lumière dans de petits ouvrages la portée historique d’années « charnières, exceptionnelles ou ordinaires » mais jamais anodines.
Dans cet ouvrage stimulant et très accessible aux non-spécialistes du monde tardo-antique, Sylvain Destephen propose de repousser au milieu du VIe siècle la fin de l’Antiquité qu’on présenta longtemps comme le résultat en 476 d’un effondrement consécutif aux « barbares ». Pour cela, il n’a guère besoin de s’attarder sur le manque de pertinence de la date de 476 comme moment de rupture pour un monde centré sur la Méditerranée. Or, jusqu’à une date récente, les programmes de collège incluaient 476 – et 496 « baptême de Clovis (sic) » dans une liste de dates de repérage complétées chaque année jusqu’au brevet. En seconde, il s’agit de rappeler la division académique en quatre périodes incluant la date-clef 476, la consigne demeurant critique quant à un choix qui ne va pas de soi. Sylvain Destephen présente 542 comme date d’autant plus pertinente que 476 ne représente pas grand’chose. Ce faisant, cet historien n’en témoigne pas moins d’une grande et scientifique distance vis à vis des dates où certains voudraient que tout bascule.
La date de 476 comme chute de l’Empire romain est une invention de la Renaissance
Même si on a longtemps enseigné en collège que l’Empire romain continuait à l’est, le fait pour la Renaissance de l’avoir baptisé « empire byzantin » nuisait à l’idée d’une continuité en portant un regard exotiste sur « les Byzantins ». Tel manuel scolaire récent ne demande-t-il pas la couleur du cheval blanc d’Henri IV en adressant aux élèves la question : « Comment l’empereur Justinien se rattache-t-il à l’Empire romain ? ». C’est pourtant bien la continuité d’un empire progressivement décentré vers Constantinople qui ressort de la lecture de l’ouvrage de Sylvain Destephen, au moins jusqu’en 542. L’historien démontre ici que la date correspond à plusieurs ruptures majeures. Il rappelle par ailleurs que la destitution en 476 de Romulus « Augustule », héritier d’un pouvoir depuis longtemps symbolique, relève de l’anecdote sans résonance politique jusqu’à ce que la Renaissance l’exhume pour la transformer en événement fondamental. Si on ne dépose pas l’empereur avant 476, c’est bien pour préserver un symbole de romanité justifiant les pouvoirs des royaumes en place. La légitimité impériale romaine n’est d’ailleurs pas remise en cause puisque les insignes impériaux sont renvoyés à Constantinople sans que cela constitue la nouvelle incontournable du moment. Le livre intègre évidemment les travaux de Bruno Dumézil (il figure en remerciements avec Sylvie Joye et d’autres parmi les relecteurs et relectrices), qui a largement balayé l’image caricaturale traditionnellement donnée des Mérovingiens, en particulier leur rapport à la romanité. A ces Francs, Justinien abandonne l’autorité sur la Gaule, faute de parvenir à reconstituer l’empire.
Les clefs du basculement : peste, christianisme, Perses, langue grecque …
En six chapitres dynamiques, l’ouvrage aborde la question du christianisme et de son organisation dans le contexte impérial d’une utopie théocratique, les réformes juridiques (souvent résumées dans les manuels à une ligne et un document sur le Code Justinien), la crise démographique provoquée par la pandémie de 542 et les impératifs géopolitiques contraignant le pouvoir. Certaines des conséquences économiques de la peste, notamment un meilleur accès aux ressources du monde d’après, rappellent ce qu’on connaît de l’après-peste noire du XIVe siècle. La pandémie joue un grand rôle dans le moment de rupture, aussi bien dans la disparition de personnalités-clefs – comme le juriste Tribonien – que dans les limites qu’elle impose aux choix stratégiques de Justinien. L’empereur est en effet contraint de trancher entre son projet de conquête de l’Occident et la nécessité de maintenir une force à même d’affronter les Sassanides. L’auteur reste conscient du risque de biais. Le simple fait de poser 542 en année-charnière permet toujours de trouver un personnage décédé en 542 ou un autre événement pour le confirmer. L’ouvrage éclaire aussi le profane sur la question du basculement linguistique de l’État et de ses juristes, passant du latin au grec vers 530, dans un empire où, le grec, langue de culture, cohabite aussi avec le copte et le syriaque.
Renouveler le regard profane sur l’Arabie du VIe siècle
Les enseignants d’histoire ont en principe une vague connaissance d’un contexte général de l’Arabie du VIe siècle marqué par la situation des routes commerciales confrontées au conflit entre Empire romain d’Orient et Empire perse sassanide. L’ouvrage offre un point plus intéressant et plus incarné sur cette situation de la péninsule au regard de ce qui se joue plus au nord. Dans le chapitre pertinemment intitulé « La guerre mondiale », l’auteur traite d’un espace situé entre Caucase, Mésopotamie et mer Rouge. Il en éclaire les logiques politiques internes poussant à l’affrontement entre Empire romain et Empire perse. On en tire une compréhension synthétique de ce qu’a pu être le contexte monothéiste de l’Arabie et de la Corne de l’Afrique avant le VIIe siècle, contribuant ainsi à sortir cet espace d’un regard exotiste.
L’ouvrage est bien écrit, chose appréciable de nos jours. Comme 1904, il devrait figurer à la formation personnelle d’un enseignant chargé d’aborder ces périodes dans le secondaire. On pourra ainsi présenter le milieu du VIe siècle comme le véritable basculement de l’Antiquité vers autre chose.