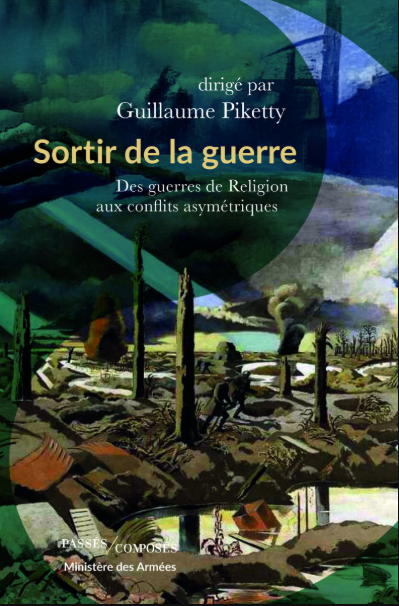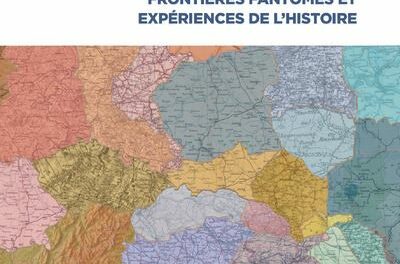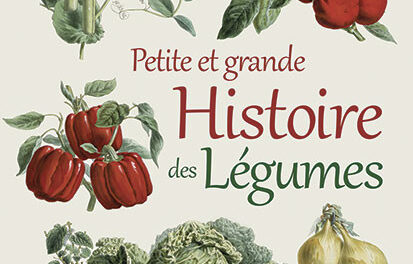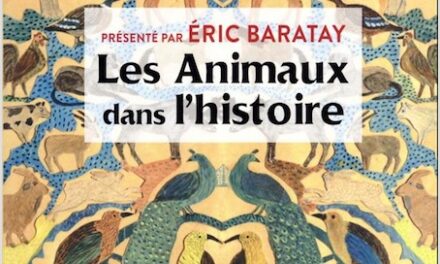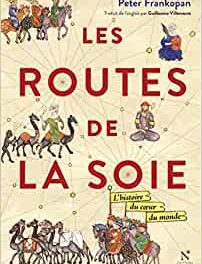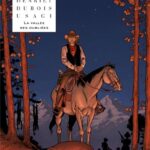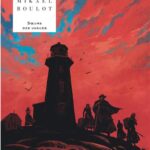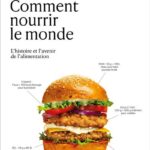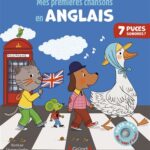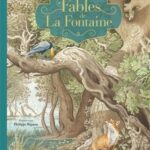Pour cet ouvrage proposé aux éditions Passés Composés, ayant pour titre Sortir de la guerre. Des guerres de Religion aux conflits asymétriques, Guillaume Piketty a réuni un collectif de 11 historiens et historiennes parmi lesquels : Nicolas Leroux, Mary Lindemann, Benjamin Deruelle, Bernard Guainot, Walter Bruyère-Ostells, Benoît Pouget, Brian Matthew Jordan, Clémentine Vidal-Naquet, Julie Le Gac et enfin Victor Lauzon et Elie Tenenbaum.
Neuf périodes retenues et une grille d’analyse commune
Sortir de la guerre – des guerres de religion aux conflits asymétriques est divisé en neuf chapitres, chacun centré sur neuf guerres et neuf périodes d’après-guerre, allant de l’époque moderne à nos jours avec pour point de départ les guerres de religion en Europe. Par conséquent, l’Antiquité et l’époque médiévale n’ont pas été retenues.
Le lecteur remarquera assez vite que les chapitres suivent une trame relativement similaire en s’intéressant à la réintégration des combattants dans la société, à la mémoire du conflit, à la question des réparations, mais aussi, dans une certaine mesure, à la préparation de la prochaine guerre. Pour résumer le propos en nous appuyant sur le découpage du chapitre trois, il s’agit à chaque fois, pour chaque sortie de guerre, de voir comment les sociétés réintègrent, réparent, réforment, réglementent et enfin mémorisent le conflit dont elles viennent de sortir. Cette trame commune sur le fond aux différents chapitres pourrait donner une impression de répétitions, mais ce serait occulter trop rapidement les spécificités propres à chaque période de sorties de guerre que les auteurs mettent en lumière.
L’introduction débute par la scène du film The Railway Man. Finley, qui fut prisonnier des Japonais durant la Seconde Guerre mondiale, exprime en quelques mots son ressentiment : « War leaves a mark. » Et c’est bien à ces traces de la guerre que les auteurs vont faire référence au cours des neuf chapitres proposés. En effet, comme le souligne l’introduction, si en règle générale l’étude des conflits a plutôt, sur le plan historiographique, privilégié une approche basée sur les trois temps constitués par l’avant-guerre – la guerre – l’après-guerre, c’est désormais la période comprise entre deux guerres qui retient l’attention. La sortie de guerre est envisagée en général durant la guerre elle-même, donc bien avant la fin officielle des hostilités. Elle débute avec un arrêt progressif des combats et s’accompagne parfois, comme le montre le chapitre consacré à la période après 1945, de moments de réflexion sur la période de « l’après ».
C’est aussi une période qui est marquée par la porosité entre le temps de la guerre et le temps de la paix, avec des processus de retour plus ou moins longs allant des mouvements de populations civiles au rapatriement des soldats et des prisonniers de guerre du champ de bataille à leur domicile (s’ils en ont un). La question de la réinsertion des anciens combattants, qui se pose dès l’époque moderne, accompagne des mouvements de réformes et des transformations diverses. Enfin vient la troisième temporalité : la démobilisation culturelle marquée par l’abandon de la violence, la montée du pacifisme voire la réhabilitation de l’adversaire, auxquelles il faut joindre les questions judiciaires et les enjeux liés aux morts et aux deuils. Très vite, les multiples enjeux liés aux mémoires des guerres émergent comme problématique. Et il arrive que, parfois, les traces laissées par la guerre soient trop profondes pour que la période de paix ne finisse par favoriser la reprise des hostilités à court ou moyen terme, démontrant par là même le lien unissant nécessairement guerre et paix. Ce sont ces trois temps que les auteurs traitent pour chacune des périodes envisagées.
Les sources consultées ont été extrêmement nombreuses : archives diplomatiques, archives des armées, des administrations, de la justice, des services de police, archives du monde médical, de l’entreprise, mais aussi documents privés tels que lettres, ou encore mémoires rédigés par les anciens combattants.
Des guerres de Religion …
Le chapitre un, intitulé « Vivre avec l’hérétique, sortir des guerres de Religion dans l’Europe du XVIe siècle » est rédigé par Nicolas Leroux et nous ancre dans la réalité de la sortie des guerres de religion, étape majeure dans le processus de construction politique des États européens. La paix d’Augsbourg a constitué une étape essentielle dans la distinction entre politique et religion. Les autorités civiles renoncent à la réunion spirituelle pour assurer la paix, le prince ne doit plus chercher à forcer les consciences, schéma que l’on retrouvera en France avec les édits de pacification. L’idée était là de « sortir d’une guerre sans fin, où les violences furent nombreuses ». L’auteur prend soin justement de revenir sur cette fameuse Paix des dames (on peut regretter que l’expression n’ait pas été employée dans l’ouvrage ni qu’elle soit réellement analysée) qui aboutit à l’édit de pacification signé à Amboise le 19 mars 1553, et qui servit de modèle à tous les autres édits suivants en accordant la liberté de culte à la religion dite réformée. L’auteur aborde également la question des Pays-Bas et s’interroge sur les « grammaires de la paix ».
Le chapitre deux consacré à « la grande guerre allemande et ses conséquences, 1648-1700 » nous est proposé par l’historienne Mary Lindemann. Elle débute avec le rappel de la défenestration de Prague en mai 1618, point de départ de la guerre de Trente Ans marquée par des violences et une durée exceptionnelles. Comme le note l’auteur, cette sortie fut donc déterminée par les dommages causés par le conflit et le retour à la paix fut différent selon les contextes et les zones géographiques concernées. Les questions liées aux destructions et, par extension, à la reconstruction, de la perception des impôts, plus ou moins difficile selon l’endroit, et des nombreux acteurs mobilisés dans ce retour à la paix sont développées. La question du repeuplement et de la démographie au sens large est posée, les contemporains ont d’ailleurs conscience de la saignée démographique et de la fragilisation de la santé mentale des individus engendrée par cette guerre. Les traumatismes psychologiques émotionnels sont également abordés, même si une évaluation chiffrée reste à établir.
Le chapitre trois, « l’impossible sortie de la guerre ou l’instauration d’un régime permanent de la guerre, du règne de Louis XIV aux guerres de la Révolution », nous est proposé par Benjamin Deruelle et Bernard Guainot et traite des sorties de guerres de la fin du 17ᵉ – début 18ᵉ siècle, qui sont bien documentées, d’autant que, pour cette période, la question de la sortie de guerre reste le parent pauvre de l’historiographie moderne en comparaison des deux guerres mondiales. C’est pourtant une période transitoire où guerre et paix s’entrelacent, comme le démontrent très largement les deux auteurs. En effet, de 1660 à 1795, est en réalité une époque où les guerres se succèdent (tout comme d’ailleurs au XIXᵉ siècle, comme le montre plus loin le chapitre 5), et où les traités de paix amènent un équilibre précaire durant lequel on se prépare avant tout au prochain conflit. Comme l’affirmait le juriste suisse Emer de Vattel : « le traité de paix ne peut être qu’une transaction ». 1795 constitue une rupture avec une différence de degré dans la guerre engendrée par les guerres napoléoniennes.
Mais cette période est centrale, car elle illustre aussi les préoccupations des sociétés et des États qui émergent et se développeront par la suite. En effet, il s’agit aussi d’abord tout d’abord de réintégrer : la sortie de guerre est un temps de retrouvailles entre le monde civil et le monde militaire dont les effectifs ont connu une hausse sensible sous Louis XIV, puisque, entre 1672 et 1688, ils passent de 100 000 à 430 000 combattants pour la période correspondant à la guerre de la Ligue d’Augsbourg (1688-1697). La fin des combats est celle d’un difficile retour à la vie des soldats démobilisés, dont la réintégration dans la société dépend largement de la situation d’avant-guerre. Leur réinsertion s’avère problématique, comme le montrent notamment les registres de l’hôtel des Invalides qui recensent les blessures et les différents traumatismes des 110 000 vétérans accueillis sous conditions entre 1670 et 1791. Mais l’action de l’État relève avant tout de la grâce royale, le roi accordant les primes de démobilisation, les pensions et charges à des personnes choisies. Certains obtiennent une place de frère laïque dans une institution ecclésiastique ou de garde dans une frontière. En parallèle, l’hôpital de Bicêtre destiné à accueillir les soldats estropiés est fondé par Louis XIII et Richelieu. Une autre grâce royale consiste en 1715, par exemple, à exempter de la taille les anciens combattants sous condition de services. Mais une partie des démobilisés alimente aussi les classes dangereuses marquées par l’errance, la délinquance et l’alcoolisme.
Il s’agit aussi de réformer : à côté des démobilisés, des troupes permanentes sont créées afin de garantir le maintien de l’ordre et d’empêcher les excès observés durant la guerre de Trente Ans. À la fin de la guerre de Dévolution en 1668, Louis XIV s’engage dans l’organisation permanente du domaine militaire, ce qui est aussi une manière de préparer la prochaine guerre. De nombreuses ordonnances sont prises en ce sens entre 1668 et 1669 à la fois dans la marine et dans l’armée terrestre, signe qu’un retour sur expérience de la guerre (le retex) doit désormais nourrir une amélioration globale de l’artillerie.
Réparer est le troisième axe : bien sûr, il est question des destructions également déjà de cette époque, puisque les guerres ont été marquées par des destructions massives de certaines villes, comme par exemple la ville d’Ath dans le Hainaut en 1745 ou Louisbourg au Québec lors de la guerre de Sept Ans en Amérique du Nord. Réparer soulève également la question des impôts censés financer les guerres, ces impôts se prolongeant très souvent bien après la fin des hostilités. Ce fut le cas notamment de la capitation créée en 1695 pour faire face aux besoins de la guerre de la ligue d’Augsbourg, impôt qui fut supprimé en 1698 puis finalement rétabli en 1700. Payée au départ par tous, y compris la haute noblesse, très rapidement son paiement fait l’objet d’un très fort mécontentement dont les parlements se font l’écho. La question fiscale reste centrale au sortir de la guerre de Sept Ans et pèse jusqu’en 1788 à la veille de la Révolution française.
Enfin, il s’agit aussi de réglementer : les conflits du XVIIIᵉ siècle relèvent de la guerre dite réglée. Une réflexion s’effectue sur la recherche d’une définition du droit de conquête au-delà de la coutume. Suivant la pensée du juriste suisse Jean-Jacques Burlamaqui, Principes du droit naturel publié en 1747, une idée fait son chemin selon laquelle la conquête ne vaut que si elle se fait avec justice et recherche du consentement du peuple occupé. De son côté, Emer de Vattel publie Le droit des gens en 1758. Il engage quant à lui une réflexion sur l’état d’occupation après une guerre. Il pose la question des droits du vainqueur en matière de dédommagement des frais de guerre, qui doit être effectué avec justice sinon, selon lui, il existe un droit de résister de la part des populations vaincues. Enfin, la question de la détention des prisonniers de guerre est posée et on assiste à une première tentative de mettre en place une éthique, idée pourtant déjà présentée chez Grotius en 1625.
Mémoriser devient une préoccupation : à travers le Te Deum se développe tout un cérémonial militaire et des cérémonies funéraires publiques, mais à destination unique des grands serviteurs de la monarchie. Le rituel est fixé sous Louis XIV, qui crée en parallèle l’ordre militaire de Saint-Louis en 1693. C’est dans ce contexte que la querelle des héros subalternes est ouverte par Voltaire avec le poème de Fontenoy qui met en valeur les actions des simples soldats. Les mémoires de guerre qui émergent participent à l’émergence du nationalisme en France et en Grande-Bretagne dès le XVIIIe siècle, ce qui se traduit aussi par l’apparition du tourisme sur les champs de bataille pratiqué en premier par les soldats. Une conscience émerge, des lieux de mémoire sont érigés dès le XVIIIe siècle sur les champs de bataille avec des monuments et des colonnes commémoratives comme celle de Rossbach en 1757, puis abattue en 1808 après la bataille d’Iéna. Sous la Ire République, des initiatives similaires ont lieu avec le projet suggéré par le rapport de Daumesnil en 1796 de construire dans chaque commune une colonne où seraient inscrits le nom des citoyens morts pour la patrie.
… à la sortie des guerres napoléoniennes
Le chapitre quatre proposé par Walter Bruyère-Ostells traite quant à lui d’« une sortie des guerres révolutionnaires et impériales incomplètes (1814/15–1848/49) : la « société des États » plutôt que la société des nations », autrement dit des sorties de guerres napoléoniennes. La sortie de guerre est ici surtout une gestion de crise sociale et politique qui peut se traduire, dans le cas présent, par des campagnes militaires ayant pour but des opérations de maintien de l’ordre jugées nécessaires. Plusieurs échelles et critères d’analyse sont possibles, allant de l’échelle locale à l’échelle continentale, chacune s’accompagnant de mutations profondes et de prolongements dans des zones de conflit situées sur d’autres continents, et en priorité l’Amérique latine. C’est dans ce contexte que se déroule le congrès de Vienne, qui est à la recherche d’un équilibre européen censé garantir une sécurité collective. Il est ici intéressant de relever que le congrès repose sur l’utilisation de la diplomatie, considérée comme le seul outil valable de cette sortie de guerre. 216 États sont représentés, mais seules deux séances plénières sont finalement organisées, la majorité du travail étant accomplie par « la commission des quatre » composée de la Russie, de la Prusse, de l’Autriche et de la Grande-Bretagne, soit les principaux grands vainqueurs de Napoléon. Comme l’a souligné l’historienne Jennifer MITZEN, la sortie des French wars se caractérise avant tout par la mise en place d’une gouvernance internationale, signant ainsi le retour en force des diplomates qui se professionnalisent et prennent ici le pas sur les militaires qui avaient alors dominé la scène jusqu’alors, dans la mesure où ils ont parfaitement conscience que la menace révolutionnaire peut être un facteur de troubles sociaux et donc d’un retour possible à la guerre. La Sainte-Alliance se définit donc avant tout comme une protection mutuelle qui supervise la sortie de guerre en mettant fin à plusieurs conflits mineurs comme en Italie et en Espagne dans les années 1820-1823.
La période est marquée par la montée en puissance des occupations garanties comme instrument de sortie de guerre, ce qui justifie et explique l’occupation de la France de 1814 à 1818, garantissant ainsi par là même l’absence de reprise d’activité révolutionnaire. Cela passe également par le démantèlement des réformes françaises, mais qui n’est pas systématique. Ainsi le Code civil reste appliqué en Suisse jusqu’en 1912.
Enfin, le retour à la paix passe également par la libération des prisonniers et leur gestion. Entre 160 000 et 200 000 soldats français captifs en Russie sont libérés, et, comme pour la période précédente, leur retour pose la question de leur réinsertion et le versement de pensions. Certains sortent de la guerre traumatisés, comme l’attestent une nouvelle fois les archives des Invalides, tandis que d’autres sombrent dans la marginalité et les activités révolutionnaires. Cependant, un esprit « ancien combattant » émerge et marque certains espaces géographiques qui traduisent cet esprit, tels que les veillées villageoises ou les cafés, tandis que l’entraide privée entre ces anciens combattants se développe.
La période 1789–1815 a été si intense qu’un besoin de raconter cette période se fait jour, en particulier au moment de la mort de Napoléon en 1821. Les officiers mettent par écrit leurs souvenirs et contribuent par la même à l’établissement de la légende napoléonienne. Ils offrent des récits incluant la notion de défaite glorieuse qui masque la réalité des traumatismes vécus. Cette nostalgie est entretenue par les romantiques tels que Victor Hugo et culmine avec le retour en 1840 des restes de Napoléon organisé par Louis-Philippe qui, ainsi, peut politiquement capitaliser sur cette légende dorée qui s’est installée. Le Second Empire, bien sûr, n’est pas en reste avec, en 1857, la création de la médaille de Sainte-Hélène.
Ainsi, si la Sainte-Alliance parvient à installer une cohérence dans la gestion de la paix et de la sécurité en Europe, elle ne gère pas pour autant la question de la réinsertion des soldats démobilisés et la mémoire des guerres révolutionnaires. Les idées continuent de circuler non seulement en Europe, mais dans le monde, puisque l’on observe des flux migratoires entraînant des révolutionnaires de l’autre côté de l’Atlantique entre 1815 et 1848. Les vétérans s’engagent dans des armées officielles, des sociétés secrètes conspirationnistes, certaines débouchant sur des insurrections à l’image de celle organisée par les Carbonari. Ce mouvement assure également une transmission de la mémoire des actions révolutionnaires passées des vétérans aux jeunes générations, comme en atteste l’exemple de Mazzini. L’Amérique devient un espace attractif dès 1815, et c’est ainsi qu’une communauté bonapartiste se crée autour de Joseph Bonaparte à Philadelphie, et que certains anciens combattants deviennent des notables qui accueillent bien volontiers les compétences militaires venues d’Europe dans l’espace américain afin de faire face à l’Espagne. C’est le cas, par exemple, d’Antonio Archos, qui a servi en premier en Espagne sous Joseph Bonaparte et qui devient directeur de la première école d’officiers au Chili. Cette sortie de guerre en Europe a pour conséquence également une intensification des combats. La radicalité de ces derniers provient également de la violence de l’exil, ce qui rend par conséquent les sorties de guerre locales extrêmement difficiles.
L’année 1830 est marquée par une nouvelle flambée révolutionnaire et la construction d’une opinion publique transnationale européenne. Mais 1830 est aussi marquée par une forme de compromis qui s’établit, comme le montre le cas de l’indépendance de la Grèce : la monarchie qui se met en place repose à la fois sur une dynastie conservatrice, mais aussi sur une forme constitutionnelle issue des aspirations et des revendications libérales. Elle illustre bien que les crises sont finalement jugulées par la négociation et le compromis, mais l’absence de remédiation sociale continue à nourrir les aspirations libérales (Adam Zamoyski).
La Sainte-Alliance un instrument de paix ?
Le chapitre 5 intitulé « Les nations européennes entre guerre et paix » nous est proposé par Benoît Pouget. Consacré à la période 1850–1914, l’historien nous démontre avant tout que cette dernière, souvent considérée comme une fenêtre de paix comprise entre la guerre de Crimée et la Première Guerre mondiale, est, dans les faits, marquée par des conflits et un processus d’extension des brutalités. La carte jointe au chapitre le démontre très bien. Ainsi, entre 1848 et 1870, ce ne sont pas moins de 11 conflits qui redessinent les frontières et les rapports de force entre États et nations. La logique de Vienne était une paix conçue comme l’absence de violence généralisée entre les États. Elle reposait sur l’activité diplomatique et s’était exprimée via un congrès de paix : le schéma est repris par la suite avec, par exemple, le traité de Paris qui fait suite à la guerre de Crimée, qui assure au passage l’hégémonie de Napoléon III et le maintien des ambitions russes. Le lecteur relèvera également la toute première commission européenne pour la gestion du Danube, pour lequel un principe de libre circulation est établi. Cependant, elle ne peut pas contenir les ambitions des États-nations, en particulier celle de la Prusse. Pour Bismarck, les rivalités se règlent avant tout par le fer et par le sang, puisque, selon lui : « la guerre fait l’État », comme le démontre la guerre de 1870. La paix devient précaire du fait d’une Allemagne qui n’a que faire de la concertation.
La guerre de 1870 a un coût certain pour la France qui pèse très fortement sur la défaite, et on assiste ainsi à une hausse des impôts en France entre 1871 et 1873. Elle traduit aussi une entrée dans la guerre moderne qui se traduit par une hausse des pertes et des traumatismes provoqués par la violence des combats, ce dont les contemporains ont parfaitement conscience, comme le démontrent plusieurs initiatives. Les pathologies mentales et la psychiatrie sont intégrées progressivement au sein du service médical des armées, et, à partir de 1907, les névroses de guerre commencent à porter un nom. Après la défaite de Sadowa, la Prusse procède à une refonte de l’accompagnement médical des soldats, tandis que la bataille de Solférino est marquée par la fondation de la Croix-Rouge par Henri Dunant. Ces initiatives humanisent les guerres modernes, tandis qu’un courant pacifiste émerge, porté par plusieurs acteurs, comme le montre entre autres la création du prix Nobel de la paix en 1900. L’élaboration de nouvelles normes en matière de droit international et de nouveaux concepts émergents aboutissant à la convention de Genève est une codification de la guerre rendue nécessaire par la brutalisation des conflits.
Cette période est également marquée par la question des soldats en eux-mêmes, leur démobilisation, leur reconnaissance et leur mémoire. C’est ainsi qu’en décembre 1855, on assiste à un défilé des vétérans de la guerre de Crimée à Paris, comme en atteste un tableau peint par Emmanuel Massé en France. En 1873, toujours en France, les espaces funéraires militaires passent sous la responsabilité de l’État, tandis que des monuments aux morts font également leur apparition, comme celui de Gisors en 1897.
Le retour à la paix est aussi un moyen de tirer des leçons d’une guerre pour préparer la suivante, et avant tout pour les anciens adversaires. Deux axes se développent dans cet ordre d’idées : d’une part, il s’agit d’accepter et de renforcer l’ordre nouveau issu de la guerre, et d’autre part, de bâtir ou de rebâtir des capacités pour le modifier. Ainsi, en France, après 1870, le ressentiment devient un puissant moteur largement exploité à tous les échelons de la société pour maintenir la mobilisation après la défaite, de Maurras à Gambetta, de l’extrême droite à l’extrême gauche. Il s’agit de tirer les enseignements du conflit perdu pour élaborer une nouvelle stratégie qui, bien entendu, se veut gagnante : on l’observe pour la Russie après la guerre de Crimée, mais aussi pour la France après 1870 : une enquête sur les causes de la défaite est réalisée par une commission parlementaire présidée par l’amiral Jouret Guy Berry, tandis que la formation militaire est repensée, et en premier lieu dans la marine avec le rôle joué par la Jeune École de Théophile Aube.
La guerre de Sécession, une sortie de guerre impossible ?
Le chapitre six, quant à lui, nous emmène de l’autre côté de l’Atlantique, aux États-Unis, avec la sortie de la guerre de Sécession, sans doute le conflit le moins connu de l’ouvrage, ce qui donne lieu à une lecture passionnante et éclairante pour le lecteur. Intitulé : « Sous l’emprise de la guerre : la persistance obstinée de la guerre civile américaine » Brian Matthew Jordan débute le chapitre avec la parade militaire organisée les 23 et 24 mai 1865 sur Pennsylvania Avenue à Washington et réunissant plus de 200 000 soldats de l’Union. Mais, loin d’être festif, le défilé se rapproche davantage de la marche funèbre que d’une célébration de la victoire. Le contexte ne s’y prête guère : plus que six semaines plus tôt, Abraham Lincoln a été assassiné. D’un côté, les Confédérés ont été vaincus dans une guerre, alors que leur engagement et leur cause étaient selon eux inspirés par la volonté de Dieu. C’est dans ce contexte que la réadaptation des soldats des deux camps est extrêmement difficile et qu’une nostalgie de la guerre s’exprime chez certains. Les cicatrices et les maladies chroniques sont vécues par beaucoup comme une métaphore de la guerre, et beaucoup ont le sentiment que de nombreuses questions n’ont pas trouvé de réponse. Des initiatives originales et inédites sont prises, comme des concours d’écriture de la main gauche pour 250 imputés du bras droit. Le besoin de témoigner est massif, comme en témoignent les très nombreux mémoires rédigés par les anciens soldats qui veulent ainsi donner des preuves de la guerre et livrer leur vérité, à l’exemple de Daniel Eldredge qui rédige en 1867 un mémoire de 600 pages manuscrites. Cette volonté de traduire la vérité de la guerre dans les livres est le signe, pour eux, que la guerre n’est pas complètement finie.
L’engagement dans le conflit s’était effectué par conviction chez la grande majorité des soldats, mais la déception est au rendez-vous au lendemain de la guerre lorsque le constat est fait selon lequel le système esclavagiste n’a pas été aboli dans les États du Sud. En conséquence, l’auteur affirme et démontre qu’après la guerre de Sécession, il n’y a pas de réelle paix, mais une guerre qui a pris plusieurs formes inédites avec l’apparition des émeutes raciales et la constitution du Ku Klux Klan en 1865. D’ailleurs, cette sortie de guerre n’est probablement toujours pas réalisée, puisque, comme le rappelle l’auteur, lors de la prise du Capitole le 6 janvier 2021, le public a pu relever la très forte présence de l’iconographie des Confédérés.
Sortir des deux guerres mondiales
Le chapitre sept, intitulé « une si longue sortie de guerre. Première Guerre mondiale » nous est proposé par Clémentine Vidal-Naquet, le lecteur revient sur un terrain qu’il maîtrise davantage.
Un conflit mondial suppose une sortie de guerre mondiale, donc un processus long, pas forcément achevé, comme en témoignent les découvertes régulières d’obus et de corps de soldats dans le Nord de la France au XXIe siècle. L’auteur estime d’ailleurs qu’il faudrait plutôt parler des sorties de guerre au pluriel, car elle s’est effectuée selon des modalités différentes selon les lieux. En effet, la Russie, qui sort de la guerre en 1917, est marquée par une poursuite des violences avec la révolution qui éclate la même année. Pour la Grèce, ce serait une chronologie s’étendant de 1912 à 1922 qu’il serait plus judicieux d’adopter, tandis que la chronologie des armistices et des traités s’étend sur plusieurs années. La reconfiguration des frontières est telle que le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est devenu impossible à respecter. C’est une paix ordonnée qui ne fait pas l’unanimité, entre, d’un côté, l’Allemagne qui estime la paix humiliante au point d’évoquer le fameux diktat de Versailles, l’Italie qui parle d’une victoire mutilée, tandis que John Maynard Keynes, dès 1919, évoque les conséquences désastreuses à moyen long terme d’une paix qu’il qualifie de « carthaginoise » dans son ouvrage intitulé Les conséquences économiques de la paix.
Des actes de représailles contre ceux qui sont suspectés d’avoir collaboré avec l’ennemi ne sont pas rares. Ainsi, on assiste à la tonte de « femmes à boches » en Belgique, tandis qu’en Allemagne, où l’occupation de la Rhénanie est mal vécue à juste titre, celles qui sont suspectées de sympathie envers les Français deviennent des cibles. Ce sont des guerres après la guerre qui sont par conséquent observables, avec pas moins de 4 millions de morts enregistrés entre 1918 et 1923. Cet état de fait permet de comprendre le concept de brutalisation des sociétés qui a été élaboré par Georges Mosse. En effet, la guerre a marqué les sociétés sur deux aspects, avec d’un côté les soldats mutilés et de l’autre les paysages soumis aux besoins de la guerre et ravagés durablement par cette dernière. En France, ce sont 3 millions d’hectares transformés en champ de bataille qui sont devenus impropres aux cultures et pollués en profondeur. Suivant l’observation du géographe Albert Demangeon, la guerre est bien un cataclysme qui a tout renversé.
Dans la continuité des périodes précédentes, le tourisme de guerre se développe très fortement et prend la forme de pèlerinages, de promenades curieuses, de lieux de recueillement…
Les soldats démobilisés rentrent chez eux selon des modalités variables selon les pays. En France et en Italie, ce sont des retours par classe d’âges qui sont d’abord opérés. En Grande-Bretagne, les soldats reviennent en fonction des impératifs économiques du pays. Enfin, reste le cas des soldats prisonniers : une partie est retenue captive par les états qui les utilisent comme main-d’œuvre et certains ne rentrent finalement qu’en 1920, voire en 1922 seulement. Cet état de guerre qui perdure finit par alimenter une forme de mécontentement jusqu’en Inde, puisque le massacre d’Amritsar en avril 1919 a pour origine le mécontentement local contre les mesures d’urgence prises pendant la guerre et qui se poursuivent au-delà de la fin du conflit.
Être démobilisé signifie également quitter sa tenue de soldat pour retrouver un quotidien, alors que, dans le même temps, la guerre a transformé durablement les hommes physiquement et/ou moralement. Les travaux des historiens Antoine Prost et Angel Alcalde montrent un désir de reconnaissance très vif marqué par la multiplication des défilés, des cérémonies et des remises de médailles. Mais la prise en charge des anciens combattants est variable selon les États. Au Royaume-Uni, elle reste très limitée et le système repose quasi exclusivement sur la philanthropie. En France, c’est l’inverse avec la loi votée en 1919. Mais la réinsertion est également rendue difficile par la crise économique des années 20 qui précarise les plus fragiles et, en tête, les anciens combattants.
Les rapports hommes-femmes ont également changé. Certains pays accordent le droit de vote à ces dernières, comme le Royaume-Uni, l’Angleterre, l’Allemagne ou la Pologne, tandis qu’en France, il faudra attendre encore quelques années. Le retour à l’intime est difficile, voire impossible, pour certains. C’est ainsi qu’on assiste à une hausse des divorces en Angleterre, au Canada, en Belgique et en France. Ainsi, en France en 1913, 12 300 demandes de divorce étaient déposées contre 29 100 en 1920. Les hommes sont devenus les principaux demandeurs, avec pour cause principale l’adultère réel ou supposé de l’épouse durant la guerre.
Enfin, c’est également le temps du deuil : la guerre a été marquée par la mort de masse. Certes les soldats avaient anticipé, et nombreux sont ceux qui, avant de partir pour le front, avaient réglé leurs affaires auprès des notaires et formulé des recommandations dans leur courrier en cas de décès. Le retour à la paix est aussi marqué par une hausse des dépressions mélancoliques et des morts précoces, comme celle d’Émile Durkheim, mort en novembre 1917 à 59 ans, quelques mois après la mort de son fils André sur le front. Sortir de la guerre, c’est aussi faire un deuil, parfois sans corps et sans sépulture pour se recueillir, et parfois, il s’avère impossible à dépasser.
Enfin, le chapitre huit proposé par Julie Le Gac et intitulé « Sortir des ténèbres ». Seconde Guerre mondiale » permettra au lecteur de refaire le point sur une période largement abordée en classe par les professeurs et les élèves. Cette mise au point scientifique permettra notamment de remettre en perspective la fameuse idée selon laquelle 1945 fut une « année zéro », car la sortie de guerre fut beaucoup plus élastique dans sa temporalité que ne le suppose cette expression. Les nouveaux équilibres mondiaux, qui se traduisent par un règlement du conflit, s’ébauchent progressivement à partir de 1943. La charte de l’Atlantique en 1941 aboutit à la création de l’ONU avec la charte de San Francisco le 26 juin 1945. Les accords de Bretton Woods en 1944 redéfinissent le système monétaire international, tandis qu’on assiste à une redéfinition des relations impériales et surtout à la fragilisation des empires coloniaux qui débutent avec les massacres de Sétif et de Guelma le 8 mai 1945 et la proclamation de l’indépendance de l’Indonésie le 17 août 1945. Le premier défi fut au fond, finalement, faire cesser le chaos des peuples et des misères. Juger les responsables de guerre, refaire société deviennent des mots d’ordre dont la concrétisation suit des modalités différentes selon les États, tandis que reviennent les survivants de la Shoah dans des conditions dramatiques.
Enfin, le chapitre neuf proposé par Victor Louzon et Elie Tenenbaum et intitulé « Des guerres sans fin ? Sortir des guerres depuis 1945 » propose un exercice difficile en tentant une réflexion sur les sorties de guerre récentes à l’échelle mondiale, et ce en dépit des difficultés dont ils ont parfaitement conscience. Mais, comme il le rappelle, les sciences sociales ont eu plutôt tendance à réfléchir aux situations de guerre et de conflits et non à la paix en elle-même. Mais de nombreuses régions du monde présentent des situations bien différentes de celle de l’Europe et du monde occidental en général et, par conséquent, l’exercice se tente. Les auteurs se proposent donc de revenir sur le processus de cessation des hostilités en s’appuyant par exemple sur le conflit afghan qui s’est étendu entre 2000 et 2021, la guerre des Malouines en 1982 ou encore par exemple la guerre de Corée au début des années 50. Un point intéressant sur le rôle des acteurs non étatiques et en particulier du Vatican intéressera à plus d’un titre le lecteur, même si l’on aurait souhaité un développement un peu plus conséquent sur le sujet. Les exemples sont extrêmement nombreux (les FARC en Colombie, le Kosovo, le Cambodge…), la réflexion s’étend à la question de la justice et des mémoires de guerre avec un point notamment consacré au tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, et trace par là même des perspectives utiles au professeur de lycée.
Une mise au point scientifique incontournable pour le professeur de lycée
En effet, et nous conclurons par là, cet ouvrage dirigé par Guillaume Piketty proposé par la maison d’édition Passés Composés en collaboration avec le ministère des Armées s’avère être un atout précieux pour le professeur de spécialité HGGSP de terminale amené à traiter de la guerre de la paix dans son programme. Plus largement, il permettra de mettre à jour les connaissances scientifiques de tout professeur ayant en charge les classes de première et terminale générale où les conflits font partie de la colonne vertébrale des programmes.