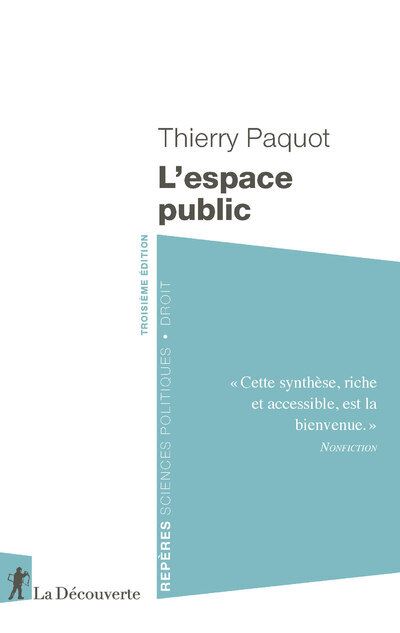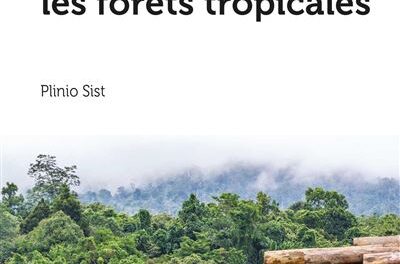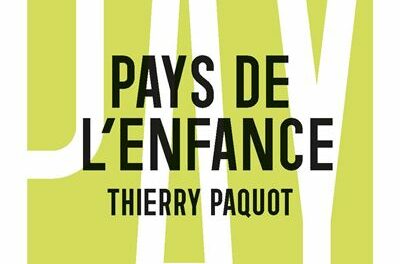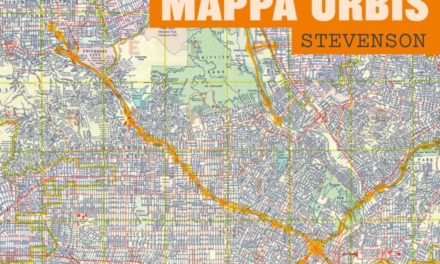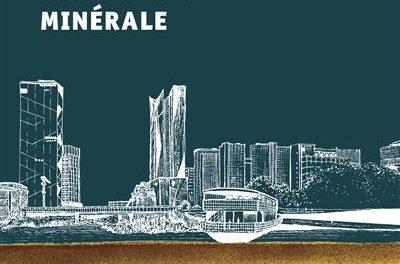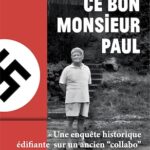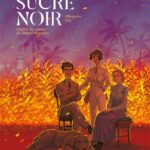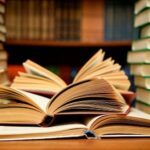Thierry Paquot, philosophe de l’urbain, participe depuis plus de trente ans aux débats sur la ville, l’architecture et l’urbanisation. Il dénonce dans ses écrits l’urbanisme de l’ère productiviste et propose des alter-architectures au nom de l’écologie existentielle.
L’ouvrage présenté ici est la troisième édition d’un écrit publié à La Découverte en 2009, dans la collection « Repères ». Cette collection, qui a fêté l’an passé ses quarante ans d’existence, propose sous un format de poche et pour une somme modique, des synthèses rigoureuses sur le plan scientifique, tout en restant très accessibles, rédigées par des chercheurs et des spécialistes reconnus en économie, sociologie, science politique, histoire et philosophie politique.
Dans cette synthèse, Thierry Paquot revient sur la définition d’espace public qui, pris au singulier, désigne la sphère du débat politique, la publicité des opinions privées. Au pluriel, les espaces publics correspondent au réseau viaire, rues et boulevards, places et parvis, parcs et jardins, bref à toutes les voies de circulation ouvertes au public, dans les métropoles comme dans les villages urbanisés. Les deux espaces relèvent de la communication.
À travers les cinq parties de son texte, Paquot nous emmène de l’espace public tel qu’il a été défini en 1961 par Habermas aux espaces publics, lieux à ménager et à aménager dans l’espace urbain. Dans L’Espace public. Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise, le philosophe allemand Jürgen Habermas (né en 1929) appelle « espace public » la sphère intermédiaire entre la vie privée de chacun et l’État monarchique qui affectionne le secret, l’arbitraire et la délation. Cet « espace public » comprend les salons, les loges maçonniques, les académies, les sociétés savantes, les regroupements philanthropiques, les clubs, les cafés, les journaux… L’espace public habermassien, conclut Paquot, relève de ce John Locke et Jean-Jacques Rousseau nomment la « société civile » et qui se doit de contrebalancer le pouvoir de ceux qui contrôlent l’État.
Lorsque Paquot entreprend de dessiner les lieux de l’espace public, à savoir les journaux, les cafés…, il montre que ces lieux accompagnent l’urbanisation et contribuent à propager des valeurs de modernisation. « Les journalistes et autres contributeurs sont des citadins qui, de fait, valorisent l’esprit de la ville et l’introduisent en province et dans les campagnes. » (p.35) La presse joue alors un rôle crucial dans l’homogénéisation d’un univers mental privilégiant les valeurs urbaines.
Après avoir décrit comment, depuis le XVIIIe siècle, l’urbanisation organise le système viaire des villes, aménage des places et des espaces verts, lieux de rencontre et d’échanges, l’auteur en arrive à la nouvelle définition d’espace public. À partir des années 1980, de plus en plus de professionnels (architectes, urbanistes, sociologues…) utilisent l’expression espaces publics comme synonyme de réseau viaire, de voirie. Michel Lussault, dans le Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, expose comment un stéréotype est né à la croisée de la géographie et d’une certaine interprétation de l’ouvrage de Habermas, faisant de l’espace public « un espace vertueux de la citoyenneté, porteur intrinsèquement des vertus de l’échange interpersonnel ».
En toute fin d’ouvrage, dans un ultime chapitre, Thierry Paquot dresse la liste de nouveaux emplacements qui deviennent des « espaces publics » ou « lieux publics », créés par de nouvelles sociabilités. Il en est ainsi de l’école, du campus universitaire, de la plage, de la piste de roller, de la piste cyclable, du patrimoine communautaire, des brocantes…
Comme à son habitude, l’exposé est clair et la démonstration est riche d’exemples pris dans l’histoire de l’urbanisme et la lexicographie. La conclusion lance le lecteur dans une réflexion sur le déploiement des NTIC. La question, écrit Paquot, n’est plus celle de la « fin du public », mais du sentiment d’appartenance à un collectif qui conforte l’individualité de ses membres et non pas leur fusion. À cette réflexion, il faut lier celle du déclin de l’expérience de la ville : « C’est la rue qui nous met à une place, c’est la ville qui nous conditionne ». Devenus « public », les citadins se cantonnent bien souvent au seul rôle qu’on leur attribue, celui de spectateur.