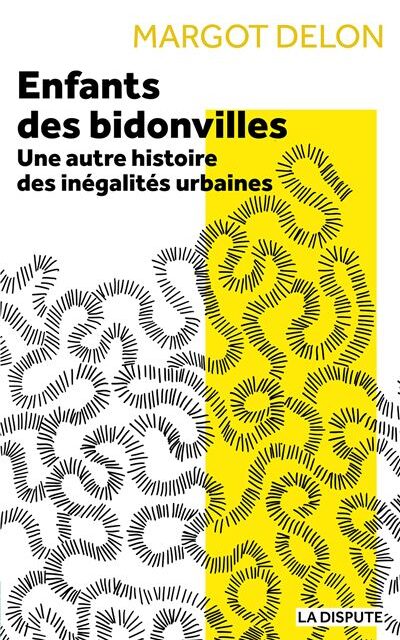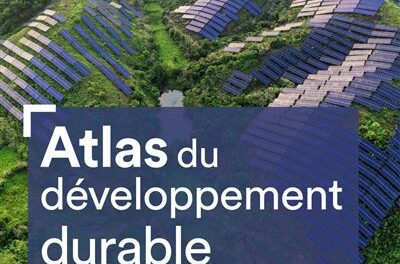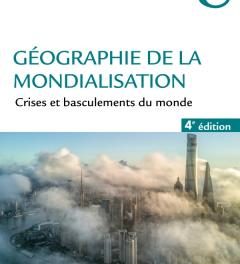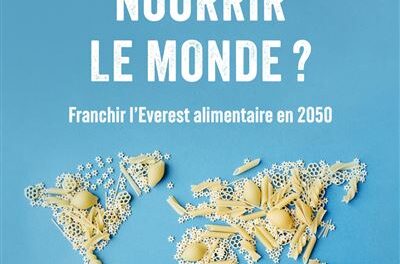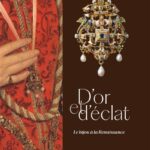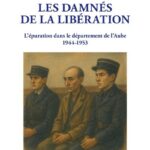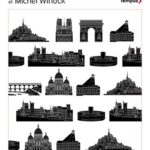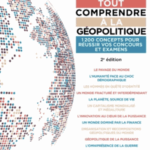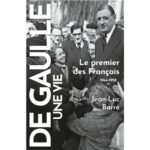Margot Delon est sociologue au Centre Nantais de sociologie et au CNRS, chercheuse résident à l’École française de Rome. Ses travaux portent sur la fabrique des inégalités, saisie à travers différents objets tels que le logement, les migrations, la mémoire… Dans ce présent ouvrage, elle a enquêté sur les populations immigrées qui ont vécu entre les années 1950 et 1970 dans des bidonvilles de la région parisienne, et plus particulièrement sur les enfants de ces bidonvilles aujourd’hui adultes. Plusieurs questions ont mené son enquête : comment ces enfants ont-ils vécu ces épreuves de l’immigration et de la vie dans les bidonvilles ? Que sont-ils devenus, une fois les bidonvilles détruits ? Comment, aujourd’hui, se souviennent-ils de leur enfance ?
Margot Delon a choisi d’enquêter à Nanterre et à Champigny-sur-Marne, où étaient implantés les plus grands bidonvilles de l’époque. Sa recherche a débuté en 2011. Pour stimuler les récits dans les différents entretiens qu’elle pu avoir, elle a systématiquement présenté des jeux de photographies à commenter. L’ouvrage est découpé en 4 chapitres : un premier sur les traces des bidonvilles disparus, un deuxième sur l’enfance dans les bidonvilles et la question raciale, un troisième sur des parcours d’enfants, et un quatrième sur les enjeux mémoriels.
Dans les années 1960, près de 80% des habitants des bidonvilles sont immigrés et la moitié vient d’Algérie. De 1954 à 1971, des dizaines de milliers d’habitants (10 000 à Nanterre, 15 000 à Champigny-sur-Marne) ont vécu dans plusieurs bidonvilles sur leurs territoires. Nanterre a attiré beaucoup de populations immigrées, des Bretons aux Italiens. Elle a un lien particulier avec l’immigration algérienne puisque c’est dans un café de Nanterre que Messali Hadj a fondé le Parti du peuple algérien en 1937. Champigny était une ville principalement composée de quartiers pavillonnaires et de zones de petit maraîchage. Au début des années 1950, des immigrés portugais ont commencé à s’y installer en investissant des terrains vacants ou des pavillons laissés à l’abandon. En 1965, un Portugais sur cinq de la région parisienne habitait ainsi à Champigny. Dans ces bidonvilles, les différents habitats correspondaient en fait à une hiérarchie entre immigrés : des « propriétaires » installés dans des constructions en parpaing jouaient le rôle de marchands de sommeil en logeant des familles et surtot célibataires « locataires » dans des baraques moins solides. Tous les témoignages de l’époque concordent pour dire qu’il ressortait de ces baraques une impression de grande pauvreté qui contrastait avec les rues extérieures où l’absence de voirie se faisait cruellement ressentir.
L’école, comme pour les autres enfants, était au cœur de leur vie puisqu’ils étaient tous scolarisés. Ces écoles étaient construites à proximité immédiate des baraques et les enfants des bidonvilles étaient majoritaires parmi les écoliers. Les entrées des bidonvilles servaient d’espace de recrutement pour des employeurs qui venaient chercher tous les matins en camion des hommes pour les emmener travailler sur les chantiers.
Le travail de Margot Delon est absolument intéressant et stimulant. Chaque chapitre est l’occasion d’interroger son travail de sociologue et sa méthodologie. Ainsi met-elle toujours le résultat de ses entretiens à distance. Les récits sont toujours marqués par ce qu’on appelle le biais rétrospectif, c’est-à-dire une déformation partielle des souvenirs avec le temps ou le changement de perspective sur un événement du passé. Ainsi rappelle-t-elle les travaux de Maurice Halbwachs au début du XXe siècle qui montrait que la mémoire se construisait dans des cadres sociaux.
Margot Delon montre, dans le chapitre 2, que le bidonville diffère en fonction des populations qui le construisent et qui y habitent, populations distinguées par des qualités et défauts qui sont naturalisés par le pays d’accueil. Ainsi, on aurait d’un côté les Portugais capables de bâtir pour leurs familles des habitations de qualité et de l’autre des « Nord-Africains » dont les constructions nourriraient le désordre et la saleté urbaine. L’habitat, marqueur identitaire, devient un élément de définition à teneur raciale, voire raciste. À Nanterre, tout se passe comme s’il avait fallu à tout prix, pour la société de l’époque, maintenir une division explicite en créant des catégories non plus nationales (puisque l’Algérie était considérée comme française et les Algériens citoyens français depuis 1947) mais raciales (« musulmans », « nord-africains », « arabes »). À Champigny, le Portugais est au contraire considéré comme un « blanc honoraire », selon l’expression du sociologue Eduardo Bonilla-Silva. Ainsi, certains groupes autrefois dominés se rapprochent désormais des positions du groupe dominant, complexifiant ainsi les rapports sociaux de race à l’œuvre. Pour autant, l’effort de relogement par les pouvoirs publics semblait réel et beaucoup de familles pouvaient accéder enfin à un logement plus confortable. Et alors, c’était sur la base de préjugés racialisés que se réalisaient les opérations de relogement : on donnait la possibilité aux familles portugaises d’être relogées dans des logements sociaux et on orientait plus volontiers les familles algériennes vers les cités de transit où on les aidait à réintégrer la société urbaine en leur prodiguant un accompagnement socio-éducatif.
Dans le chapitre 3, les parcours de vie de certains de ces anciens enfants des bidonvilles montrent que la précarité résidentielle, le stigmate, les discriminations ont sérieusement compromis la transmission de certaines ressources, culturelles en particulier.
Le chapitre 4 est d’un très grand intérêt car il souligne l’importance des enjeux mémoriels autour de ces bidonvilles rasés dans els années 1970. L’année 2014 marque un tournant pour la mémoire des bidonvilles à Nanterre : l’inauguration de la rue de la cité Gutenberg dans le nouvel écoquartier Hoche et celle du boulevard Abdenbi Guemiah[1], dans le prolongement de l’axe royal reliant Paris au quartier d’affaires de La Défense. Pour se souvenir, il faut des supports qui fassent office de points de référence et qui guident le récit du passé. Reprendre le concept de mémoire collective proposé par Maurice Halbwachs engage donc à identifier les moments et les personnes qui élaborent en commun un récit sur le passé.
[1] Le 23 octobre 1982, Abdenbi Guemiah, étudiant de 19 ans, sort de la mosquée et se rend tranquillement chez lui, à la cité de transit Gutenberg (Nanterre), lorsqu’une balle l’atteint en plein abdomen. Le tir est dû à un homme, habitant un pavillon non loin de la cité. Abdenbi succombe à ses blessures le 6 novembre. Le lendemain, une marche silencieuse, ayant réuni plus de 2000 personnes, avait pour message « plus jamais ça ! »