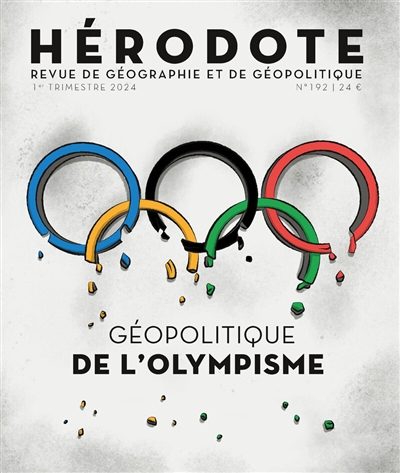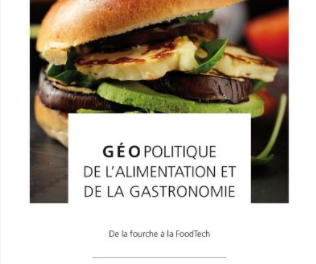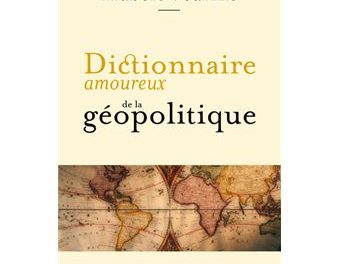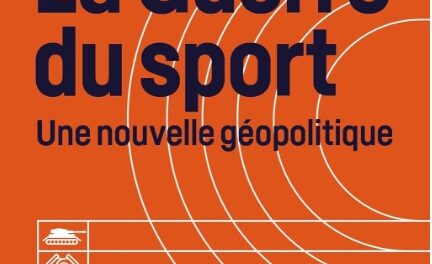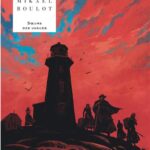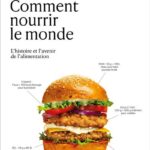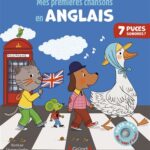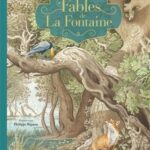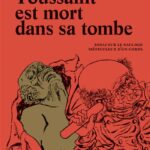Ce numéro de Hérodote est entièrement consacré aux jeux olympiques. Il est placé sous la direction de Béatrice Giblin, géographe et géopolitologue. L’Olympisme représente des enjeux de pouvoir qui se sont accrus au cours du temps avec l’élargissement du nombre d’États et des disciplines sportives qui y participent et du fait de son immense succès médiatique depuis la retransmission des Jeux à la télévision. Le sport est un acteur des relations internationales depuis le début du XXe siècle, mis au service de la puissance et du prestige des États. Les JO sont aussi un moyen efficace pour des États, des nations ou des entités de se faire connaître, d’améliorer leur image ou de voir leurs athlètes concourir sous bannière neutre comme la Russie mise au ban des nations pour son invasion de l’Ukraine. Cependant, bien que le rôle du CIO se soit accru, il est loin d’avoir le poids nécessaire pour faire respecter sa Pax Olympica.
Dans ce 152e numéro, Béatrice Giblin a donné la parole à neuf spécialistes. Jean-Loup Chappelet est professeur à l’Institut de hautes études en administration publique de Lausanne. Il a écrit plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur la gouvernance du système olympique et le management des JO. Ces deux sujets sont d’ailleurs l’objet de son article dans le présent numéro.
Pascal Gillon est maître de conférences en géographie à l’Université de Franche-Comté. Il est spécialisé dans la géopolitique du sport. Son article traite de des stratégies d’influence, des conflits géopolitiques à l’aube des JO de Paris 2024. Pierre-Olaf Schut, professeur en histoire du sport à l’Université Gustave Eiffel de Paris-Est-Marne-la-Vallée, montre comment la candidature de Paris 2024 a mis en avant l’héritage que l’événement pouvait construire en France.
Médéric Chapitaux est sociologue, chercheur associé au creSco, laboratoire de l’Université Paul-Sabatier de Toulouse. Ses travaux portent la radicalisation dans le sport. Dans ce numéro, il traite de l’organisation de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024. Dans un autre article, co-écrit avec Philippe Terral, sociologue, professeur au CRESCO, il s’intéresse à l’islamisme dans le sport. André Suchet est maître de conférences à l’Université de Bordeaux. Il travaille sur la géographie sociale du sport. Son article s’intéresse à la géopolitique régionale des Jeux méditerranéens de 2018 à Tarragone. Pauline Soulier est docteure en science politique. Elle enseigne les sciences sociales aux STAPS de Bordeaux.
À partir de l’exemple du Kosovo, État qui malgré la résolution 1244 n’est toujours pas reconnu sur le plan international, Pauline Soulier veut montrer que le sport peut être un vecteur de ce que Michael Billig[1] nomme le « nationalisme ordinaire ».
Ce numéro de la revue paraît quelques mois avant le début des JO de Paris 2024 et réunit quelques spécialistes de la géopolitique du sport. Les articles sont d’une très grande pertinence et apportent de nombreux motifs à réflexion sur l’importance de cette manifestation sportive internationale.
[1] M. Billig, Banal Nationalism, SAGE Publications Ltd, 1995.