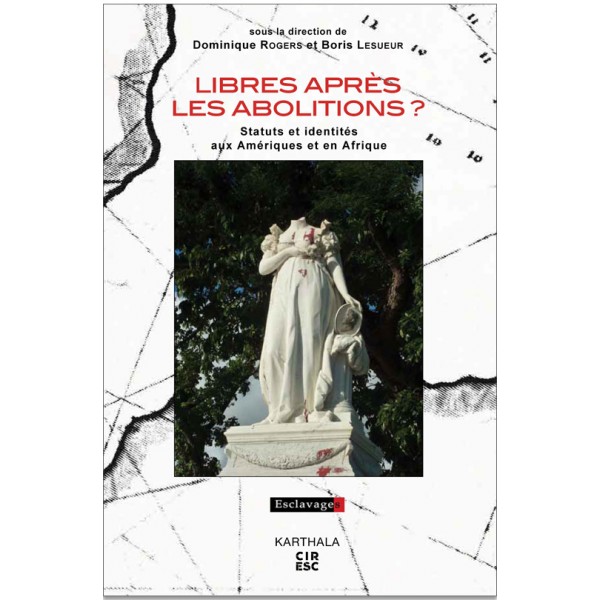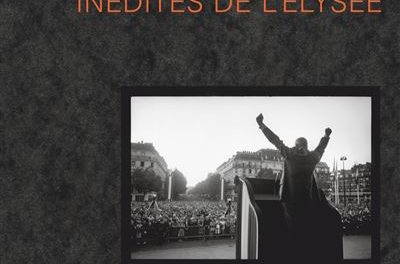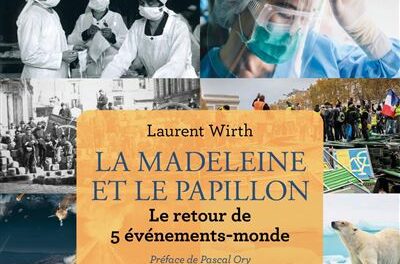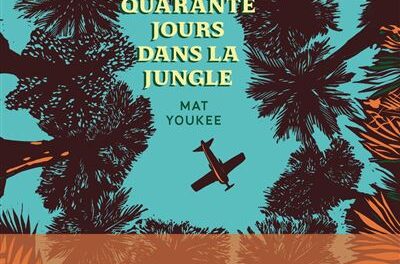Certains descendants d’esclaves haalpulaar de Mauritanie utilisent cette formule imagée et fataliste : « Quelle que soit la durée du séjour d’un tronc d’arbre dans l’eau, il ne deviendra jamais un caïman ». Ce sont les voies diverses et sinueuses de l’émancipation des esclaves issus de la traite atlantique qui font l’objet de cet ouvrage collectif. Il remet notamment en question l’importance des actes d’abolition nationaux, tels ceux de 1794 puis 1848 pour les colonies françaises. Il ne s’agit pas de ruptures majeures.
Les directeurs de l’ouvrage sont tous deux membres du Centre international de recherches sur les esclavages et post-esclavages (CIRESC) et du laboratoire AIHP-GEODE de l’université des Antilles, installée sur la commune de Schoelcher dans la périphérie de Fort-de-France en Martinique. Dominique Rogers a publié sur les populations des Antilles en général, et de Saint-Domingue en particulier, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, notamment les « libres de couleur » et les femmes. Elle est actuellement maîtresse de conférence. Dans la continuité de sa thèse soutenue en 2007, Boris Lesueur poursuit des recherches sur les rapports entre l’institution militaire et les sociétés coloniales sous l’Ancien Régime.
L’ouvrage regroupe une partie des contributions présentées à l’occasion d’un colloque tenu au Musée d’Aquitaine de Bordeaux en mai 2009, sur le thème des esclaves affranchis dans le monde atlantique sur la longue durée. Après une brève introduction, deux parties sont proposées : I- Abolitions incertaines ; II- Recompositions identitaires. Sujet de trois contributions sur neuf, Haïti figure logiquement en bonne place. Elle est la plus ancienne République issue d’une révolte d’esclaves ayant vaincu et chassé leurs maîtres. Les horizons balayés par ailleurs sont très larges : São Tomé, le monde ottoman, le Surinam, la Mauritanie ou le Soudan français. C’est l’un des intérêts de l’ouvrage de ne pas se focaliser comme souvent sur les mondes anglophones et/ou francophones.
La question centrale porte sur les facteurs ayant limité l’intégration complète des nouveaux libres, autrement dit sur les stratégies de résistance et d’accommodement des anciens maîtres et des nouveaux libres. Les auteurs soulignent le poids des continuités après les abolitions et s’appuient sur la notion de « macule servile » ou trace indélébile de l’esclavage. Celle-ci peut aider à comprendre l’émergence des questions de race, précisément au moment des abolitions. L’accès à la citoyenneté et aux droits a été incomplet pour les affranchis et leurs descendants. Le respect de l’altérité est un processus s’affirmant sur la longue durée. Par ailleurs, l’aliénation née de l’esclavage a perduré sous la forme d’une valorisation de la culture européenne présente notamment au sein des élites haïtiennes, bien après l’indépendance.
Jeremy Popkin entend démythifier la première abolition française de l’esclavage, la présentant comme « un quasi-accident de l’histoire ». Tandis que les esclaves révoltés, les libres de couleur et les colons défendaient leurs intérêts, une brouille opposa les commissaires de la République Sonthonax et Polverel, envoyés à Saint-Domingue en 1792, au général Galbaud, arrivé l’année suivante en tant que gouverneur général. Les commissaires nouèrent une alliance avec les esclaves en procédant à des affranchissements successifs, jusqu’à l’abolition générale décrétée en février 1794. Souvent eux-mêmes propriétaires d’esclaves, les libres de couleur ont finalement été momentanément relégués au second rang. Une rivalité est ainsi née qui a marqué toute l’histoire d’Haïti.
Graham Nessler a étudié plusieurs dizaines d’actes notariés reconnaissant ou accordant la liberté à des esclaves de Santo Domingo entre 1804 et 1809. Le passage en 1795 d’une souveraineté espagnole à une souveraineté française sur cette partie est d’Hispaniola puis le rétablissement de l’esclavage dans certaines colonies par Bonaparte en 1802 engendrèrent une crise autour du statut de milliers de personnes réclamées comme esclaves. Ceci d’autant plus que les processus contraires d’émancipation et de rétablissement de l’esclavage étaient restés tout deux inachevés. C’est ainsi que des personnes en position de vulnérabilité du fait de leur statut incertain développèrent une stratégie souvent à triple facette pour garantir leur liberté : dépôt de preuves tangibles chez un notaire, rachat à leur maître, appel à témoins se portant garants de leur liberté. Elles cherchaient à améliorer leur situation en exploitant les ouvertures qui existaient ou qu’elles pouvaient créer. À l’angoisse des uns ne pouvant imaginer leur remise en esclavage répondait la peur des autres redoutant les conséquences d’un affranchissement généralisé.
Céline Flory nous présente l’engagement de l’ère abolitionniste comme une manœuvre habile permettant de continuer de pourvoir les colonies en une main d’œuvre toujours dépendante et à faible coût. Au XIXe siècle, la libération impliquait de s’acquitter d’une dette puisque le captif était propriété privée. Si le parlement britannique puis la République française ont bien « racheté » les esclaves, respectivement en 1833 et 1848, il s’agissait d’une simple avance faite sur le prix d’achat de leur « liberté ». En effet, les captifs « rachetés » étaient forcés de s’engager, et souvent de migrer de l’Afrique jusqu’aux Antilles pour une période généralement comprise entre 10 et 14 ans. Avant 1848, l’engagé ne touchait pas de salaire. Par la suite, des retenues de l’ordre de 25% étaient prélevées et le rapatriement en fin de contrat restait à la charge de l’engagé. L’acte d’affranchissement n’était donc pas une entrée dans la liberté. Peu nombreuses ont été en réalité les personnes qui sont arrivées au terme de leur contrat et ont pu ainsi jouir pleinement de leur liberté.
Malgré l’abolition de 1836, des dérogations ont été accordées pour l’exportation de personnes esclavisées d’une colonie portugaise à une autre jusque dans le second XIXe siècle. Mariana Candido a étudié aux Archives historiques ultramarines de Lisbonne les passeports d’Africains du Centre-Ouest (Angola) qui ont voyagé à bord des trente-sept navires ayant relié Luanda à l’île de São Tomé entre le 7 février 1861 et le 7 août 1862.
Interne à l’Afrique, ce mouvement de diaspora s’explique notamment par l’introduction du café et du cacao dans l’île dès le début du siècle. Or la distinction juridique entre esclaves, libres et affranchis forcés de s’engager pour sept ans restait particulièrement confuse, au point que les autorités britanniques ont dénoncé un trafic d’esclaves déguisé. Entre 1860 et 1864, le nombre d’esclaves recensés à São Tomé est passé de moins de trois mille à plus de quatre mille. C’est à travers l’apparence physique que les différences de statuts étaient rationalisées. Les passeports comportaient des descriptions physiques pour les personnes africaines libres, mais pas pour les esclaves et les affranchis. Le statut des libres ne permettait pas de les différencier des Européens. Éloignés de la norme européenne, les corps africains étaient décrits en termes raciaux. La distinction raciale participait de leur soumission.
L’analyse mériterait d’être chronologiquement affinée, lorsque Mariana Candido affirme que « Le déplacement d’Africains du Centre-Ouest à São Tomé illustre la vision que les Lumières avaient de « l’autre ». » Certes le regard des Lumières a perduré à l’époque romantique, mais il a cédé la place dans le second XIXe siècle à un regard empreint de déterminisme scientiste. Au début des années 1860, lorsque les trente-sept voyages étudiés ont eu lieu, l’idéologie abolitionniste issue des Lumières avait largement décliné. La vision raciale s’imposait partout, renforçant le regard négatif sur l’autre.
Selon les termes de Mariana Candido, le travail forcé et le colonialisme post-abolitionnistes ont représenté de nouvelles formes d’esclavage. Les Africains étaient jugés potentiellement civilisables, mais ils se montraient réfractaires à la mission civilisatrice et au progrès imposés par l’Europe. C’était alors une obligation morale pour l’Europe de sauver les sauvages d’eux-mêmes. Désormais, c’était au nom de la civilisation et de l’esprit d’entreprise qu’il fallait continuer de soumettre les Africains.
Auteur d’une thèse sur les Mamelouks du beylicat de Tunis, M’hamed Oualdi nous montre que pour eux les formes d’affranchissement ont été diverses, beaucoup plus liées à des circonstances particulières qu’à des catégories juridiques formelles. Il refuse toutefois de céder à un relativisme intégral qui consisterait à rejeter toute catégorisation. C’est ainsi qu’il appuie sa réflexion sur les quatre modes d’affranchissement en terre d’islam identifiés par l’historiographie : l’acte pieux d’un maître, l’affranchissement posthume (après décès du propriétaire), l’affranchissement contractuel (en échange de services ou d’une somme) et l’affranchissement après reconnaissance d’un fils (survenant à la mort du maître et géniteur). Les Mamelouks au service des beys de Tunis étaient maintenus dans l’asservissement ou affranchis, autochtones nés musulmans ou Européens islamisés. Ils se distinguaient des captifs chrétiens et des esclaves d’origine subsaharienne. Ces derniers ont été libérés plus tardivement, en particulier avec l’abolition de 1846 qui a donc finalement concerné essentiellement les esclaves noirs. Par ailleurs, l’affranchissement n’ouvraient pas toujours la voie à une plus grande considération et à un gain d’honorabilité. En conclusion de sa contribution, M’hamed Oualdi nuance mais retient cependant l’idée d’une aire islamique distincte de l’aire occidentale en matière d’affranchissement.
Dimitri Béchacq nous présente l’élite post-coloniale en Haïti, composée d’une minorité de nouveaux libres et surtout des anciens libres de couleur, majoritairement mulâtres et en position hégémonique. L’armée, la propriété foncière, la richesse, le patronyme et la couleur étaient les principaux critères d’appartenance. Ce corps social dominant hérita des structures et privilèges du pouvoir colonial.
L’accès à l’égalité et à la dignité passait nécessairement par l’imitation du modèle culturel européen. La francophilie était très largement partagée, qui permettait à la fois de s’inscrire dans l’ordre de la civilisation, établi depuis l’Europe, et de mettre à distance le reste de la population haïtienne. Localement, la formation de cette élite haïtienne relevait d’un enseignement catholique dispensé par des Français. Le séjour à Paris permettait de légitimer, autant professionnellement que socialement, son pouvoir local, même après la création de l’académie de Port-au-Prince. Par ailleurs, cette élite affichait un net penchant pour les biens de consommation d’origine française. L’endogamie était la règle, le mariage avec les gens du peuple n’étant pas envisageable. Les unions cosmopolites consistaient uniquement en mariages avec des étrangers blancs. Cette élite haïtienne vit naître des personnalités pionnières du mouvement panafricaniste : Linstant Pradines, Benito Sylvain et Anténor Firmin. (1)
Olivier Leservoisier est un anthropologue spécialiste de la société haalpulaar établie sur les rives du fleuve Sénégal, frontière avec la Mauritanie. Ce pays est réputé pour être un des derniers à avoir aboli officiellement l’esclavage, où perdurent toutefois certaines formes anciennes d’asservissement. Riche et clairement exposée, l’analyse s’appuie sur des récits de vie de descendants d’esclaves, mais aussi sur les archives de la France d’outremer en rapport avec l’abolition officielle de l’esclavage en AOF en 1905. Olivier Leservoisier se place dans une démarche compréhensive pour dépasser la vision manichéenne opposant discours angélique («tout le monde descend d’esclaves ») et discours misérabiliste ou populiste (« les victimes doivent s’unir pour lutter contre l’oppresseur »).
L’abolition de la traite atlantique a eu un effet paradoxal dans plusieurs régions d’Afrique, comme l’avait déjà remarqué Paul Lovejoy. En Mauritanie par exemple, le nombre d’esclaves a augmenté au cours du XIXe siècle pour deux raisons : les guerres saintes d’El Hajj Umar et de Samory, ainsi que le développement du commerce atlantique légal qui a conduit à une utilisation plus importante des esclaves dans l’économie locale.
Mais à regarder de plus près, la catégorie servile n’est pas si simple à définir. L’auteur s’interroge sur les rapports complexes entre mobilité et hiérarchie sociale. Si la catégorie générique d’esclave regroupe ceux qui se distinguaient par leur statut juridique, par une désocialisation originelle et une exclusion de l’identité fondamentale de la société, il ne faut pas occulter la diversité des situations vécues et des processus d’intégration et d’affranchissement. Les différentes catégories distinguées parmi les esclaves permettaient aux anciens maîtres de les diviser et en même temps d’instaurer une hiérarchie au sein du groupe servile. Les affranchis pouvaient eux-mêmes posséder des esclaves.
Une émancipation toute relative s’est réalisée dans les villages de liberté. Denise Bouche a montré que les captifs en fuite sont devenus une main d’œuvre ou des agents de la conquête du Soudan, subissant toujours d’importantes discriminations. Probablement plus profitables pour les captifs, les contrats de métayage (rempeccen) les autorisait à conserver la moitié ou un tiers de leurs récoltes. Par ailleurs, les migrations de travail ont conduit à quelques grandes réussites individuelles, comme celle de Mbaila Ndiaye, devenu un riche marchand de tissus puis, non sans difficulté, le premier conseiller municipal d’origine servile de la ville de Kaédi en 1986.
L’affranchissement était davantage une étape qu’une pleine acquisition de la liberté. Les femmes affranchies avaient par exemple d’importantes difficultés à se marier. Aussi, certains descendants d’affranchis ont adopté des stratégies d’évitement ou d’effacement pour faire oublier leur origine servile. La réussite a été le fait de figures contestataires mais aussi de certaines personnes douées d’une qualité d’entregent, parvenues à susciter le respect malgré leur origine, tel le lutteur Ndyam Jeeri de Kaédi.
Marie Rodet nous présente la reconfiguration des liens sociaux dans les « villages rebelles » du Soudan français entre 1890 et 1940. Elle s’appuie sur des témoignages oraux recueillis dans la région de Kayes au Mali auprès de descendants d’esclaves, pour décrire le parcours de réfugiés, en particulier à cause des guerres de Samori financées en partie par la vente d’esclaves. Certains ont trouvé refuge dans les grottes des collines de Mameyrie. À proximité, des villages comme Wassala ou des quartiers comme Bangassi-Liberté sont apparus, notamment après l’abolition coloniale de 1905.
Négligé dans les études plus anciennes, le rôle des esclaves dans leur émancipation est affirmé par l’auteur. Elle décrit des rébellions contre l’esclavage et ses héritages dans la région de Kayes. Au delà des liens familiaux et matrimoniaux, une variété de solidarités ont par ailleurs été tissées par les affranchis pour parer à leur vulnérabilité et à leur marginalisation sociale et économique. L’émancipation a toutefois été limitée par le fait que l’administration coloniale trouvait son intérêt dans le maintien des anciennes hiérarchies sociales.
Enfin, Jean Moomou a étudié la désignation des populations appelées bushinengue en Guyane hollandaise, devenue le Surinam indépendant en 1975. Ce terme a été créé au XVIIe siècle par le pouvoir colonial anglais (bush-negroes), relayé par les Hollandais, pour qualifier les marrons rebelles. Malgré leur opposition au pouvoir esclavagiste, ils se sont appropriés le terme. Cette identification coloniale ne s’inscrivait pas pour autant dans un processus d’ethnicisation, la puissance coloniale était au contraire préoccupée par la détribalisation.
Isolés dans la forêt, les marrons ont inventé eux-mêmes des ethnies. De nombreuses autres appellations ont été forgées, jusqu’à celle très récente d’« afro-guyanais ». Ces groupes, par exemple les Saamaka et les Kwinti. se sont construits autour de cérémonies à caractère religieux, d’une défense collective armée et d’un ou plusieurs chefs.
Les Bushinengue se considèrent comme sortis de l’état de nature, plus policés que ceux qui ont toujours refusé d’intégrer la société, les paassaa-uku-nengue. L’autorité coloniale a en effet favorisé la signature de traités avec les groupes marrons pacifiés, pour mieux les contrôler. Mais il existe aussi, distincts des bushinengue, les Bakaanengue ou « nègres blancs », orpailleurs créoles du littoral jugés assimilés.
________________
(1) Firmin a publié un important ouvrage intitulé De l’égalité des races humaines en 1885. Mais il n’a pas été président de la première Conférence panafricaine de Londres en 1900, comme il est affirmé page 122.