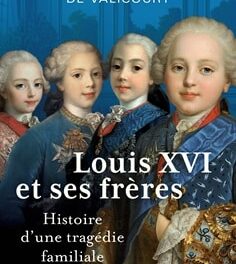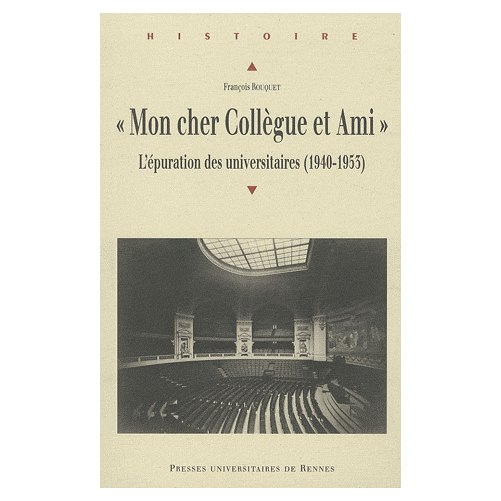
Une collaboration universitaire de peu d’envergure
L’université de Vichy est, à très peu de choses près, celle de la IIIe République. Petit monde clos de « fonctionnaires de la pensée » au climat peu confraternel, agité d’ambitions et d’inimitiés aussi inexpiables que futiles, il demeure défini par des structures et des modes de fonctionnement directement hérités du cadre napoléonien. Ce microcosme très individualiste et jaloux de ses prérogatives, dont Vichy se méfie, parvient pourtant globalement à préserver son autonomie pédagogique. Pourvu que l’ordre règne, ni Vichy ni les autorités occupantes n’interfèrent réellement dans le contenu des enseignements. Les intrusions politiques ne portent que sur un nombre limité d’objets. L’Université de Strasbourg repliée à Clermont-Ferrand est l’enjeu spécifique d’un bras de fer symbolique franco-allemand. Dans les camps de prisonniers de guerre, les Cercles Pétain et d’informelles «universités de prisonniers» offrent prise à des moyens d’influence idéologique. Les décideurs institutionnels (ministres, recteurs, doyens de facultés) se font le relais des mesures de contrainte résultant de l’application des législations antijuive et antimaçonnique, puis de l’imposition du STO. L’épuration vichyste des universités frappe 10% du corps enseignant, ses victimes étant principalement exclues pour des motifs raciaux. Les étudiants sont également concernés par l’instauration d’un numerus clausus. Face à cette politique, l’Alma Mater fait le dos rond : sur fond d’indifférence collective, quelques attitudes ponctuelles de solidarité individuelle contrastent avec de peu délicats effets d’aubaine personnels.
L’épuration de l’institution est envisagée avant même la Libération. Elle est initiée par la fondation à Alger en 1943 d’une commission placé sous l’autorité du juriste René Capitant, préfigurant la mise en place d’un système administratif épuratoire d’ensemble dès octobre 1944. Des Conseils académiques d’enquête instruisent les cas des mis en cause, sur lesquels statue un Comité supérieur d’enquête siégeant au Ministère. 170 dossiers sont ouverts, sur un effectif total de 1500 membres de l’Enseignement supérieur. Il en résulte 77 révocations, dont celles de 8 recteurs, et un nombre significatif de pénalités professionnelles de portée moindre. Si quelques universitaires prisonniers de guerre (soit devenus travailleurs civils en Allemagne, soit impliqués dans les Cercles Pétain des Oflags) sont marginalement concernés, l’essentiel des cas traités sanctionne des formes de compromission fort conventionnelles, dont la banalité typologique est très conforme au tableau des griefs dressé pour l’ensemble de la fonction publique. La collaboration des universitaires est faite d’opinions, expressions et fréquentations compromettantes, de délits de plume et d’actes de propagande, de promotions abusives et de liens familiaux préjudiciables. Si les Ministres ont été les visages de Vichy au sein de l’Université, le reproche majeur fait aux recteurs est celui de servilité institutionnelle. Les engagements individuels ont pris la forme d’une implication plus ou moins accentuée dans les organismes corporatistes et certains mouvements collaborationnistes (en particulier le Groupe Collaboration). La collaboration à proprement parler universitaire est en revanche à peu près nulle en termes d’imprégnation idéologique des cours dispensés, protégés par la liberté pédagogique. Le seul domaine sensible sur ce plan est celui du Droit constitutionnel, astreint à commenter la législation promulguée par Vichy.
Une responsabilité mal assumée
Face à cette banalité des mises en cause et du climat qui les environne, François Rouquet souligne en revanche la spécificité des modes de défense déployés par les accusés. Professionnels éprouvés de l’argumentation, ils mettent en oeuvre des stratégies de justification qui se distinguent par leur habileté et la riche subtilité de leurs démonstrations absolutoires. Familiers du langage de la rhétorique procédurière, ils adoptent des attitudes systématiques de dénégation (quand les preuves sont fragiles), de contestation et de minimisation, et prétendent parfois renverser la situation jusqu’à endosser des postures de victimisation. Collectant les attestations, répondant aux interrogatoires et produisant des mémoires justificatifs, l’énergie défensive déployée permet d’entrevoir un large panel de mobiles. L’adhésion idéologique apparaît comme un phénomène assez rare et peu significatif. Opportunisme et carriérisme semblent avoir été des motifs autrement plus déterminant de chasse aux postes et d’accélération des ascensions professionnelles. Parfois, l’imprudence ou la naïveté ont nourri des engagements irréfléchis. La dévotion pétainiste est formulée sous l’angle de la sincérité d’un engagement national collectif. Les proclamations de patriotisme énoncées par beaucoup d’universitaires anciens combattants visent à dévaluer les assertions de complaisance envers l’occupant. Certains titulaires de fonctions de responsabilité cherchent à s’abriter derrière le sophisme d’une collaboration crypto-résistante faite d’une attitude de prétendue obstruction aux desiderata vichystes ou nazis. La mauvaise foi n’est pas forcément le ressort exclusif de ce déni fécond en ressources. La perception des événements et de leur engagement par les intellectuels suspectés est elle-même loin d’être univoque. L’ambivalence des comportements et des pensées est aussi celle de l’époque. Elle a peuplé de voyageurs incertains, parfois aveugles, les chemins troubles de la collaboration ou de ses apparences. Du reste, on identifie aussi des cas d’accusation abusive : règlements de compte et ambitions de poste, ressentiments personnels et coups bas professionnels font également partie de l’équation de l’épuration, avec les communistes du Front National Universitaire (FNU) dans le rôle du chalumeau. Parfois enfin, il s’avère que des incidents ponctuels ont été surinterprétés, la coexistence administrative forcée avec les autorités d’Occupation prêtant automatiquement à accusation tandis que, de leur côté, les germanistes étaient particulièrement surexposés aux sollicitation allemandes.
Certains cas individuels sont analysés plus particulièrement : ceux des cinq ministres (notamment Jacques Chevalier et Jérôme Carcopino), et de quelques recteurs, doyens et professeurs emblématiques, tels le professeur de médecine Pierre Mauriac, frère de François mais pétainiste fervent, ou le cas de calomnie exemplaire dont a été victime l’ethnologue Marcel Griaule. En annexe, des pièces provenant de dossiers d’épuration permettent d’en saisir la logique d’instruction. A l’issue de ce parcours fertile en lignes de fuite, François Rouquet rend paradoxalement une conclusion en forme de non sujet : on ne peut identifier de collaboration spécifiquement universitaire. L’élite intellectuelle enseignante se confond dans la banalité de mobiles, pratiques et compromissions partagés avec le tout-venant des autres catégories administratives. Sa particularité réside dans la capacité, très supérieure à la moyenne, d’argutie et d’exonération de leurs responsabilités dont surent faire preuve ses membres incriminés. En retour, l’épuration qui les frappe est elle aussi caractéristique : sévère proportionnellement (au même niveau que la police), mais clémente dans ses modalités et suivie d’un rapide pardon. On retient finalement, de cette étude courte mais évocatrice, l’idée que le reproche essentiel adressé aux universitaires accusés d’avoir failli, quelle que fut l’ampleur de la faute, résidait dans leur visibilité et leur exemplarité. La référence implicite de la grille épuratoire appliquée à ces intellectuels égarés était le crime de n’avoir pas su, dans une période de détresse en mal de repères de conduite, être des guides dignes et irréprochables.