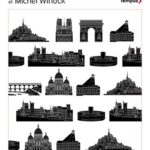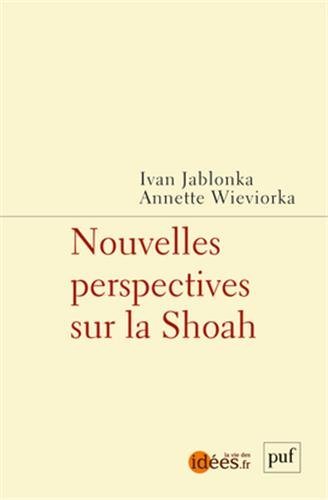
Les Presses Universitaires de France et la revue en ligne laviedesidees.fr, dirigée par Pierre Rosanvallon, s’associent pour une série de livres comprenant un texte de présentation inédit, des articles parus sur laviedesidees.fr et une bibliographie commentée. Cet ouvrage est le second de cette nouvelle collection. Il a été coordonné et postfacé par Ivan Jablonka, jeune historien, maître de conférences à l’université du Maine, chercheur associé au Collège de France qui a publié aux éditions du Seuil en 2012, Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus. Il s’appuie sur les archives de la persécution pour reconstituer le parcours de Matès et Idesa Jablonka, tout en explorant la persécution grâce à la reconstitution du face-à-face entre victimes et bourreaux au service d’une politique d’État. Annette Wieviorka, directrice de recherche au CNRS, historienne de la Shoah à rédigé l’article introductif.
Ce petit livre présente les nouvelles tendances de l’historiographie de la Shoah. Il rassemble une demi-douzaine de courts articles, rédigés très clairement par des historiens hautement spécialisés, connaisseurs des dernières publications non traduites d’historiens anglo-saxons ou d’Europe orientale, nous permettant de prendre connaissance des avancées de la recherche historique sur le sujet.
Dans un article intitulé Comprendre, témoigner, écrire, Annette Wieviorka rappelle les grandes étapes de l’historiographie de la Shoah, qui constitue désormais un champ de recherche à part entière : « Dans les années 1980, le chercheur (…) pouvait tout lire de la production scientifique. Aujourd’hui, ce n’est plus possibles tant les travaux se sont multipliés ». Longtemps, la Shoah fit l’objet de deux histoires parallèles.
D’un côté, l’histoire de la Solution finale, dont les pionniers, Léon Poliakov et Raul Hilberg, ont posé les fondations. Tous deux contemporains de l’événement, ils ont utilisé les archives produites à l’occasion des procès de Nuremberg. Dans son Bréviaire de la haine, Poliakov « pose la question du pourquoi » alors que Raul Hilberg, lui, récuse cette question pour s’attacher « au comment ». Il montre que la société entière participa à la Solution finale et établit la progression en trois étapes du processus de destruction : la définition des Juifs, leur concentration, leur anéantissement. Hilberg fut « un pionnier solitaire ». À partir des années 1970 les études sur la Solution finale se multiplièrent. Un des débats principaux fut celui de l’existence ou non d’une décision, ainsi que celui de la datation de la Solution finale. Puis les historiens s’intéressèrent à la question des exécuteurs et multiplièrent les biographies. L’historiographie française s’intéresse particulièrement à l’implication de l’État français dont la Solution finale. Michael Marrus et Robert Paxton d’une part, Serge Klarsfeld d’autre part, publièrent des histoires générales en puisant dans les archives du Centre de documentation juive contemporaine, fondé en avril 1943 dans la clandestinité.
D’un autre côté, l’histoire des victimes, écrite au coeur de l’événement par ceux qui cachèrent dans le ghetto de Varsovie des archives découvertes en 1946 et 1950, et par les historiens qui les exploitèrent. Historien, militant du parti ouvrier sioniste de gauche, Emmanuel Rigenblum organisa, dans le ghetto de Varsovie, « une cellule de résistance unique au monde, composée d’enseignants, de rabbins, de chercheurs, d’écrivains, d’hommes d’affaires, de jeunes gens idéalistes, réunis dans une entreprise collective et clandestine vouée à l’histoire ». Cette équipe avait pour objectif d’écrire une première histoire de la vie dans le ghetto, objectif qui fut remplacé par celui de conserver la trace d’un peuple voué à l’anéantissement.
Dans son oeuvre maîtresse, L’Allemagne nazie et les Juifs, publiée de 1998 à 2008, Saul Friedländer réalisa la première vraie synthèse des deux historiographies parallèles. Il exploite les archives des appareils, du parti nazi, de l’État, de l’Armée mais aussi les journaux intimes et les témoignages. Il s’appuie sur une immense historiographie et met au premier plan de son analyse les facteurs idéologiques et culturels, notamment l’antisémitisme fanatique d’Hitler. Il s’oppose ainsi aux historiens allemands qui estiment que les Allemands auraient poursuivi, en assassinant les Juifs, des objectifs concrets (s’approprier leurs biens) et démographiques (remodeler ethniquement l’Europe). Annette Wieviorka estime qu’une partie des historiens de la nouvelle génération, « celle qui a choisi d’écrire l’histoire d’abord du point de vue des victimes », s’inscrit dans la lignée des travaux de Friedländer. Cette génération bénéficie des travaux de ses aînés défricheurs et d’une très large ouverture d’archives classées et inventoriées, ainsi que des nouvelles technologies qui permettent de consulter témoins et archives à l’autre bout du monde.
L’article de Jean-Marc Dreyfus, Bad Arolsen. Dans la forêt des archives nazies est consacré au Service international de recherches, installé en Allemagne, près de Dortmund. C’est une institution créée en 1948 qui devait servir à la recherche des personnes disparues et à la réunion des familles dispersées. C’est un centre de recherche, un lieu de mémoire de la persécution, du travail forcé et de la Shoah, et un gigantesque dépôt d’archives. Dès le milieu des années 1950, les documents du Service de recherches intéressèrent les chercheurs, mais de nombreuses difficultés rendirent son accès de plus en plus difficile. Le centre rassemble aujourd’hui 17 millions de documents, dont un phénoménal fichier nominal ; il apparaît qu’un quart des dossiers concerne des Juifs. Les documents sont d’une extrême variété et s’y retrouver exige une longue initiation. On y trouve une section d’archives sur les personnes déplacées, une autre sur le travail forcé, une troisième sur les camps de concentration qui contient des archives originales des camps, des fichiers, des registres de décès, des listes de transferts, avec un matériel cependant très inégal d’un camp à l’autre. « Les dossiers d’Arolsen permettront de compléter les recherches déjà existantes (…) et seront une source première pour entamer une nouvelle recherche. Ils permettront de préciser la géographie de la persécution (…) Ils faciliteront aussi largement les études prosopographiques sur un camp, un commando de travail, un convoi de déportation, un camp de personnes déplacées etc. ».
Tal Bruttmann, historien spécialiste des politiques antisémites en France et de la spoliation des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale plus particulièrement, signe un article intitulé La Shoah dans les bureaux. Les administrations et l’application de la politique antisémite sous Vichy. Dans l’historiographie de Vichy, les administrations ont longtemps été négligées, du moins jusqu’au début des années 1990. Cette décennie a été marquée par une série de travaux, à commencer par ceux de Marc Olivier Baruch sur la haute fonction publique, s’attachant à explorer le fonctionnement et le rôle des différents corps de l’État ainsi que l’attitude de leurs agents. Il s’agit désormais d’étudier la mise en oeuvre des politiques décidées par l’État. De cette activité administrative, il subsiste « des millions de documents représentant des kilomètres d’archives ». Il s’agit non seulement des documents ayant directement trait à la politique antisémite, mais plus largement de tous les formulaires quotidiennement émis par des services divers ou la discrimination apparaît en permanence. Chaque administration a, dans le cadre de ses missions, intégré l’antisémitisme. « Chaque loi, chaque circulaire, chaque instruction ont engendré, du fait de leur application, une masse documentaire souvent négligée, alors qu’elle est l’expression même de l’application d’un antisémitisme devenu politique publique.» Des documents anodins, relevant de l’activité la plus banale, constituent donc une source « sur le degré de pénétration de l’antisémitisme au plus profond des rouages de la machine d’État ». La mise en oeuvre de la politique antisémite se nourrit des initiatives et des suggestions des échelons les plus bas de la pyramide administrative. L’un des champs de la recherche actuelle porte sur « la place de la politique antisémite et son intégration parmi les missions confiées à chaque administration, son acceptation ou son rejet par les agents de l’État ».
Dans L’histoire de la Shoah et la méthode quantitative, Ivan Jablonka rend compte d’une étude de micro histoire sur la communauté juive de Lens publiée en 2011 par Nicolas Mariot et Claire Zalc : Face à la persécution. 991 Juifs dans la guerre.
« C’est l’originalité du livre et son incontestable réussite : en recourant à la méthode quantitative pour décrire des situations ordinairement laissées à la singularité de la souffrance, Nicolas Mariot et Claire Zalc abordent la Shoah de manière novatrice tout en prolongeant leur propre réflexion sur les outils et concepts de l’histoire sociale. » L’étude montre le rôle de la situation familiale, sociale et juridique par la décision de rester ou de fuir et, indirectement, dans les chances de survie. Le deuxième ensemble de résultats a trait à la déportation et à la mise à mort. Le recours aux entretiens, aux fonds privés, aux archives de nombreuses institutions donne à l’enquête un tour plus « qualitatif ». Reconstituer les réseaux d’interconnexion, les trajectoires au sein des familles, la variété et la complexité des parcours permet d’étudier la Shoah « au ras du sol ».
L’article d’Audrey Kichelewski s’intitule Chasse aux Juifs et moissons d’or. Nouvelles recherches sur la Shoah en Pologne. Il rend compte d’ouvrages récents non encore traduits qui portent sur la participation des populations locales à la Shoah, thème essentiel de l’historiographie polonaise actuelle. Après Les Voisins, en 2000, qui racontait la participation des habitants d’un village polonais au meurtre de masse de leurs voisins juifs, brûlés vifs dans une grange à l’été 1941, après La Peur, qui donnait une explication à la responsabilité des Polonais dans les pogromes perpétrés au sortir de la guerre contre les rescapés juifs de la Shoah, l’historien et sociologue polono-américain Jan Gross « lance dans son livre, Les Moissons d’or, un nouveau pavé dans la mare des débats sur les relations polono-juives ». L’auteur prolonge sa réflexion sur la participation des Polonais aux crimes commis contre leurs voisins juifs, en mettant l’accent sur leur motivation principale : l’appât du gain et un enrichissement possible grâce au fameux « or juif » bien plus fantasmé que réel, une thèse déjà avancée par l’historien dans son précédent livre. La spoliation des juifs par leurs voisins polonais a commencé durant la phase de ghettoïsation. Par la suite de nombreux juifs ont été tués alors qu’ils cherchaient à se cacher, enfin les sites des camps de la mort ont été fouillés. L’antisémitisme était si profondément enraciné dans la société polonaise, que les Polonais avaient cessé de considérer les Juifs comme des hommes, effet de la propagande nazie, mais pas seulement.
Dans son dernier ouvrage sorti en même temps que Les Moissons d’or, Jan Grabowski se livre à une estimation chiffrée du nombre de Juifs cachés, tués et rescapés dans un arrondissement rural du sud-est de la Pologne entre 1942 et 1945. Il montre que la participation indirecte de la population polonaise au massacre a été massive, les Polonais ayant tué au moins autant de Juifs que les nazis. « L’extermination des Juifs à la ville et à la campagne se déroula de façon tout à fait différente. Les Juifs vivant dans les grandes et moyennes villes se trouvèrent parqués dans les ghettos dès le début de la guerre et isolés du reste de la société. Les liens commerciaux, amicaux et parfois même familiaux qui unissaient la minorité juive à la société polonaise furent d’un coup rompus ». Enfermés dans les ghettos, les Juifs devinrent invisibles et les ghettos purent être liquidés sans que les voisins polonais ne le remarquent… À la campagne dans les bourgs, la situation était différente : en général les Juifs purent rester chez eux, ou furent contraints de se déplacer dans de petits ghettos proches, où ils purent garder des contacts avec l’extérieur. Le livre de Jan Grabowski montre que ceci cependant ne les protégea pas. Une autre étude, qui porte sur les témoignages de Juifs rescapés de la Shoah, aboutit aux mêmes conclusions. Dans les campagnes, les portes se fermèrent aux Juifs demandant asile ou simplement à manger, ou elles s’ouvrirent… pour les assassiner ; beaucoup furent dénoncés, d’autres furent tués. Ses études apportent un jour nouveau sur un phénomène que les Polonais appellent la « chasse aux Juifs ». Il s’agit de la recherche et de l’extermination des Juifs qui avaient échappé aux rafles et aux déportations et qui se cachaient. Le concours de la population locale à ces assassinats fut déterminant, même si les historiens montrent la complexité de la notion de participation au crime, dans la mesure où les responsables locaux étaient soumis à la pression des nazis. Enfin les chercheurs montrent tous « l’assourdissant silence » de l’Eglise polonaise, dont certains pensent qu’il est synonyme d’assentiment à ce qui se passait. « Tant que les archives ecclésiastiques resteront fermées aux chercheurs, la question est ouverte sur ce qui est peut-être encore le dernier tabou de l’histoire des relations polono-juives durant la Seconde Guerre mondiale. »
Dans un article intitulé Les ghettos, lieu de résistance juive,
Florence Heymann rend compte de la publication par l’Institut Yad Vashem de Jérusalem de deux gros volumes avec près de 1100 entrées qui présentent de manière systématique et approfondie l’ensemble des ghettos dans lesquels les Juifs ont été confinés et à partir desquels la plupart ont été exterminés entre l’automne 1939 et la fin 1943. L’ouvrage s’inscrit dans la série des grandes entreprises encyclopédiques de Yad Vashem, la plus importante institution israélienne de commémoration et de recherche sur la Shoah et elle met l’accent sur les réactions juives à la Shoah, élargissant notamment le concept de résistance à d’autres modes d’expression de la survie juive. L’ouvrage illustre la complexité du terme de « ghetto » et du phénomène qu’il représente, les types de ghettoïsation ayant beaucoup varié selon les régions et les pays où celle-ci était mise en oeuvre. De même, la durée de vie des ghettos, les formes d’auto administration à l’intérieur de ceux-ci, le rôle des Conseils juifs et les manières dont les Juifs ont été assassinés font apparaître de grandes différences d’un pays à l’autre et d’une région à l’autre. « L’ouvrage met l’accent sur la résistance et les réactions juives à la persécution en rendant compte de la vie sociale intense qui a régné à l’intérieur des ghettos et en décrivant le combat pour la survie quotidienne ». Pour ce courant historiographique, ces phénomènes relèvent des catégories de résistance juive, il s’agit de combattre l’image de population exterminée comme « des moutons à l’abattoir ».
Ivan Jablonka conclut cette publication par une réflexion intitulée À nouvelle histoire, nouvelle mémoire. Il critique vertement l’idée que la mémoire de la Shoah soit trop envahissante et qu’elle écrase les autres mémoires et souligne le caractère artificiel et moralisateur du « devoir de mémoire ». Il affirme que la mémoire se nourrit du savoir et qu’elle court le risque de s’appauvrir en se coupant de la recherche. « Le renouvellement de l’historiographie nourrit une autre manière de se souvenir. Au devoir de mémoire, préférons la liberté de l’histoire (…) S’il y a un impératif, en l’espèce, c’est celui de la vérité : c’est le seul devoir qui s’impose à tous, hommes politiques, enseignants, écoliers et, bien sûr, historiens. »