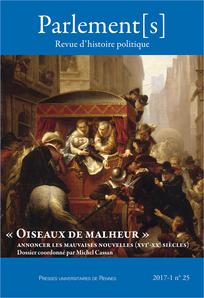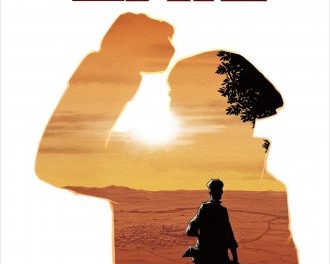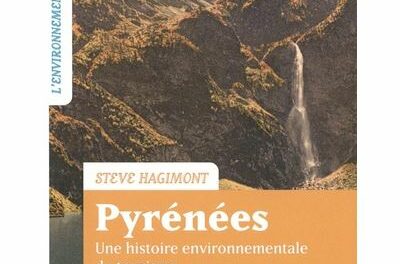La revue Parlement[s]
Créée en 2003 sous le titre Parlement[s], Histoire et politique, la revue du CHPP change de sous-titre en 2007 pour affirmer sa vocation à couvrir tous les domaines de l’histoire politique. Chaque volume est constitué pour l’essentiel d’un dossier thématique (partie Recherche), composé d’articles originaux soumis à un comité de lecture, qu’ils soient issus d’une journée d’études, commandés par la rédaction ou qu’ils proviennent de propositions spontanées. Quelques varia complètent régulièrement cette partie. La séquence (Sources) approfondit le thème du numéro en offrant au lecteur une sélection de sources écrites commentées et/ou les transcriptions d’entretiens réalisés pour l’occasion. Enfin, une rubrique (Lectures) regroupe les comptes rendus de lecture critiques d’ouvrages récents. Enfin, la revue se termine systématiquement par des résumés des contributions écrits en français et en anglais (suivis de mots-clés).
La revue Parlement[s] n° 25 a pour thème : « Oiseaux de malheur » : Annoncer les mauvaises nouvelles (XVIe – XXe siècles). Ce vingt-cinquième dossier est coordonné sous la direction de Michel Cassan. Comme d’habitude, le dossier se compose de deux éléments distincts : une première partie consacrée à la recherche (avec la contribution de 6 chercheurs, jeunes ou confirmées) et la seconde à des sources commentées (au nombre de 4) par Michel Cassan, François Brizay et Frédéric Turpin. De plus, dans ce numéro, nous trouvons à nouveau une partie consacrée à des varia (au nombre de 2) et à 6 lectures (critiquées par 6 historiens).
Puis vient, en introduction, « Oiseaux de malheur » : Annoncer les mauvaises nouvelles (XVIe – XXe siècles) par Michel Cassan (Professeur d’histoire moderne émérite à l’université de Poitiers, EA CRIHAM). À partir du XIXe siècle, les grands dictionnaires de la langue française font un sort à l’expression « Oiseau de malheur ». Ils la qualifient de tournure familière et lui attribuent le sens de personne annonciatrice d’une mauvaise nouvelle. Celle-ci, capable d’affecter sur l’instant les comportements et les émotions d’une société, apparaît de manière occasionnelle et récurrente dans l’Histoire. Elle s’invite dans l’espace public sous la forme de rumeurs colportées par des « oiseaux de malheur » parfois anonymes ou par les informations officielles que proclament les voix autorisées des hommes de pouvoir. Dans une configuration à triple entrée – les pouvoirs, la société érigée en public, les moyens officiels d’information -, les études rassemblées dans ce dossier ont volontairement été choisies sur la longue durée, du XVIe siècle au XXe siècle. Elles interrogent les modalités de formulation et de mise en scène de la mauvaise nouvelle, leurs échos immédiats et à plus long terme dans la mémoire collective et les interactions qui innervent le dialogue entre les « oiseaux de malheur » et la société. La question de l’opinion publique apparaît en filigrane dans ces contributions qui traitent des mauvaises nouvelles politiques et/ou militaires telles que la captivité de François Ier, les « bruits » dans le Paris ligueur, la mort du maréchal Tito, les défaites des Gallispani dans le royaume de Naples, la chute de Diên Biên Phu ; des désastres sanitaires avec les pestes d’Ancien Régime et les épidémies d’influenza en France à l’époque contemporaine ; et de la catastrophe aérienne italienne de Superga en 1949.
RECHERCHE :
Annoncer la catastrophe sanitaire
Pouvoir politique et catastrophe sanitaire : la « publication » des épidémies de peste dans la France moderne :
Élisabeth BELMAS (Professeur d’histoire moderne à l’université de Paris 13-SPC, MSH Paris-Nord)
Durant près de quatre siècles, de 1347 – la peste noire – à 1720 – la peste de Marseille –, les États d’Europe occidentale subirent régulièrement des poussées de la peste, une maladie infectieuse très contagieuse. Rapprochées jusqu’en 1536, ces poussées s’espacèrent progressivement par la suite, jusqu’en 1670. La peste disparut alors pour resurgir dans la cité phocéenne en 1720-1722, apportée par un navire en provenance du Levant. Responsables de la police sanitaire de leur ville, les municipalités se trouvèrent régulièrement confrontées à la gestion d’un fléau susceptible de décimer leurs administrés en quelques mois. Leur première réponse consista à promulguer des règlements draconiens, imposant une véritable « terreur sanitaire » – isolement des malades, destruction des biens des pestiférés, poursuite des pillards –, d’autant qu’elles disposaient de moyens financiers et humains limités pour combattre le fléau. Pourtant, les autorités municipales, « lanceurs d’alerte » désignés contre les épidémies avaient tendance à différer la « publication » de la peste. Disposant des structures et des règlements qui leur permettaient d’agir, elles préféraient le plus souvent attendre… au risque de voir la contamination s’étendre ! Les raisons ne manquaient pas pour justifier leur attitude : aux incertitudes de la science médicale s’ajoutaient les atermoiements de municipalités paralysées de crainte, à la perspective des désordres économiques et sociaux qu’une telle annonce ne manquerait pas d’entraîner. Réalisée trop tôt, cette « publication » pénalisait les villes et leur commerce ; réalisée trop tard, et par défaut, elle condamnait à mort les populations claquemurées dans une cité assiégée, et menaçait de contagion les contrées alentour. Confrontés à ce double écueil, les édiles municipaux des temps modernes ont presque toujours tergiversé avant de reconnaître avec retard, parfois contraints et forcés, la présence d’une épidémie devenue manifeste et incontrôlable.
Quand revient la grippe : Élaboration et circulation des alertes lors des grippes « russe » et « espagnole » en France (1889-1919) :
Frédéric VAGNERON (Post-doctorant, Lehrstuhl für Medizingeschichte de l’université de Zürich)
En l’espace de 30 ans, deux pandémies de grippe « russe » (1889-1890) et « espagnole » (1918-1919) frappent la France et le monde. En comparaison des craintes suscitées aujourd’hui par les pandémies de grippe et de l’ampleur de leur mortalité passée, une étrange ignorance semble avoir accompagné les deux épisodes et leurs lendemains. Comment les signes inquiétants de certains oiseaux de malheur ont-ils été interprétés et jugés au cours et au terme des deux pandémies ? Cet article prend le parti de retracer les conditions incertaines dans lesquelles l’alerte a été produite grâce à des informations inédites, des corpus de connaissances spécialisées, ou l’expérience de précédents. Il décrit comment ces signes ont été reçus, reformulés dans différentes arènes, scientifiques, journalistiques, politiques, et ont circulé, avant de se voir réévalués une fois les pandémies terminées.
Annoncer la disparition de figure de héros
La catastrophe de Superga : une tragédie politique italienne :
Fabien ARCHAMBAULT (Maître de conférences en histoire contemporaine à l’université de Limoges, EA CRIHAM)
Le 4 mai 1949, la catastrophe de Superga choqua profondément la société italienne. L’avion qui s’écrasa ce jour-là sur le chevet de la basilique royale de Turin transportait en effet à son bord la meilleure équipe de football du pays, celle dite du grand Torino. Les autorités politiques et ecclésiastiques cherchèrent à encadrer l’expression du deuil, que ce soit à la Chambre des députés lorsque fut rendu hommage aux morts le soir même ou lors des funérailles nationales organisées deux jours plus tard, ce qui indiquait l’importance prise par le calcio en Italie.
Information et prise de conscience de l’inéluctable : La fin de vie du maréchal Tito :
Vojislav PAVLOVIC (Institut des études balkaniques, Académie serbe des sciences et des arts, Belgrade)
L’aggravation de l’état de santé de l’octogénaire président à vie de la Fédération yougoslave, le Maréchal Tito, en janvier 1980, posa à ses successeurs, membres de la Présidence de l’État et du Parti communiste, l’obligation de gérer la communication sur sa maladie et ultérieurement, l’annonce de son décès, le 4 mai. La succession des officiels et succincts bulletins de santé du Maréchal permit aux citoyens yougoslaves de s’habituer progressivement à l’idée de la disparition de Tito et fit office d’une stratégie de communication dont les autorités yougoslaves étaient démunies.
La mauvaise nouvelle en débat
La capture de François Ier, une mauvaise nouvelle ? :
Jean-Marie LE GALL (Professeur à la Sorbonne, Institut d’histoire moderne et contemporaine)
La mauvaise nouvelle est un concept instable. Tout dépend pour qui et pourquoi une nouvelle est mauvaise. La nocivité est-elle en outre à apprécier dans l’immédiat ou avec le recul du temps ? La capture de François Ier à Pavie en 1525 fut une mauvaise nouvelle pour le roi, sa famille, ses alliés, son royaume, mais pas pour les mêmes raisons. Le monarque a perdu l’espoir d’être duc de Milan. Sa vieille mère redoute un collapsus dynastique. Ses alliés craignent des représailles. Et ses sujets ont peur de l’invasion étrangère et du brigandage d’une soldatesque en déroute. Aussi l’annonce de la nouvelle ne se fait pas par des imprimés, des cérémonies ou des proclamations orales publiques mais par une distillation dans les institutions judiciaire, cléricale et municipale. Toutes se solidarisent pour rassurer les populations mais aussi par peur de l’opinion. Car la mauvaise nouvelle libère la critique contre le roi qui a abandonné le royaume pour l’aventure italienne, contre le gouvernement des favoris, contre la politique religieuse royale, contre le concordat et contre l’essor de l’hérésie. Face à ces accusations, la régente cherche à culpabiliser les sujets en développant l’idée d’un roi qui s’est sacrifié pour les péchés de ses sujets, en vain. Finalement le roi est libéré, et rétrospectivement Pavie n’est plus aujourd’hui qu’un détail insignifiant de l’histoire.
Bruits et nouvelles dans les Mémoires-Journaux de Pierre de L’Estoile :
Nadine KUPERTY-TSUR (Université de Tel Aviv)
L’histoire des guerres de religions bruisse de rumeurs et fausses nouvelles, reflets de l’angoisse du peuple en période de crises. Si leurs sources sont difficiles à identifier, leur réception donne à voir une prise de position critique à leur égard. La crédulité naïve fait place à l’enquête pour vérifier le bien-fondé de l’information, signes d’une attitude intellectuelle apprise à l’école de l’humanisme, qu’on observera à partir de la récente édition du Journal du règne de Henri IV de Pierre de L’Estoile (1592-1594). Le relevé des bruits par L’Estoile (fausses annonces de la prise du roi ou de morts subites, écho des bruits de la scène internationale comme la menace ottomane, récits des bruits et diffamations « ad hominem »), s’accompagne de la dénonciation des manipulations qui les sous-tendent et s’inscrivent contre la propagande ligueuse qui tient Paris. L’appel au sens critique pour évaluer la véracité des informations dénote la formation humaniste du parlementaire parisien ainsi qu’une conscience politique aiguë et une volonté tenace de ne pas se laisser abuser par les menées de la Ligue qu’il tourne souvent en dérision. L’analyse des bruits et de leur réception dans le Journal reflète la naissance de l’opinion publique au sein de l’espace public parisien, phénomène social nouveau, décrit par Habermas, lié à la politisation d’une certaine frange de la population au moment des guerres de Religion. Avec l’entrée victorieuse d’Henri IV dans Paris, se dit l’émotion d’un peuple meurtri, qui ne cache pas sa joie du retour du roi et de la promesse de paix qu’il représente.
SOURCES :
Charles-Gustave Housez, L’ « assassinat d’Henry IV et l’arrestation de Ravaillac » (1859) :
présenté par Michel CASSAN ((Professeur d’histoire moderne émérite à l’université de Poitiers, EA CRIHAM)
Le tableau de Gustave Housez, en représentant sur le mode dramatique le régicide d’Henri IV, rappelait l’horreur du meurtre et en suggérait les désastreuses conséquences. Il suffisait alors de remplacer mentalement Henri IV par Napoléon III pour prendre la mesure des dangers qui submergeraient le pays si l’empereur était tué. L’assassinat d’Henri IV, figuré avec une grande intensité dramatique, était convoqué pour inviter les Français à se regrouper autour de l’empereur. Napoléon III était sorti miraculeusement indemne d’un attentat fort meurtrier et une telle issue devait être interprétée par ses sujets comme un signe de protection et même d’élection divine et les inciter à marquer leur fidélité à ce pouvoir encore nouveau.
L’annonce de la mort d’Henry IV dans les villes de Tours et de Montauban, 15 et 19 mai 1610 : une « sinistre nouvelle » :
présenté par Michel CASSAN ((Professeur d’histoire moderne émérite à l’université de Poitiers, EA CRIHAM)
L’assassinat d’Henri IV est un événement imprévu mais nullement imprévisible. Le souverain avait été la cible de nombreux attentats et l’annonce de son décès avait couru en 1594 à la suite de l’agression de Jean Châtel, ainsi qu’en 1609 et au début de 1610. Toutefois, ce qui n’était que bruits devient le 14 mai 1610 un événement de très forte intensité inscrit dans un système de temporalités emboîtées. Les contemporains lisent le régicide à la lumière de faits advenus a priori comparables et des anticipations du futur, nourries du souvenir d’expériences passées. Cette prégnance mémorielle est sous-jacente dans les délibérations municipales de Tours et de Montauban, les 15 et 19 mai 1610, au cours desquelles la mort du roi est annoncée.
Des oiseaux de malheur à Naples pendant la Guerre de succession d’Espagne : le témoignage du consul de France, Argoud de Laval, en 1706-1707 : présenté par François BRIZAY (Professeur d’histoire moderne à l’université de Poitiers, EA CRIHAM)).
Pendant la guerre de Succession d’Espagne (1702-1714), la France de Louis XIV et l’Espagne de Philippe V combattirent l’Autriche, l’Angleterre, les Provinces Unies et leurs alliés sur divers fronts en Europe : en Flandre, en Espagne et en Italie. Dans la péninsule italienne, l’enjeu, pour les Gallispani (les Français et les Espagnols), était d’empêcher les Impériaux, autrement dit les Autrichiens, de s’emparer des États dont Philippe V était le souverain : le riche Milanais et les royaumes de Naples et de Sicile. Le consul de France à Naples, Argoud de Laval, mesura la menace que les Autrichiens faisaient peser sur les intérêts des Bourbons en Italie. À partir du printemps 1706, il alerta régulièrement l’ambassadeur de France à Rome, le cardinal de La Trémoille, sur l’incapacité du royaume de Naples à faire face à une éventuelle attaque des Impériaux. Il lui décrivit l’évolution de l’opinion publique afin de le convaincre du risque d’une trahison au profit des Habsbourg. Imperturbablement, dans les dépêches qu’il adressa au diplomate, il évoqua des personnages dont l’action n’augurait rien de bon pour les Espagnols et il joua les Cassandre en prophétisant la défaite des Bourbons.
La chute de Dien Bien Phu par Jacques Foccart (Lettre à l’Union française, n° 233, 13 mai 1954) : présenté par Frédéric TURPIN (Professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Savoie Mont-Blanc, directeur du LLSETI – EA 3706)
La guerre d’Indochine (1945-1954) n’a jamais vraiment constitué un élément fort de la mémoire collective française. La guerre d’Indochine est un conflit qui relève à la fois du processus historique de décolonisation et de celui de la guerre froide, ce qui a longtemps contribué à brouiller son image auprès des Français. En effet, d’un côté, les gouvernements de la IVe République défendaient l’engagement de la France dans ce conflit par la nécessité de tenir un secteur du « monde libre » menacé par la subversion communiste internationale. De l’autre, le Parti communiste français (PCF) et ses compagnons de route le taxaient de « sale guerre » pour la défense des intérêts colonialistes de la France. Entre ces deux engagements, les Français sont restés assez indifférents à un conflit lointain du point de vue géographique et qui ne concerna finalement que les soldats de métier et les engagés, à la différence de la guerre d’Algérie qui vit des classes entières de jeunes Français servir, souffrir et, parfois, mourir outre-Méditerranée. L’opinion publique n’est pas pour autant demeurée insensible aux arguments des uns et des autres. En fonction des thématiques développées, elle s’est montrée tour à tour, mais par intermittence, choquée et/ou scandalisée (torture et crimes de guerre commis notamment par la Légion étrangère composée de nombre d’anciens SS allemands ; affaire des généraux ; trafic des piastres ; scandale des fuites), fière ou humiliée (victoires du général de Lattre de Tassigny ; défaite de Cao Bang ; défaite de Dien Bien Phu). La bataille de Dien Bien Phu et sa fin dramatique forment un des rares moments paroxysmiques d’intérêt porté par les Français à ce conflit du bout du monde.
VARIA :
Décider en guerre : Entre loi et décret, la politique des inventions et de la recherche publique à l’épreuve du premier conflit mondial :
Anne-Laure ANIZAN (Professeure en classe préparatoire littéraire, chercheure associée au Centre d’histoire de Sciences Po)
La politique des inventions intéressant la défense nationale menée, en France, pendant la Première Guerre mondiale, représente une étape majeure dans l’institution d’une recherche publique. Les structures chargées d’effectuer le tri des dossiers adressés par les « citoyens-inventeurs », de réaliser des expérimentations ou de mettre en œuvre des programmes de recherche appliquée furent toujours créées par décret. Pour autant, les parlementaires furent mêlés à cette politique, par leur engagement dans les structures qui en étaient responsables, leur soutien à une invention ou lors des débats sur la nouvelle législation concernant les brevets. Elle constitua enfin une expérience dont se nourrirent ceux qui pensèrent les moyens de pérenniser, au-delà de la guerre, une recherche publique faisant collaborer science pure et science appliquée.
Les lunettes cartellistes des droites françaises dans l’entre-deux-guerres :
Jean-Etienne DUBOIS (Agrégé et docteur en histoire, membre associé du CHEC, université Blaise Pascal)
À partir des élections législatives de 1924, l’antagonisme entre « cartellistes » et « nationaux » structura le champ du discours politique en France. L’alliance électorale victorieuse des radicaux et des socialistes au sein d’un « Cartel des gauches » suscita une recomposition des termes de la polémique politique mobilisés par les droites : le « Cartel » et ses dérivés devinrent la métonymie d’une gauche nocive aux intérêts nationaux. Après avoir évolué sous le Cartel proprement dit, les connotations associées à ce terme se décantèrent à partir de l’été 1926. La poursuite de son usage par les droites témoigne d’une projection sur le présent, l’avenir et le passé politiques, à travers un filtre cartelliste. Le « Cartel » était constitué en mythe, clé d’une (re)lecture analogique des évolutions politiques jusqu’à la formation du « Front populaire ».
LECTURES :
Jean-Claude CARON et Jean-Philippe LUIS (s.d.), Rien appris, rien oublié ? Les Restaurations dans l’Europe postnapoléonienne (1814-1830), Rennes, PUR, 2015, 474 p., par Vincent Chai
Publiant les contributions (au nombre d’une quarantaine) des plus éminents spécialistes européens et français du premier XIXe siècle, intervenus lors de deux colloques internationaux qui se sont tenus respectivement à Clermont-Ferrand en 2013 et Paris en 2014, le présent ouvrage reprend pour titre l’une des nombreuses phrases attribuées à Talleyrand : les hommes qui sont revenus au pouvoir en 1814 n’ont-ils vraiment rien appris, rien oubliés des évènements, des bouleversements qui se sont déroulés durant le quart de siècle qui a suivi 1789 ? Ainsi, les restaurations cherchèrent d’abord les voies d’un consensus qui éviterait aux peuples de sombrer de nouveau dans la violence la plus radicale. Mais cette violence était désormais profondément ancrée dans les esprits les plus ouverts au changement et à la modernité (qu’on songe à la vague des assassinats politiques). En fin de compte, loin d’avoir oublié, les restaurations avaient trop bien appris du danger qui finirait par les engloutir.
Bruno MARTIN-GAY, « Le coup d’État en permanence ? L’agent public et l’enjeu césarien de la candidature officielle sous le Second Empire », Paris, Éditions du Boccard, 2015, 394 p., par Éric Anceau
Les sources exploitées par Bruno Martin-Gay portent sur la jurisprudence électorale du Conseil d’État et du Corps Législatif. L’agent public est au carrefour des évolutions traversant le régime du Second Empire. Serviteur de la cause impériale, l’homme du gouvernement se conforme aux attentes du pouvoir, en éclairant l’électeur. Les mutations de la France entre 1852 et 1870 ont pour conséquence un approfondissement des missions administratives, à mesure que des problèmes inédits se posent. L’État doit s’appuyer sur des agents plus nombreux, et dotés de compétences affinés pour assumer des tâches à la complexité croissante. Les agents détenteurs d’un savoir-faire précieux disposent d’une autonomie non négligeable. Ces nécessités supposent que le dévouement inconditionnel en faveur du candidat officiel ne suffit pas à déterminer une carrière : par ses compétences, l’agent public se fraye un espace d’autonomie, proportionnel aux besoins en personnel du pouvoir.
Jean-Paul SCOT, Jaurès et le réformisme révolutionnaire, Paris, Le Seuil, 2014, 360 p., par Marion Fontaine
L’année 2014 a donné lieu à une ample moisson de travaux, d’anthologies et d’essais évoquant la figure de Jean Jaurès, sous ses diverses facettes. Elles témoignent du dynamisme et du renouvellement des recherches consacrées au leader socialiste, alors que se poursuit la publication de ses Œuvres complètes, initiées par la défunte Madeleine Rébérioux et poursuivie par Gilles Candar chez Fayard. Alors, Jaurès, réformiste ou révolutionnaire ? Le livre tranche clairement en faveur de la seconde option, mais atteste simultanément le problème que soulève le fait de poser la question dans ces termes, ou du moins dans ceux-là uniquement. En effet, le risque est que le dilemme réforme/révolution prenne des allures quasiment théologiques ou scolastiques, sans prise sur la complexité du réel jaurésien, sans prise non plus d’ailleurs sur le réel politique actuel. Il y a là des richesses que n’épuise pas à lui seul le débat de la réforme et de la révolution.
Bertrand GOUJON, Du sang bleu dans les tranchées : Expériences militaires de nobles français durant la Grande Guerre, Paris, Vendémiaire, 2015, 670 p., par Olivier Tort
Spécialiste reconnu de l’aristocratie au XIXe siècle, Bertrand Goujon s’attache ici à dépeindre l’expérience intime des nobles français engagés dans les combats de la Première Guerre mondiale, ayant laissé comme tant d’autres, d’innombrables témoignages du for privé ; mais au détour de cette étude anthropologique qui s’inscrit dans un sillage historiographique bien connu et dynamique, l’auteur donne également à voir la manière dont la Grande Guerre a pu nourrir au sein de la noblesse l’illusion d’enrayer le lent déclin de son magistère social et de son influence politique dans une France républicaine, grâce à sa participation massive et parfois exemplaire au premier conflit mondial. C’est donc une étude qui prend place, à sa manière, dans le débat historiographique sur la « persistance de l’Ancien régime » (Arno J. Mayer), en le montrant, de l’intérieur, avec une grande justesse de ton. Un ouvrage à lire.
Gilles VERGNON, Le modèle suédois : les gauches françaises et l’impossible social-démocratie, Rennes, PUR, 2015, 182 p., par Mathieu Tracol
Dans ce bref mais dense ouvrage, Gilles Vergnon se propose d’étudier l’influence du « modèle » suédois de social-démocratie sur les gauches françaises. C’est en fait plus généralement une histoire des regards français portés sur la Suède, qui couvre une période ouverte en 1932, date de la première victoire dans les urnes du SAP (le parti social-démocrate suédois), et close à la fin du XXe siècle, les deux dates de 1976 (première défaite électorale depuis 44 ans) et de 1986 (assassinat d’Olof Palme) faisant office de coupure politique aussi bien que symbolique. Pour fonder sa démonstration, l’auteur a principalement recours aux ouvrages traitant de la Suède publiés durant la période, ainsi qu’à la presse. Il exploite également des archives de première main. L’ensemble forme une base documentaire touffue, que l’auteur analyse au moyen de quatre chapitres organisés de manière chronologique, le troisième (consacré aux années 1970) étant le chapitre essentiel. La lecture de cet ouvrage laisse une impression paradoxale. D’un côté, l’auteur démontre de manière parfaitement convaincante le caractère périphérique de la référence suédoise pour les gauches françaises tout au long du XXe siècle. Si « transfert » il y a, c’est donc un échec, et plutôt cuisant. La question paraît donc réglée. Mais d’un autre côté, l’ouvrage ouvre également des pistes de recherche. Ainsi, le regard français sur les relations professionnelles suédoises mériterait d’être creusé. Le solide compromis social suédois constitue ainsi une référence pour les réformateurs des années 1930 comme des années 1970. Paix sociale et pratique régulée de la négociation sociale sont au cœur de ce qu’ils promeuvent, à rebours d’une situation française caractérisée selon eux par de trop artificiels conflits. Or, ces conceptions tendent à se diffuser à bas bruit au sein de la gauche française durant les années 1970, pour triompher au moment du gouvernement Mauroy. Il y a là incontestablement matière à de plus amples recherches futures pour élucider un point qui reste ici aveugle. Ces quelques remarques ne doivent pas cependant faire douter du grand intérêt que les historiens – et les autres ! – auront à lire cet ouvrage.
Mathias BERNARD, Les Années Mitterrand : Du changement socialiste au tournant libéral, Paris, Belin, 2015, 437 p., par David Bellamy
À qui veut comprendre l’état de la France en ce début de XXIe siècle, on conseille de se plonger dans le dernier ouvrage de Mathias Bernard. Le paradoxe n’est que d’apparence puisque l’auteur démontre ici que c’est dans la décennie 1980, et plus largement pendant les deux mandats de François Mitterrand, que notre pays a basculé vers un nouveau « modèle sociopolitique ». L’éminent spécialiste de l’histoire immédiate qu’est Mathias Bernard, a choisi de retrouver l’imaginaire social de cette période en travaillant essentiellement à partir des archives audiovisuelles et de la presse. En onze chapitres denses et solides, Mathias Bernard fait prendre conscience au lecteur du changement de monde qui s’opère alors. Il n’est pas étonnant, dès lors, que l’auteur considère ces « Années Mitterrand » comme celles de la rupture du lien qui unissait les Français à la politique. Les échecs cumulés des alternances (1981, 1986, 1988, 1993), en particulier dans l’action économique et sociale, le relativisme croissant qu’elles provoquent, les dynamiques de décentralisation et de construction européenne qui remettent en cause l’État central produisent une abstention toujours plus grandes aux élections, un éparpillement de l’expression des électeurs et, finalement, l’impression d’une incapacité voire d’une impuissance des élites politiques. Mathias Bernard achève sa démonstration en proposant de qualifier les années Mitterrand « les Quinze Incertaines » car c’est un temps où un monde ancien s’en est allé, sans qu’aucune voie alternative claire ne le remplace encore. On peut s’interroger d’ailleurs sur les raisons qui poussent les Français des années 2010 à garder en eux une nostalgie pour ces « années incertaines ». À ceux qui les ont connues, à ceux qui cherchent quand la France du XXIe siècle s’est constituée, aux étudiants, aux savants et aux curieux (car l’écriture et le style de l’ouvrage le rendent à la fois scientifiquement de haut niveau et accessible), on ne saurait trop recommander la lecture de cette synthèse éclairante !
© Les Clionautes (Jean-François Bérel pour La Cliothèque)