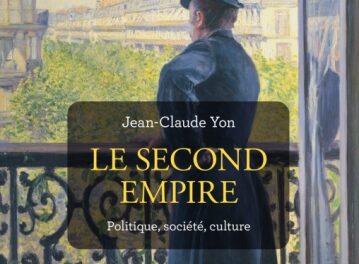« les sciences de l’imprécis » d’Abraham Moles (1995, Seuil Sciences) qui explore le problème des sciences humaines dites faiblement quantifiables et montre la faible opposition entre sciences dures et sciences sociales de ce point de vue. La revue des actes de la recherche en sciences sociales a également beaucoup développé l’analyse de l’économie comme discipline s’étant autonomisée par l’usage des mathématiques, oubliant toute réflexion de nature épistémologique sur ses prémisses.Il faut citer également « la légende de l’entrepreneur ou comment l’esprit d’entreprise vient à la société » (Syros, 1999) de Sophie Bouteiller et Dimitri Uzunidis qui montre que le fait de venir au statut d’entrepreneur ne relève pas d’un gène ou d’une illumination de type christique, mais d’une construction, liée principalement aux divers capitaux mobilisables par la personne, qui sont loin d’être seulement financiers, mais aussi relationnels et sociaux.Pour être encore plus clair, pour nous qui souffrons parfois de n’avoir aucun superviseur ou groupe coopératif pour discuter de cela, le travail de Méda, ainsi que ces livres, renvoient à un point qui semble à la fois fondamental et ignoré par le sens commun, la question de la valeur de l’élève. A l’instar des réflexions de Baudelot et Establet sur le niveau (le niveau n’existe pas et pourtant on peut le mesurer, il monte), on doit pouvoir annoncer que tous les élèves ont la même valeur et pourtant concrètement, on les classe, on les trie et pour certains on les jette comme des déchets.
Ce compte-rendu n’a rien d’exhaustif et je m’excuse, par avance, auprès de l’auteur des raccourcis, oublis, erreurs ou implicites qu’elle pourra y rencontrer. Mieux vaut lire le livre directement, c’est plus sûr.
Les constructions conceptuelles
Le travail de Méda est construit en trois parties (elle a fait l’ENA), la première partie est fondamentalement de nature épistémologique, l’auteur y discute les constructions conceptuelles des économistes historiques (et leurs flottements, contradictions, faiblesses théoriques), ainsi que la comptabilité nationale, les indices, le PIB. Elle montre que tout cela fonctionne dans un certain à peu près péremptoire fondé sur la métrologie (ce qui est facilement mesurable), l’individualisation pour ce qui est de la notion d’utilité (la société se voit ainsi dépourvue de richesse collective autre que la somme des richesses individuelles) et bien sûr très lié au contexte historique de chaque période, ainsi la période de reconstruction se focalise-t-elle sur une production facilement mesurable. Méda montre comment les économistes ont fait peu cas des tentatives pour définir un indicateur de bien-être (notamment celle de James Tobin), en tenant compte notamment des dépenses visant à réparer des dommages causés par la croissance elle-même et qui n’augmentent aucunement le bien-être. La raison de cette fermeture est la survalorisation de l’individu par rapport au collectif. Autrement dit, pour résumer, ou bien les individus ont des préférences individuelles et, celles-ci ne pouvant être agrégées, il n’y a pas de bien-être collectif – c’est le point de vue d’Arkhipoff -, ou bien nous sommes en dictature (page 75). Plus encore, la valorisation de l’économie relève d’un pessimisme inquiétant : seul le commerce est de nature à rapprocher les hommes, à les sociabiliser (et surtout pas la politique). De fait, le temps non économique (tout ce qui n’est pas le temps de travail) se relève exclu de tous ces indicateurs construits par les économistes.
Le travail et la vie : philosophie de l’activité
Dans sa deuxième partie, Dominique Méda développe les alternatives au travail dans la construction de sa vie personnelle et dans l’appréhension du concept de richesse. En préalable, elle montre la dangerosité du discours libéral qui fait de la vie de chacun une production et détruisant au passage l’emploi salarial classique qui aurait fait son temps (l’emploi est une création historique sur le déclin). Promotion de l’individu et de l’entreprise individuelle (d’où suppression des règles collectives), c’est le Moi-SA, soi devient un ensemble de compétences perpétuellement négociables et un capital à entretenir, à faire fructifier. Se convertir soi-même en entreprise (page 133). Du coup, le travail serait simplement l’exercice de l’ensemble des activités humaines. Triste figure de la vie, qui concrètement s’attaque aux droits sociaux acquis de manière collective par le mouvement ouvrier. Face à cela, Dominique Méda retourne vers des auteurs plus anciens tout autant qu’Habermas ou Arendt. Quatre types d’activité : productives (satisfaction des besoins, reproduction élargie des conditions de vie individuelles et sociales), activités amicales, familiales, amoureuses, activités culturelles (formation de soi et mise en forme de soi à titre gratuit), et enfin activités politiques (définition des conditions de notre vie commune). La réalisation de l’ensemble de ces activités est pour l’auteur un idéal d’enrichissement collectif totalement ignoré par la métrologie économiste. Attention particulière pour la parole (pour les lecteurs nantais, un festival de la parole est en préparation pour le printemps prochain à Nantes), parole privée, parole amoureuse, parole dans la philia, parole dans la délibération publique, parole Habermas nomme interaction (page 155). Méda finalement propose de circonscrire le travail pour laisser du champ aux autres formes de la richesse individuelle et collective. Elle montre aussi la grande peur que la réduction du temps de travail provoque chez certains, qui font du temps libéré (mais souvent faussement libéré car le travail flexibilisé tue, par morcellement, les autres temps) un temps vide opposé à la passion positive du travail. Là encore, métrologie des activités hors-travail inadaptée pour mesurer ce que font vraiment les gens de leur temps libre : mesurer les relations filiales, les relations amoureuses ?
De nombreux usages du temps, comme être avec son conjoint, lui parler, être avec ses enfants, leur parler, regarder l’autre, s’occuper de l’autre, rencontrer des amis, s’occuper de soi, participer à la vie de son quartier, apprendre et – on l’a maintes fois souligné – faire l’amour n’apparaissent absolument pas en tant que tels. Ils sont noyés dans des découpages catégoriels, dans une structuration a priori de la réalité sociale et individuelle, qui est telle qu’ils ne peuvent apparaître massivement ni dans les pratiques, ni, à plus forte raison, puisqu’ils ne sont nulle part formulés ainsi comme des aspirations générales.(page 197-198) Quelle cartographie des désirs ? Le multi-ancrage, en particulier des femmes et de leur désir de travail qui ne doit pas s’entendre comme la reconnaissance de la valeur suprême du travail, mais comme évitement de l’enfermement conjugal ou ménager. Discussion très argumentée sur le statut et la place des femmes autour des figures opposées de la famille et du travail, avec également l’analyse des changements sociaux dans les pays nordiques liés aux politiques de promotion des femmes (politique de l’Emancipation aux Pays-Bas), et du cas de l’Italie (expérience du « Temps des Villes », les femmes changent les temps). Enfin, Méda renvoie également au travail du juriste nantais Alain Supiot » Temps de travail : pour une concordance des temps », lequel propose, dans une reflexion d’échelle européenne (voir aussi le dernier texte de Pierre Bourdieu sur les objectifs du mouvement social européen) de renverser le point de vue dominant en instillant dans le temps de travail et le travail lui-même des exigences venues de l’extérieur. La réglementation du travail ne peut pas être envisagée que du seul point de vue de l’entreprise.
Vouloir la civilisation
La troisième partie, intitulée revient sur les fins de la société, loin des pensées de l’urgence ou du sens commun des médias. On ne peut écrire valablement que les entreprises (seules) sont créatrices de richesse. Qu’est-ce que la civilisation ? Conception impérialiste héritée des Lumières et de la Révolution, la civilisation justifie le colonialisme, le nationalisme, puis le mot se relativise, acception ethnologique, les civilisations. La mondialisation actuelle oblige à repenser le mot, civilisation, nouvelle acception refusée par Huntington (« le choc des Civilisations » ou les civilisations figées et antagonistes). Cette mondialisation est portée par la dynamique capitaliste, la croissance, dont les résultats peu présentables, ne peuvent construire seuls une civilisation. Discussion des indicateurs synthétiques de développement. Finalement, qu’est-ce que se civiliser, sinon devenir un sujet. Cette proposition (la civilisation comme processus par lequel les individus deviennent des êtres sociaux) ouvre le débat sur l’opposition entre individu et sujet, notamment en critiquant fortement le travail de Louis Dumont (le spécialiste français de ce domaine) qui semble confondre les deux et met par exemple au crédit de l’individu la faculté de se donner une règle à soi-même , alors qu’elle est une caractéristique du sujet. L’individu, c’est l’homme asocial, égoïste, c’est l’homme des économistes. Le sujet est autre, c’est l’animal politique, non autosuffisant, son horizon est social, fondé sur la prise en compte de l’altérité. Il y a, dans ces dernières pages, beaucoup à prendre et à interpréter. Elles introduisent des propositions de nature plus concrètement politique qui terminent le livre, notamment sur la construction de l’Europe sociale. L’auteur cite abondamment Yves Salesse « Propositions pour une autre Europe, construire Babel » (Félin, 1997) et réfute l’argumentation du travail comme seule défense face au marché (Castel, Touraine). Bien d’autres principes, de ceux que l’Europe politique pourrait mettre en œuvre, peuvent s’opposer au tout-marché. Le livre se termine sur une longue discussion des allocations, minimum ou universelle, et le statut des chômeurs qui renvoie à la polémique (postérieure au livre) du CARE, PARE des derniers mois.
Par Frédéric Barbe