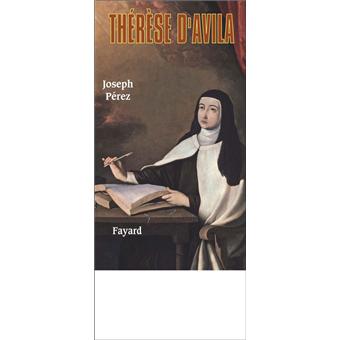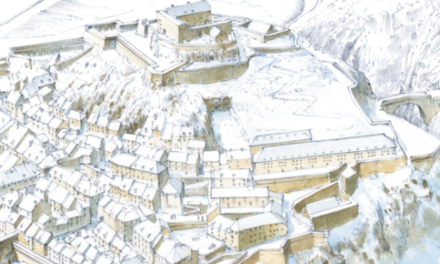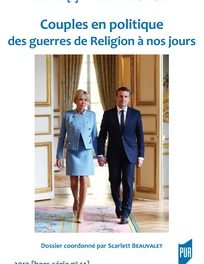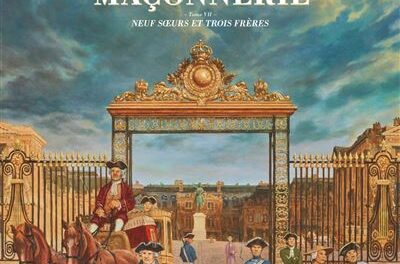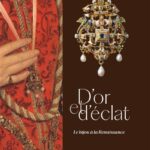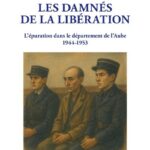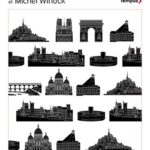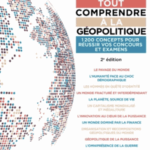Comme à l’accoutumée, Joseph Pérez écrit avec sa plume rugueuse, qui n’épargne pas les susceptibilités et touche à l’essentiel des problématiques quant aux apports de Thérèse d’Avila, ce qui est toujours un des éléments les plus agréables de la lecture de ses livres, mais qui n’est pas sans inconvénient du point de vue formel. Ainsi, les répétitions sont assez nombreuses (l’histoire de l’imposture de Marie de la Visitation est répétée trois fois presque mot pour mot à la p.283 et dans les notes p.335 et p340 ; la même citation apparaît p.143 et p.337), des erreurs sont présentes et des passages se contredisent (Avila possèdait 10 000 habitants p.34 puis 30 000 p.76 ; Thérèse fut autorisée à fonder des couvents de carmélites dans toute l’Espagne p.112, puis seulement dans les deux Castilles p.118 ; Pierre Borgia et Pierre d’Alcantara seraient canonisés en 1622 avec Thérèse p.164 alors que l’auteur rappelle que la quadruple canonisation espagnole de 1622 concernait Ignace de Loyola, François-Xavier, Isidore le laboureur et Thérèse). Enfin, si le lecteur dispose d’un index utile, aux pages 365-372, on peut regretter l’oubli d’importantes figures comme celles du père Gratien (le provincial des Carmes) et de Luis de León, pourtant cités à de nombreuses reprises dans le texte.Le plan d’exposition adopté par Joseph Pérez reflète ce rudoiement du lecteur : les huit chapitres traitent successivement de la vie de Thérèse (ch.1 à 4), de son œuvre et de sa postérité (ch.5 à 8), la sainte mourant à la page 161. Enfin, on peut regretter que la mise en perspective historiographique s’arrête au XVIIe siècle, avec l’intégration française de la mystique thérésienne par les jansénistes et Pascal, en-dehors de quelques annotations réparties dans les notes de fin de volume, cela alors même que l’auteur est, avec Bartolomé Bennassar, le meilleur connaisseur de la société espagnole du Siècle d’Or à nos jours.
La conversion véritable de Thérèse intervient à la fin des années 1550, avec la volonté de transformation de sa vie intérieure par le moyen de pratiques plus assidues et plus intenses. Vers 1557, elle entend les premières paroles surnaturelles et, en 1559-1560, des visions et des ravissements s’opèrent en elle. Certainement en avril 1560, la Transverbération se produit, Thérèse est comme transpercée par une fusion divine, qu’une sculpture du Bernin, plus tard, a immortalisée. C’est aussi dans ces années qu’elle entreprend les réformes et la refondation du carmel féminin tout en construisant une œuvre littéraire. La réforme du carmel d’Avila insiste sur la clôture, sur l’oraison et sur la pauvreté et un bref pontifical l’autorise en 1562 à ouvrir une maison de carmes réformées à Avila. Pendant cinq ans, elle s’efforce d’y surmonter les oppositions des carmes non réformées, de la municipalité, et des autorités épiscopales qui, toutes, craignent une trop grande concurrence entre les couvents, ce qui pourrait épuiser les ressources financières locales. Pourtant, avec l’appui de confesseurs, de directeurs de conscience, le plus souvent jésuites ou dominicains, Thérèse réussit sa réforme. Dès lors, elle se lance dans des fondations d’établissements de carmélites réformées, répondant souvent à l’appel de nobles soucieux de leurs foi. Ainsi, entre 1567 et 1582, Thérèse ne fonde pas moins de seize nouveaux établissements, tous situés dans le royaume de Castille et la plupart en milieu urbain. La règle de pauvreté est parfois contredite par les contingences : plusieurs fondations doivent répondre à la volonté de leurs bienfaiteurs qui souhaitent en contrôler les fonds et les nominations, au point qu’au couvent de Pastrana, établi en 1569 à la demande de la princesse d’Eboli, les sœurs préfèrent s’enfuir de la petite cité en 1574 que de subir les foudres de leur protectrice ! Toutefois, ces établissements s’efforcent de répondre aux règles édictées par Thérèse dans les Fondations : les sœurs décident collectivement du recrutement sur la base des vocations, de la santé et de l’intelligence des novices, suivent la prescription de la pauvreté et de la pratique de l’aumône, de la récréation…. L’épopée fondatrice des carmélites répond donc à des aspirations spirituelles et à des nécessités matérielles.
En outre, l’ascèse et la mystique sont deux voies qui mènent à Dieu et dont l’Eglise se méfie, suspectant les initiés de vouloir entrer directement en contact avec le divin. Malgré cette défiance, Thérèse réussit à emprunter une voie médiane, pratiquant un ascétisme intérieur, moyen d’acquisition de vertu, s’inspirant de la tradition espagnole d’Osuna, par la méditation « vers un état de non pensée (no pensar nada) où l’âme s’unit à Dieu sans intermédiaire », s’opposant en cela à une ascèse héroïque, (p.223). De plus, Thérèse occupe une place singulière pour une femme du XVIe siècle : sachant écrire et lire, silencieusement, elle s’élève par sa culture au-dessus du lot commun. Elle rédige de nombreux ouvrages, toujours posthumes, dont la Vie de la Mère Thérèse de Jésus, autobiographie réécrite plusieurs fois, Chemins de la perfection et Demeures du château intérieur, qui retracent son expérience mystique, et dont de nombreuses copies circulent de son vivant. Pour J. Pérez, l’apport de Thérèse à la condition des femmes est important : elle a estimé que les femmes pouvaient plus facilement que les hommes être touchées par la grâce, ce que les censeurs ont supprimé lors de la publication… comme plus tard, le fait qu’elle considérait le mariage comme un « esclavage » (p.204) et qu’elle dénonçait le poids de la famille et de l’autorité paternelle dans l’histoire de Casilda Manrique de Padilla, qu’elle relate dans ses Fondations.
Enfin, le dernier héritage que Thérèse lègue est d’ordre littéraire puisque, selon son biographe, ses qualités d’écriture en font un des écrivains les plus importants de l’hispanisme : plutôt que de parle de don, Pérez montre comment Thérèse travaillait dans cet isolement qu’elle aimait afin que les traits de sa plume atteignent une simplicité et une justesse qui lui faisaient préférer être prise pour une simple que pour une pédante (p.244).
Alain Hugon/ CRHQ – CNRS – Université de Caen Basse-Normandie