L’ouvrage de Marie-Anne Matard-Bonucci reprend un certain de ses textes précédents mais d’autres sont cependants inédits. L’auteur explore les différents aspects des aspirations et pratiques du fascisme dans son rapport à la violence, à l’idéologie et à la culture et à travers les « politiques de la race ». Le cœur du projet politique du fascisme italien réside, et ce par tous les moyens, dans la refonte totale de l’individu et de la société, ce qui lui confère sa dimension totalitaire.
La première partie aborde la culture de la violence. Celle-ci est au cœur des pratiques de l’idéologie fasciste. La guerre et la violence sont inscrits dans l’ADN du fascisme, et ce dès la bataille pour l’intervention de l’Italie dans la Première guerre mondiale, moment initiatique du fascisme. La violence est valorisée par le syndicalisme révolutionnaire ( la pensée de Georges Sorel a eu une influence importante sur Benito Mussolini) comme par les futuristes. Elle est ensuite utilisée par les Faisceaux de combat puis par le Parti National Fasciste (1921) en s’appuyant sur le mouvement squadriste, d’abord dans le cadre du « biennio rosso », pour restaurer l’ordre social « menacé » par l’agitation et ouvrière (mais seulement après l’acmé de ce mouvement, dans une forme de réaction motivée par la peur), puis surtout, pendant le « biennio nero » (1921-1922), au cours duquel les squadristes multiplient les violences contre les socialistes et les communistes. Ces opérations meurtrières (au moins 3000 morts, dont les trois quarts victimes des fascistes) donnent naissance à un véritable rituel, préfigurant celui du fascisme : le « manganello » (matraque) et l’huile de ricin sont ainsi sanctifiés. Ils participent d’un patrimoine commun, qualifié de « culture de combat par l’historien Emilio Gentile. Après la Marche sur Rome (1922), une fois Mussolini devenu Président du conseil, il faut ramener les squadristes dans le rang, l’État doit reprendre le monopole de la violence. Celles-ci se poursuivent malgré tout (incendie du journal l’Ordine nuovo de Gramsci en décembre 1922). Mussolini décide alors de créer la Milice volontaire pour la sécurité nationale pour intégrer les squadristes et les institiutionnaliser. La violence, devenue une véritable habitude pour les fascistes, n’en continue pas moins. L’enlèvement et l’assassinat du député socialiste Matteotti le 10 juin 1924 provoquent un choc sans précédent dans l’opinion, le pouvoir de Mussolini est alors sérieusement affaibli. Il « reprend la main » avec le célèbre discours du 3 janvier 1925, d’un cynisme absolu, dans lequel il assume les faits et légitime les méthodes criminelles des fascistes.
Au pouvoir, le fascisme accroît les moyens des forces de l’ordre pour écraser toute opposition (création d’une police politique, l’OVRA ; création du délit d’opinion, relégation des opposants dans les îles d’Ustica ou de Lipari, le « confino »; rétablissement de la peine de mort en 1926 pour attentats contre la sûreté de l’État). Les partis politiques sont interdits, un climat de terreur et de peur s’abat sur l’Italie. La sacralisation de l’État impose de proscrire toute violence sociale même à l’initiative des fascistes. Contrôler la violence devient d’autant plus nécessaire, qu’avec les accords du Latran de 1929, le fascisme s’est réconcilié avec le Vatican. L’Église ne se montre pas particulièrement gênée par la violence du régime et cohabite très bien avec celui-ci, en étant par exemple présente lors des grandes célébrations. L’étatisation de la violence conduit le régime à encadrer les productions culturelles pour éviter une exaltation de celle-ci, mais elle reste néanmoins célébrée dans la presse fasciste intransigeante (Il Tevere) et la tradition squadriste demeure entretenue à travers des lieux de mémoire, comme lors de la translation des restes de 37 fascistes dans la crypte de l’église Santa Croce à Florence, en octobre 1934, sorte de « Panthéon bis » qui contenait les restes de Michel Ange, Dante, Machiavel…
La violence est également au coeur des pratiques quotidiennes, dans le cadre des organisations de jeunesse, où l’on s’initie au maniement des armes, mais aussi à travers le vocabulaire employé ( « bataille du grain » , « bataille de la race »…) ou dans la désignation d’ennemis du régime : socialistes, communistes, pacifistes, « amis des Juifs » après 1938…
Cette violence du fascisme est difficile à théoriser, en particulier dans le contexte du soutien de l’Église. Des philosophes comme Giovanni Gentile, des intellectuels comme Julius Evola ou Giovanni Bottai ont tenté de dépasser cette impasse théorique, sans totuefois y parvenir. Pour Nicolo Giani, directeur de l’Ecole de mystique fasciste, nul besoin de justification théorique car « seule l’action compte ». Pour Bottai, la guerre était « l’examen des peuples » Marie-Anne Matard-Bonucci montre ensuite comment, dans le cadre de la conquête coloniale en Éthiopie, la violence totalitaire est utilisée comme moyen pour soumettre les populations, mais aussi comme une fin en soi. Il a fallu attendre 1996 pour qu’en Italie le ministre de la Défense reconnaisse l’usage des gaz asphyxiants, mettant fin à 50 ans de mensonge et d’amnésie collective, alors que les faits étaient déjà dénoncés en 1938 par le juriste Charles Rousseau. S’il n’est qu’un des aspects de la violence coloniale, avec les exécutions sommaires, les massacres de masse, les déportations et la mise en place d’un système concentrationnaire, l’utilisation des gaz est emblématique. Mussolini souhaitait une victoire rapide pour faire aboutir enfin un rêve colonial ancien, mais l’attaque d’un pays membre de la SDN, dans le contexte diplomatique crée par l’Allemagne, montre le visage belliciste des dictatures totalitaires. Le recours aux gaz était directement décidé par Mussolini lui-même, en fonction de l’évolution du contexte et de l’opinion internationale.
La guerre coloniale marque le temps du soldat fasciste, l’Éthiopie est une « école de vie » qui doit forger le caractère du nouvel italien. L’Italie fasciste fait le choix d’un système basé sur une administration directe dans laquelle le racisme est institutionnalisé : il conduit à des formes de barbarie (ex : Starace fait procéder à des exercices de tir sur des prisonniers).
Après la levée des sanctions de la SDN, la guerre se poursuit, l’Éthiopie est alors loin d’être intégralement soumise. Des opérations de « grande police coloniale » sont menées dans lesquelles la terreur devient la norme. Elles coûtent la vie à plusieurs dizaines, voire centaines, de milliers d’Éthiopiens. Cette politique de terreur et de répression est implacable, elle est décidée par Mussolini et mise en œuvre par une chaîne de commandement très « efficace » qui exécute sur le terrain les décisions prise à la tête de l’État. Cette violence de masse s’accompagne aussi de violences ciblées : massacres des chefs rebelles et d’une partie de l’Église copte. Pour les hiérarques fascistes cette violence était totalement assumée, il s’agissait de « faire du chiffre », la violence était présentée comme une réponse aux exactions éthiopiennes largement exploitées par la propagande, une loi du talion implicite. La violence et la terreur sont une action politique qui doivent contribuer à créer « l’homme nouveau ».
Pendant la Seconde guerre mondiale la violence atteint son paroxysme. Loin de l’image « positive » de l’occupation italienne que l’on conserve encore en France aujourd’hui, l’armée italienne s’est rendue coupable de crimes de guerre, dans les Balkans comme en Russie. La guerre totale contre la Résistance s’est accompagnée du massacre de familles entières quand les hommes en étaient absents, d’incendies de villages, d’internements massifs de populations, de viols massifs. Les consignes militaires recommandaient de s’inspirer des méthodes de la guerre coloniale. Des camps de concentration, où les taux de mortalité égalaient ceux des nazis, ont été créés en Yougoslavie. En Grèce, plus de 400 villages furent détruits.
La création de la République dite de Salò (République Sociale Italienne) par Mussolini, annoncée le 18 septembre 1943, marque un tournant. Bien que désireux d’instaurer un État national et social, inspiré du fascisme des origines, Mussolini se heurte aux exigences des Allemands. Le gouvernement de Salò s’engage pourtant dans une collaboration effrénée avec le Reich. A partir du printemps 1944, le gouvernement « républicain » s’engage dans une radicalisation des violences contre les adversaires du régime. La répression est menée par divers groupes armés ( Garde nationale républicaine, Brigades noires, forces armées..) pour lesquelles l’appel au sang devient un véritable leitmotiv. Les exécutions sommaires et les représailles contre les civils se multiplient. La persécution contre les Juifs représente ensuite un autre terrain d’entente entre l’occupant nazi et les fascistes (création du camp de Fossoli en décembre 1943).
Dans Rome, occupée par les Allemands, la tyrannie Kurt Wälzer, chargé de commander la ville, et la violence des S.S, dirigés par Kappler, terrorisent la population. Les nazis trouvent des auxiliaires zélés dans les milieux fascistes romains. La répression s’abat sur les réfractaires au STO, sur les antifascistes, les résistants et les Juifs. L’épisode le plus connu étant les représailles menée aux Fosses Ardéatines après l’explosion d’un bombe au passage de la troupe allemande, Via Rasella, le 23 mars 1944. Le maréchal Kesselring, commandant des forces d’occupation allemandes en Italie, décide de l’exécution de 10 Italiens pour chacun des 33 soldats allemands tués. Kappler organise les représailles, dans les grottes de tuf de la Via Ardeatina, avant de faire exploser des charges de plastique à l’entrée de la grotte pour camoufler le massacre.
En 2016, l’estimation des victimes civiles des massacres commis par les nazis et les fascistes pendant la période de la guerre civile s’élève à 23720 pour un total de 5616 épisodes de violence. Les travaux récents ont démontré que 20 % des victimes ont été tuées par les troupes de la R.S.I. La répression et la violence fascistes se distinguent par leur caractère politique, afin d’imposer l’ordre fasciste contre les ennemis du régime. Plus la fin de la guerre approche, plus la violence contre les civils se déchaîne, dans une fuite en avant vers la mort . La RSI, par la débauche et l’ostentation de la violence, fut bien une tentative de retour aux sources du fascisme. Le régime de Salò est, contrairement au voeu de Mussolini,resté dans la mémoire collective comme un gouvernement fantôche, dominé par l’occupant nazi et voué à réprimer et massacrer.
La deuxième partie de l’ouvrage aborde la mise au pas par le fascisme de la culture et de la société.
Dans un chapitre stimulant, l’auteur traite étudie tout d’abord la plasticité de la pensée fasciste. La pensée politique fasciste est à la fois doctrine et mythe. Dans les années 20 les fascistes revendiquèrent une part d’indétermination doctrinale, préférant voir dans le fascisme une philosophie de l’action. La doctrine fasciste se construisit en « mouvement », se présentant d’abord comme un refus des grandes philosophies politiques du XIXème siècle : libéralisme, positivisme, matérialisme. Le programme des Faisceaux de combat de mars 1919 conjugue un fort nationalisme, avec des revendications liées au mouvement socialiste révolutionnaire. Avec la création du PNF, ces éléments sont abandonnés, le régime choisissant le camp des élites agraires et industrielles. Au pouvoir, le fascisme mène une politique très conservatrice sur le plan économique et social.
Les quelques militants et intellectuels fascistes qui tentèrent de définir le credo fasciste insistèrent sur le rôle matrice de la Grande guerre dans l »idéologie fasciste ( en permettant la convergence du nationalisme et du syndicalisme révolutionnaire), sur la religion de la nation, l’impérialisme et l’antibolchévisme. Certains thèmes divisaient d’ailleurs au départ les fascistes : le choix des institutions, la place de la religion, la question sociale. Les militants attirés par la dimension sociale et antibourgeoise du premier fascisme furent cruellement déçus par l’évolution du fascisme et sa droitisation. La généalogie intellectuelle du fascisme était différente en fonction des intellectuels et penseurs du régime mais quelques auteurs obligés forment le coeur de la doctrine fasciste : Machiavel, Sorel, Nietzche, Pareto. La mémoire de Mazzini était aussi célébrée.
En 1929, Mussolini décide de donner un « corps de doctrine » au fascisme. Il rédige (largement aidé par Giovanni Gentile) l’article « fascisme » de La nouvelle Encyclopédie italienne à l’instigation de Giovanni Treccani. Cette contribution fut immédiatement interprétée comme « la » définition officielle de la pensée fasciste. Cette doctrine est en grande partie l’oeuvre de Gentile, son concept « d’actualisme » étant bien adapté au fascisme par son indistinction entre pensée et action. Le fascisme assumait son pragmatisme, ne rejetant pas l’héritage syndicaliste révolutionnaire. Le respect des minorités religieuses était affirmé tout comme l’opposition à toute doctrine de la race. Apparu comme soutien de la bourgeoisie,le fascisme ne voulait pas passer pour réactionnaire. Le coeur du projet fasciste consiste à transformer l’homme et la société à partir de valeurs traditionnelles sans modifier les rapports de classe. Il s’agit bien pour Mussolini d’une véritable « révolution anthropologique » avec la volonté de créer un homme nouveau. La dimension révolutionnaire du fascisme réside dans le postulat d’une fusion de l’individu avec la nation et l’État et dans sa mise en œuvre. A travers la prééminence de l’État, se déploie la dimension totalitaire du fascisme, dont tout le reste découle.
La pensée géopolitique du fascisme s’appuie sur le mythe de la Troisième Rome. La conception du Mare Nostrum explique en partie le choix de l’intervention dans la guerre d’Espagne (75000 hommes envoyés). Mussolini définit la Méditerranée comme « la vie même ». L’univers culturel fasciste est saturé pendant 20 ans de références à la romanité et à l’Empire, des symboles (faisceaux de licteurs) à l’architecture (quartier de l’E.U.R ou à l’urbanisme ( dégagement de la via dell’Impero près du Colisée).
La doctrine fasciste exprime la centralité de Mussolini dans tout l’édifice fasciste. Malgré sa plasticité, elle livre une vision cohérente du monde, susceptible de faire des émules, Mussolini rêvant même de constituer une Internationale fasciste. Ses tentative se heurtent cependant rapidement à l’affirmation du national-socialisme.
La diplomatie culturelle fasciste a pour ambition de faire mieux que les gouvernements précédents dans la préservation de « l’italianité » des populations à l’étranger, tout en exportant la doctrine fasciste. De nouvelles structures sont créées : les Fasci all’estero (Faisceaux à l’étranger) et les Istituti di Cultura italiana all’estero (Instituts culturels italiens à l’étranger). Le fascisme reprend également l’héritage de l’Italie libérale en matière de diplomatie culturelle, il développe les réseau scolaire à l’étranger ( fondation de la Dante Alighieri en 1889). A partir de 1928 de nouvelles structures sont créées, comme l’Institut international du cinéma éducatif. Le parti est représenté à l’étranger par les fasci all’estero. Après 1928 la diplomatie culturelle connaît un phénomène de fascisation, la Dante Alighieri devenant par exemple la courroie de transmission de l’idéologie fasciste. La propagande en direction des expatriés se fait plus intense au début des années 30. Elle gagne en efficacité après la création ministère pour la Presse et la Propagande (nommé Min Cul Pop à partir de 1937). Un discours spécifique est élaboré en direction des « italiens de l’étranger », terme qui remplace celui de « migrant ». La fascisme élabore ainsi une légende noire de l’émigration italienne à l’époque de l’Italie libérale. La romanité et la catholicité deviennent des références centrales d’un fascisme à prétention universelle. La culture et son exportation sont présentées comme propres au génie italien.
Un chapitre particulièrement intéressant explore la question de la suppression du pronom «Lei », mesure décidée en 1938. En italien, le « Lei », pronom féminin de la 3ème personne du singulier est utiliser pour manifester de la courtoisie et de la distance. Il s’agit là d’un exemple assez original d’interventionnisme linguistique. Dans les années 20 la politique en direction des minorités linguistiques s’est caractérisée par un nationalisme étroit, en particulier dans le Haut-Adige. Dans les années 30, ce nationalisme linguistique se généralise, l’uniformisation devient la règle et les dialectes doivent être pourchassés. Dans les années 40, une « commission pour l’italianité de la langue » est créée. Au delà du nationalisme ou de la « pureté » de la langue, l’intention de la suppression du « Lei » correspond elle aussi à un projet de transformation de l’individu. La loi est adoptée le 14 février 1938. La règle est d’abord mise en oeuvre dans le Parti qui adopte le «tu », lien d’autorité, le « vous » signalant un rapport de subordination. Elle est adoptée ensuite par l’armée puis par les fonctionnaires. L’application de cette loi déstabilise les administrations et rencontre des formes de résistance passive dans la population. Jusqu‘en 1940 Mussolini emploie d’ailleurs régulièrement la menace contre ceux qui n’appliquent pas cette réforme linguistique. Si elle peut paraître secondaire, cette réforme touche au « style fasciste ». Cette obsession témoigne du fait que Mussolini déplore que, 15 ans après l’instauration du fascisme, les esprits n’ont pas encore changé en profondeur. En supprimant le « Lei », il s’agit de transformer le monde, d’en modifier la syntaxe sociale. De nombreux reproches sont adressés au « Lei », mais derrière l’enjeu linguistique se joue avant tout la bataille contre un ennemi collectif, la bourgeoisie. Cette réforme est aussi l’affirmation d’une identité nationale et le rejet de certaines pages de l’histoire linguistique de l’Italie (le « Lei » étant assimilé aux Espagnols). Cette critique du Lei est reprise par de nombreux écrivains comme Elsa Morante, Vittorini ou Pratolini qui lui préfèrent le « tu ». Mais chez la plupart des écrivains, c’est la question du style littéraire qui est en jeu. La question de la langue italienne n’est toujours pas résolue à la fin des années 30. La suppression du « Lei » est l’occasion d’une réflexion sur les insuffisances de la littérature romanesque et sur la quête d’une langue commune.
En définitive, l’inertie et la forces des habitudes ont conduit à l’enlisement de la réforme. Deux semaines après l’arrestation de Mussolini, le 25 juillet 1943, le nouveau gouverne annule la réforme du « Lei ». En rétablissant le « Lei » le gouvernement Badoglio prenait pour cible le caractère symbolique de la réforme, transformer l’individu au travers de son comportement linguistique, c’est à dire qu’il s’attaquait à la dimension totalitaire de cette mesure fasciste.
Dans le dernier chapitre de cette partie, consacrée à la culture, l’auteur esquisse une histoire politique et sociale du rire sous le régime fasciste. Cette question est loin d’être anecdotique, en particulier pour les fascistes, d’autant que le Duce passait pour un homme qui riait peu. Le comique n’est guère à l’honneur sous le fascisme et la presse satirique est bien évidemment victime de la censure et de la répression. Le théâtre de quartier et les spectacles populaires connaissent toutefois leur apogée sous le fascisme et pendant le Second conflit mondial. Le fascisme tente de créer un humour fasciste, un « humour noir ». Les illustrations de Sironi dans le Popolo d’Italia sont remarquées pour leur caractère grinçant voire franchement macabre. Ce sont les ennemis du régime qui sont la cible de cette forme d’humour fasciste : bolchévisme, libéralisme, bourgeoisie, la France…Le rire participe également de l’escalade du discours raciste et antisémite, en particulier après 1938. De façon générale, le fascisme a tenté de prescrire le rire et de proscrire ce dont on ne pouvait pas rire (le Duce, la romanité). Malgré sa peur d’un rire moqueur, espace de « respiration » du peule italien plus que geste de résistance, le régime a eu beaucoup de mal à contrôler le rire.
La dernière partie de l’ouvrage aborde la question majeure du racisme et de l’antisémitisme.
Marie-Anne Matard-Bonucci revient tout d’abord sur l’historiographie de l’antisémitisme fasciste. En plein essor, la recherche historique s’intéresse aujourd’hui aux dynamiques de l’exclusion des Juifs. De nombreux historiens travaillent sur l’idée d’un continuum idéologique entre le racisme colonial et l’antisémitisme d’État. D’autres explorent l’attitude de l’Église ou les origines intellectuelles du racisme italien dans l’Italie libérale. De même, l’histoire de la propagande et de l’idéologie racistes connaissent un renouveau historiographique, tout comme l’étude des formes de la persécution contre les Juifs.
L’adoption des lois antijuives en 1938 se double d’une « parapropagande » ayant pour but de montrer, contre l’évidence des faits, que le fascisme a toujours été raciste et que les persécutions antijuives sont parfaitement cohérentes avec la politique antérieure. Il s’agit de se défendre des accusations d’alignement sur l’Allemagne. Pourtant si l’antisémitisme n’était pas absent chez certains idéologues ou propagandistes (Giovanni Preziosi), le PNF n’établissait au départ aucune distinction entre ses adhérents. Les choses changent en mars 1937, avec la publication du pamphlet antisémite de Paolo Orano, Gli Ebrei in Italia ?.Celle-ci provoque une surenchère de réactions qui permettent à Mussolini de tester l’antisémitisme en tant que ressource politique. Le Duce joua un rôle essentiel, voire exclusif dans la décision des persécutions contre les Juifs. Plutôt que d’attribuer à des précédents idéologiques les origines de la décision de 1938, l’auteur s’interroge sur l’utilité de celle-ci dans un processus dynamique de construction d’une société totalitaire. Selon elle, dès 1937, après l’Éthiopie et l’Espagne, Mussolini recherchait de nouveaux moyens pour maintenir un climat d’ardeur guerrière et de tension en Italie. Comme d’autres totalitarismes, le fascisme était condamné au mouvement. La bataille antisémite était conçue comme un moyen d’accélérer la transformation des comportements et des individus au même titre que d’autres batailles. Les lois antisémites mirent en effet en mouvement les hommes et l’administration, au sein de laquelle une direction spécifique du ministère de l’intérieur, la Direction générale pour la démographie et la race, la Demorazza, joua, entre autres, un rôle majeur, en coordonnant les politiques antijuives. Cette dynamique mobilisa largement le PNF et fut l’occasion de dénoncer le « piétisme », les « amis des Juifs ».
Avec l‘antisémitisme d’État, Mussolini réinvente une nouvelle figure de l’ennemi, dans un contexte d’arrêt, de stagnation de la dynamique totalitaire fasciste. L’antisémitisme devint une composante à part entière de la culture et des pratiques fascistes.
En Éthiopie le régime tenta de contrôler la sexualité des colons et des italiens. Le concubinage avec des femmes éthiopiennes, pratique très fréquente, est interdit (« le madamisme ») en raison notamment d’une condamnation du métissage, atteinte au prestige de la « race ». La principale revue du racisme militant, La Difesa della razza, s’impose comme un des acteurs principaux de la lutte contre le métissage. Les mariages entre Italiens et sujets de l’Empire sont ainsi interdits, tout comme les rapports de nature « conjugale ». Le recours à la prostitution reste cependant toléré, en particulier pour les troupes d’occupation . La lutte contre le « madamismo » se comprend elle aussi comme une démarche raciste et totalitaire ayant pour objectif la transformation radicale du caractère des Italiens. Les difficultés à faire appliquer ces mesures marquent, elles aussi, les limites de l’emprise fasciste sur les esprits et les mœurs.
Dans l’avant dernier chapitre, l’auteur met en perspective les deux formes de persécutions, contre les Éthiopiens et contre les Juifs, toutes deux relevant de la même politique de « défense de la race ». L’historiographie du racisme colonial et de l’antisémitisme ont été séparées pendant des décennies, l’auteur en présente les principaux aspects et leurs évolutions. Elle souligne l’absence de passerelle qui a longtemps prévalu entre les deux champs de recherches. Elle rappelle par exemple qu’Hannah Arendt, dans Les Origines du totalitarisme, établit un rapport entre impérialisme colonial et continental mais qu’elle ne se réfère à aucun moment à l’expérience italienne, passant ainsi à côté du seul cas de dictature du XXème siècle ayant imposé, de façon quasi-simultanée, un régime colonial d’apartheid et l’antisémitisme d’État. Pour Marie-Anne Matard-Bonucci le passage du racisme colonial à l’antisémitisme relève d’une logique politique : mobiliser l’appareil fasciste et susciter l’avènement d’un homme nouveau capable de discriminer et persécuter. La propagande fasciste insiste sur l’unicité de la doctrine de race italienne. Les Italiens, présentés comme « aryens » doivent faire face au binôme « sémite-chamite ». La stigmatisation visuelle est largement employée notamment au travers de la photographie. Dans l’Empire, le racisme est institutionnalisé dès le départ, les Éthiopiens sont des « non-Italiens ». Les Juifs sont eux considérés comme des citoyens de seconde zone mais ils conservent quelques droits. Les discriminations sont précédées par un recensement, pour définir qui est Juif. A la différence du régime national-socialiste, le fascisme ne crée pas de catégorie intermédiaire entre Juifs et non-Juifs. La politique coloniale et l’antisémitisme sont pensés comme deux moments successifs, avec des moyens différents, dans le but de transformer les Italiens.
Le dernier chapitre aborde la question de la langue et de la race. L’auteur rapproche la loi d’interdiction du « Lei » des lois raciales de 1938, en montrant comment la contemporanéité de ces deux mesures s’explique par la présence d’une « question raciale » dans la question de la langue et par l’existence d’une approche linguistique de la doctrine raciale. Un nouveau lexique est diffusé : le mot race (razza) supplante celui de stirpe (lignée, ascendance);le vocable aryen est mis à l’honneur. Le combat pour la race rejoint à travers les mots le projet de révolution culturelle fasciste. Il s’agit bien de fasciser la langue et de la «déjudaïser ». La dénonciation de l’emphase verbale de la bourgeoisie est également utilisée pour dénoncer le « mamouthisme » de l’expression juive (Karl Marx ou Max Stirner) et de démontrer la duplicité des Juifs, accusés de servir deux patries, la leur et le sionisme.
Si l’on peut regretter l’absence de conclusion générale, la lecture de ce livre n’en demeure pas moins passionnante. Mobilisant de nombreuses études de cas et des exemples précis et originaux, Marie-Anne Matard-Bonucci met en bien en exergue la cohérence des différentes politiques du projet totalitaire fasciste : celui de créer un « homme nouveau ». Cet ouvrage est bien sûr particulièrement utile à l’enseignant, pour enrichir les cours de 3ème et de 1ère consacrés aux totalitarismes. Le citoyen y trouvera également matière à réflexion. En introduction, l’auteur rappelle que dans un contexte marqué par un usage intempestif de la notion de fascisme, et à l’heure des « démocraties illibérales » et autres régimes autoritaires, le retour à une approche historique de la notion de fascisme, dans le pays qui l’a vu naître, s’impose. Dédiée à la mémoire de Pierre Milza, cette exploration du cauchemar totalitaire, est en cela, une réussite.

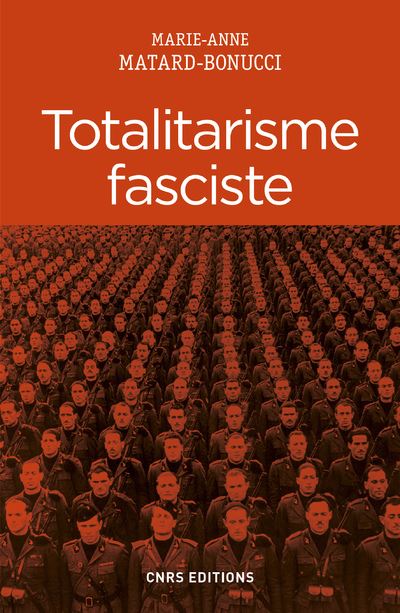
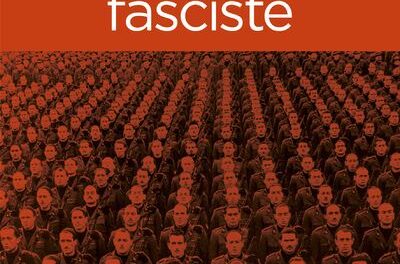

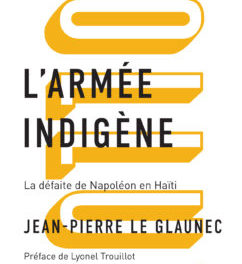











Trackbacks / Pingbacks