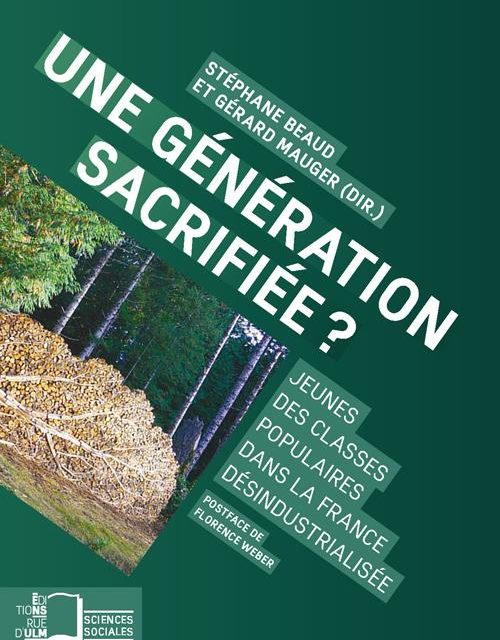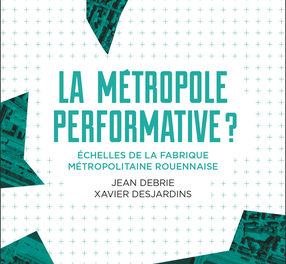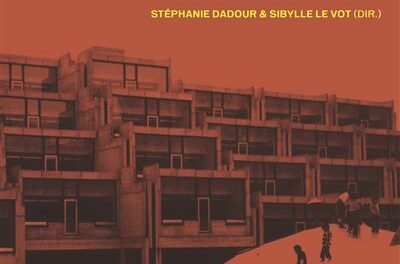Le Prix Goncourt 2018 décerné à Nicolas Matthieu, racontant l’histoire de trois jeunes de la vallée de la Fensch en proie à la désindustrialisation, entre en écho avec cet ouvrage collectif publié au début de l’année 2017. Si le point d’interrogation du titre principal laisse espérer un bilan optimiste, la lecture confirme les difficultés vécues par les jeunes de ces espaces depuis la fin des années 2000.
Cet ouvrage rend compte de l’intérêt des sociologues pour les classes populaires, en tant que classes dominées confrontées à une crise de reproduction dans le contexte de la désindustrialisation. Ce recul de l’emploi ouvrier n’a pas seulement des conséquences en termes de taux d’activité mais également en termes de transmission d’une culture syndicale et politique dans le contexte du recours croissant aux intérimaires dans l’industrie. De même, les difficultés pour accéder à un emploi stable ont des conséquences en termes d’accession à l’autonomie, de mise en couple, de fondation de famille, pouvant se résumer par la citation de Steeve « Pas de diplôme, pas de taf, pas de meuf ! » recueillie lors de son enquête par Benoît Coquard.
Les différentes contributions, œuvres de jeunes sociologues ayant suivi des séminaires de recherche de l’EHESS et de l’ENS, examinent les stratégies mises en œuvre par des jeunes pour essayer de s’en sortir ou pas dans un contexte difficile. Les enquêtes ethnographiques menées ont demandé, pour certaines d’entre elles, une très forte implication de leur auteur : ainsi, Thomas Beaubreuil a-t-il vécu pendant trois ans au sein d’une cité afin de réaliser son enquête sur les jeunes tenant les murs. Cette observation d’habitant est particulièrement riche et fait de son texte un des plus intéressants de l’ouvrage. Il y décrit la géographie des lieux de rassemblement (hall d’immeubles, place, recoins, appartements…) des jeunes désœuvrés se livrant à des trafics mais également leur temporalité (décalage de leur journée par rapport à celle des actifs). De même, Akim Oualhaci a fréquenté en tant que sportif un club de boxe thaïlandaise afin d’étudier les processus de fraternité s’y exerçant. Il montre comment la pratique de la boxe permet à « ceux qui ont un emploi stable pas ou peu qualifié » de trouver « dans la pratique de la boxe thaï, des rétributions symboliques absentes de leur travail où leurs valeurs de virilité ne trouvent pas à s’exprimer » (p. 85). Le cas des filles, évoqué par Sophie Orange et Ugo Palheta, revient sur les espoirs déçus de la scolarisation : les diplômes acquis étant peu rentabilisés dans le cadre de l’accession au marché du travail. Non seulement, les filles des classes populaires accèdent moins que leurs congénères des CSP + aux études supérieures, mais elles acceptent souvent, pour des raisons de rapprochement géographique avec leur famille et leur « petit copain », un emploi pour lequel elles sont sur-qualifiées.
L’engagement syndical et politique des jeunes des classes populaires est examiné par Martin Thibault montrant leur rapport ambigu à l’identité ouvrière à partir du cas des jeunes embauchés à la RATP. Ayant accédé à des études plus longues que leurs parents ouvriers, ces jeunes « ont intériorisé une vision de leur avenir professionnel qui les en éloignait » (p. 144). Alors qu’ils occupent des postes d’ouvriers (tout en pensant y échapper !), ils s’efforcent de ne pas être identifiés à des ouvriers en refusant toute culture syndicale portée par les plus anciens. La direction joue sur cette ambiguïté en leur promettant un avenir glorieux au sein de l’entreprise. Cette volonté de se distinguer se retrouve dans les comportements adoptés par les jeunes affiliés aux mouvements identitaires et paradoxalement au mouvement punk refusant « un travail de larbin » et de « profiter de sa jeunesse » dans le cadre des règles égalitaires du « DIY » (Do it yourself) (p. 181). Samuel Bouron et Pierig Humeau montrent que ces deux engagements comblent ainsi l’absence de rites de passage institutionnalisés comme pouvait l’être auparavant le service militaire.
L’ensemble se conclut par la postface de Florence Weber revenant sur les principaux changements intervenus depuis les années 1960. « La société française a connu depuis les années 1980 un accroissement des inégalités, entre les perdants et les gagnants de la transformation morphologique des emplois, entre les générations et entre les territoires. » (p. 184). C’est à partir de 2008 que ce phénomène a également touché des territoires jusqu’alors épargnés par la désindustrialisation du Nord et de l’Est : « les petites villes industrielles restées dynamiques, les pôles tertiaires et agroalimentaires, les aires urbaines moyennes dans les régions ayant misé traditionnellement sur l’école, comme l’Ouest et le Sud-Ouest ». (p. 189) C’est l’histoire de cette jeunesse locale qui est comptée ici via ces enquêtes et qui s’exprime en partie dans le mouvement des gilets jaunes.