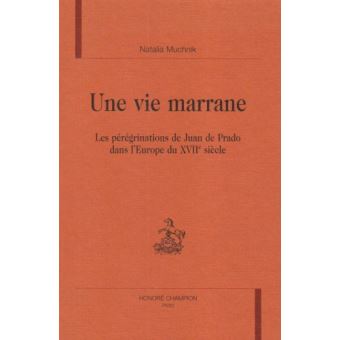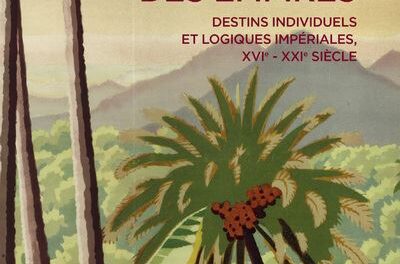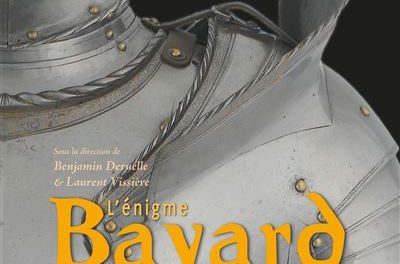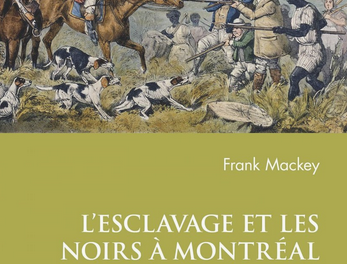Les persécutions subies par les membres des communautés séfarades et les routes de l’exil qu’ils ont suivies sont relativement bien connues des historiens. Des biographies de victimes des diverses inquisitions – espagnole, portugaise ou romaine – et des pouvoirs civils ont souligné l’importance de la mobilité de cette communauté. Parmi les travaux les plus considérables, ceux de Jonathan Israël consacrés aux frères Curiel [et son livre Diasporas within the Diaspora. Jews, Crypto-Jews and the World Maritime Empires (1540-1740), 2002], de Yosef H Yerushalmi à propos du médecin Isaac Cardoso [De la Cour d’Espagne au ghetto italien, 1987], et de Yosef Kaplan sur le médecin Isaac Orobio de Castro, ont contribué à démonter les processus de circulation de ces individus entre les pratiques chrétiennes et juives au cours du XVIIe siècle. Pour sa part, Gérard Nahon dans Métropoles et périphéries séfarades d’Occident : Kairouan, Amsterdam, Bayonne, Bordeaux, Jérusalem, Paris 1993, a signalé la force des liens qui unissent les membres de cette communauté et les passerelles qui existent avec les pays de naissance.
La vie de Juan de Prado, à laquelle Natalia Muchnik consacre cet ouvrage, confirme de nombreux aspects connus à propos de cette diaspora sur les courants migratoires suivis par les persécutés, sur les caractéristiques de leur vie religieuse, et sur les réseaux qu’ils tissent. Le principal apport de ce travail ne réside pas dans ces éléments, déjà en partie exposés, mais plutôt dans sa démarche qui associe les éléments de la vie quotidienne, de la biographie individuelle et de la destinée collective de la « nation juive », tout en s’efforçant de dresser un tableau de la vie intellectuelle qui dépasse la seule judéité dans le monde ibérique, pour s’intéresser à l’Europe occidentale dans son ensemble. Pour ce faire, Natalia Muchnik a puisé des informations dans un nombre considérable de fonds d’archives, depuis les sources notariales d’une petite ville andalouse (Jaén), jusqu’aux grands centres d’archives européens tels que les archives de Simancas (en Espagne), la British Library de Londres et les archives flamandes et hollandaises d’Amsterdam et d’Anvers. Ce travail se caractérise par sa grande érudition qui permet de reconstituer les alliances matrimoniales nouées par la famille de Juan de Prado, ses liens de parentés, et ses réseaux d’amitiés formés à l’université et au cours des pérégrinations. L’originalité de ce livre réside dans le traitement des relations d’un personnage avec son époque, tout en tentant de spécifier la tendance intellectuelle qui caractérise cette époque – celle que Paul Hazard a qualifiée de « crise de la conscience européenne » pour la fin du XVIIe siècle.
En effet, la figure de Juan de Prado se trouve indissociablement liée à celle du grand philosophe Baruch Spinoza (1632-1677), dont il est l’aîné d’une vingtaine d’années, et dont on a prétendu qu’il était le maître à penser. Natalia Muchnik ne confirme ni n’infirme cette thèse ; elle cherche plutôt à montrer l’autonomie de pensée et l’originalité du parcours de Juan de Prado, principalement dues à l’intensité des liens entretenus avec la mère-patrie espagnole.
Juan de Prado est né vers 1612. Ses parents profitèrent certainement du recul de la politique antijudaïque espagnole à partir de 1580, et accentuée entre 1601 et 1605, quand Philippe III accepta d’accueillir les juifs portugais contre finances, politique que prolongea le gouvernement du comte duc d’Olivares (1622-1643). Dès lors, ceux que l’historiographie appelle les marranes, affluent du Portugal vers la Castille, à l’image des Prado. L’activité des nouveaux arrivants est surtout commerciale et financière, comme celle du père de Juan qui devient trésorier des alcabalas royales (taxes sur les produits) tout en négociant des produits textiles. La description de l’activité des Prado et de leur communauté de Lopero offre à l’auteur l’occasion de faire le point sur l’existence, ou l’inexistence, d’une classe intermédiaire (bourgeoise), dans l’Espagne du siècle d’Or et sur la place qu’y occuperaient ceux qu’on appelle les nouveaux-chrétiens. Dans un monde ibérique où la pureté de sang est une des valeurs dominantes, cette expression de nouveaux-chrétiens désigne les individus dont les aïeux furent juifs. L’idéologie du sang les regarde comme souillés (la mancha : la tache) par des ancêtres juifs, même si une importante minorité de catholiques espagnols (dont Olivares), s’oppose à cette discrimination par le « sang ». Par ailleurs, nombre de ces nouveaux-chrétiens suivent les préceptes catholiques, même si d’autres « judaïsent » de manière occulte. La difficulté d’étudier le cryptojudaïsme dans le monde ibérique est évidente : comment prouver l’appartenance à une communauté qui n’existe pas officiellement ? Les sources inquisitoriales restent le principal moyen d’enquête, et l’auteur insiste sur les précautions à prendre avec des sources qui émanent de juges implacables, ayant recours aux dénonciations et aux aveux pour obtenir de la société espagnole une adhésion massive à la foi catholique. En effet, une accusation n’est en rien une preuve de culpabilité ; dès lors, l’adhésion à la foi hébraïque paraît difficile à mesurer : plusieurs passages de cet ouvrage sont consacrés à la recherche de marqueurs confessionnels ; on y trouve la notation des prescriptions alimentaires héritées de la cacherout, celle des ablutions, du port de la kippa, du respect du calendrier liturgique juif et de ses problèmes pour en fixer les dates (shabbat, kippour…), de l’éducation religieuse, etc. Un bilan historiographique (p.101-116) dressé en préambule de ce long chapitre sur les pratiques (p.105-206) mesure les divergences d’analyse entre les historiens, certains estimant que les marranes sont un groupe assimilé d’autres les considérant en rupture avec le milieu ibérique. De même, les rapports avec la diaspora juive font l’objet de débats. Enfin, comment qualifier le syncrétisme qui se manifeste à partir de pratiques occultes ? Quelle porosité y a-t-il entre cette communauté cachée et la société catholique espagnole ? Quel est le degré d’assimilation de la foi mosaïque parmi ces crypto-juifs ? Ainsi, les juifs d’Espagne se distinguent des autres communautés juives : généralement, ils ne lisent pas l’hébreu ; le rite du jeûne de la reine Esther (qu’on peut assimiler à pourim) y évince peu à peu les autres jeûnes, ce qui n’est pas un hasard puisque, dans la Bible, cette jeune femme n’a révélé ni sa race ni sa naissance aux autorités, et elle est demeurée fidèle à sa religion pour mieux sauver ses coreligionnaires.
Le contexte religieux n’empêche pas Juan de Prado de suivre des études de médecine, comme six de ses proches parents, malgré une vieille interdiction faite aux judéoconvers en 1501. Entre 1627 et 1637, il étudie à Alcala de Henares puis à Tolède. Il rencontre alors plusieurs de ses amis et futurs adversaires, dont Baltasar de Orobio : c’est une période de formation intellectuelle. Durant ces années d’université, Juan de Prado se serait pleinement converti au judaïsme, allant jusqu’à devenir un maître dogmatiseur, selon les termes de l’Inquisition. De fait, le rôle des médecins est important au sein de la société marrane, en tant que médiateur et comme véhicule communautaire. Leur mobilité permet une circulation des informations et des savoirs nécessaires à l’expression de la société marranes aux échelles régionale, nationale et internationale. Entre 1638 et 1653, la pratique de la médecine a dû offrir à Juan de Prado les moyens de diffuser son savoir parmi ses coreligionnaires, du moins ce fut ce que l’Inquisition pensait, comme l’indiquent divers documents que l’auteur a exhumés. En effet, à partir de la chute d’Olivares, la répression antijudaïque se renforce ; en 1646, c’est le cousin médecin de Juan de Prado, Geronimo Gomez Chaves qui est convoqué par l’Inquisition, puis libéré, certainement grâce à l’argent d’un beau-frère, administrateur de la rente sur le tabac. En 1650, à Bujalance, des dénonciations impliquent quatre-vingt-sept accusés dans quinze villes : la belle mère et l’épouse de Juan de Prado sont arrêtées et, en décembre 1652, son frère est à son tour arrêté par le tribunal inquisitorial de Cordoue. Dès lors, on comprend mieux le choix de Prado de suivre à Rome son protecteur, le cardinal archevêque de Séville Domingo de Pimentel, nouvellement nommé ambassadeur auprès du Saint-Siège. La mort rapide du prélat inaugure pour Prado plus d’une décennie d’errance, à Hambourg, puis à Amsterdam, enfin à Anvers, avant qu’il ne demande aux autorités espagnoles la permission de rentrer dans son pays natal.
La fuite est donc « l’arme absolue » des crypto-judaïsants, Or le fait qu’ils étaient eux-mêmes les descendants de ceux qui restèrent dans la Péninsule aux XVe et XVIe siècles accentue le déchirement identitaire né de l’exil. Les changements de noms, l’emploi fréquent d’un alias (Juan de Prado s’appelle aussi Daniel de Prado) en sont des manifestations concrètes. D’autre part, la communauté d’accueil ne fait pas qu’aider les réfugiés, mais elle évalue aussi leur degré d’orthodoxie, jugeant parfois déviantes des pratiques préexistantes au sein de la société marrane péninsulaire. Depuis Amsterdam, l’ancien médecin de Marie de Médicis Eliau Montalto, fustige les juifs qui n’ont pas oser fuir, affirmant que rester en terre d’idolâtrie était une faute : il suit en cela L’Epître sur la persécution de Maïmonide (1160). Ainsi, les juifs ibériques sont tout à la fois l’objet de suspicion, de mépris et de respect pour leur souffrance de la part des communautés juives d’accueil.
Dans ce cadre, la biographie de Prado prend une nouvelle dimension puisque, vers 1655, rendu dans « la grande arche des fugitifs » (selon l’expression empruntée à Pierre Bayle), Prado se trouve condamné à plusieurs reprises par la synagogue d’Amsterdam. Un long et intéressant développement permet de mieux comprendre le milieu intellectuel novateur qui émerge, bien qu’il soit souvent considéré par les contemporains comme hétérodoxe. De ce milieu, émergent les plus grandes figures intellectuelles d’Europe : Descartes, Gassendi, Hobbes et, bien sûr, Baruch Spinoza, ceci avant qu’un Pierre Bayle ne trouve refuge dans la capitale hollandaise. Cependant, dans cette même ville, Spinoza et Prado sont accusés ensemble d’hérésie par les autorités juives. Mais à la différence de Prado, Spinoza refuse de se renier. Natalia Muchnik laisse entendre que la principale explication des renoncements de Prado réside dans une situation financière déplorable : Prado était démuni et dépendait des communautés d’accueil. Cette contingence explique-t-elle ses revirements ? En effet, peu après sa condamnation à Amsterdam, il demandait à se convertir, d’abord au luthéranisme, puis au calvinisme et enfin au catholicisme, cela par l’entremise d’une relation avec l’Inquisition des Canaries. Cette trajectoire tortueuse montre aussi un homme à la pensée complexe et « à l’âme en litige » (Jonas Andries van Praag).
Deux gros chapitres sur les mutations intellectuelles permettent de faire le lien entre ces changements de la deuxième moitié du XVIIe siècle et la pensée de Juan de Prado. Diverses sources de nature polémique et de nature judiciaire témoignent des influences du libertinage érudit, des apports d’Epicure et plus généralement du rationalisme sur cette pensée qui débat vivement des thèses sur l’existence de Dieu, sur le salut de l’âme, comme des diverses manifestations de déviances. Ces débats ne sont pas uniquement juifs, ils sont partagés par les élites culturelles de la société dès le milieu du XVIIe siècle, par la remise en cause des certitudes. Peu à peu, un espace laïque se dessine dont les prémices sont encore à peine perceptibles dans la pensée occidentale à la fin du XVIe et que l’auteur attribue à Prado pour le milieu du XVIIe siècle, en intitulant le 11e chapitre « vers un judaïsme laïque ».