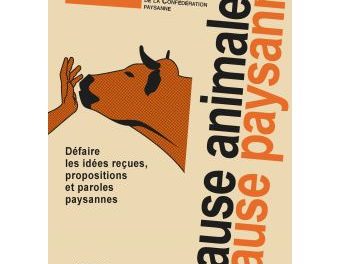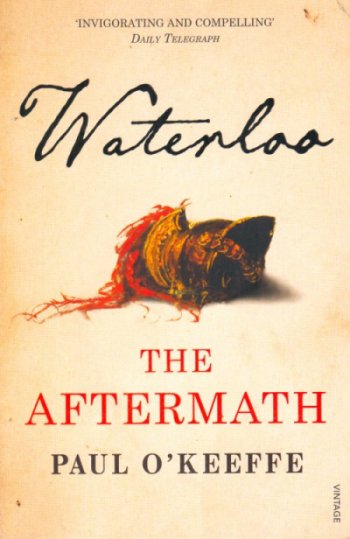
Pourquoi lire sur Waterloo quand on ne vibre pas au souvenir de Napoléon et qu’on avoue regarder avec une indifférence entrecoupée de bâillements les passionnés d’histoire-bataille, les thuriféraires du «Vive l’Empereur !» des forums de la fondation Napoléon et les pères de famille jouant aux petits soldats ?
L’idée n’allait pas de soi, même quand on avait pu naguère vibrer devant les vignettes de Caisse d’Épargne des costumes de la Grande armée (1974 ?) avant d’adopter une vision plus distanciée. C’est donc, un peu malgré soi, en écoutant aux heures de pointe les History-Extra-Podcasts de BBC-History Magazine qu’on se laisse surprendre à écouter O’Keeffe parcourant la morne plaine avec les villageois-pillards, les touristes et les arracheurs de dents. On peut ainsi se convaincre d’entamer un livre sur Waterloo après avoir longtemps pensé que ne rien lire sur la question était une évidence.
A minuit, quand le 18 juin devient le 19
Paul O’Keeffe, qu’on connaît plutôt comme historien d’art, a soin de situer son propos dans le temps court de la bataille, égrenant les heures nocturnes du passage du 18 au 19 juin. Les titres des parties tiennent toujours à un mot symbolique renvoyant au chaos laissé sur le champ de bataille, au processus de diffusion de la nouvelle, à la triviale réalité de la débâcle de la Grande armée et à l’ordinaire de Napoléon lui-même dans les jours qui suivent. L’ouvrage se clôt sur le temps de l’expiation avec une partie s’ouvrant sur une gravure représentant le cadavre de Ney fusillé près du Luxembourg.
Pourquoi tant de haine ?
Le spectacle de la débâcle est d’autant plus accablant que les mémoires contemporaines ont d’autres exodes en tête. Les Britanniques sont frappés par l’acharnement de Blücher et des Prussiens, faisant peu souvent quartier aux Français. La plupart sont désarmés même si quelques vieux grognards gardent leur équipement. Beaucoup sont massacrés, tout comme les blessés rassemblés dans une grange, battus à mort ou passés à la baïonnette avant qu’on mette le feu à l’édifice. Quelques jours avant, les Français achevaient les blessés prussiens à la baïonnette et le général Roguet menaçait de fusiller le premier homme qui lui eût rapporté un prisonnier prussien. Le 19 juin, la Grande armée est dans un sauve-qui-peut général. Fuyant vers la France, les cavaliers bousculent et écrasent des fantassins qui se défendent à la baïonnette. Rattrapés par les Prussiens, des cuirassiers français se brûlent la cervelle après avoir abattu leur cheval.
Carnage
Parmi les scènes du lendemain de Waterloo, il y a ces chevaux rendus fous par leurs blessures et qui piétinent les blessés. Si les Anglo-Alliés et les Prussiens peuvent compter leurs morts, il n’en est pas de même des pertes françaises impossibles à dénombrer. Sur les routes, la progression des cavaliers britanniques est freinée par des cuirasses et un infâme macadam fait de ce qui reste des fuyards massacrés, morts d’épuisement ou écrasés par les chevaux et les lourds convois d’artillerie. Un sergent britannique raconte comment son unité tente de déposer les blessés sur les côtés, suppliée par les Français qui veulent être achevés. Pour certains médecins britanniques, Waterloo fournit l’occasion d’une étude des blessures par sabre ou par armes à feu et justifie qu’on fasse le voyage.
Tourisme, prothèses dentaires et lettres d’amour
Le tourisme à Waterloo commence dès le 19 juin, voire, dans certains cas particuliers, dès la bataille. Les curieux viennent de Bruxelles pour visiter le champ de bataille, au risque parfois d’être agressés par des traînards prussiens ou des survivants ivres. On les voit pressant contre leur nez un mouchoir de soie parfumé pour se protéger des odeurs d’hommes et de chevaux morts ou à l’agonie. Certains distribuent pain et vin aux blessés. Le champ est aussi terre de pillage. Dès le matin du 19 juillet, des villageois viennent se servir après avoir souffert eux-mêmes du passage des armées. Cette pratique du pillage existe aussi chez les soldats qui détroussent parfois leurs propres officiers à peine tombés de cheval. Officiers et soldats, Alliés et Français deviennent vite difficiles à distinguer parce qu’entièrement dévêtus par les détrousseurs qui peuvent être des femmes venues avec des enfants. Des blessés tentent de se défendre. Les corps des Écossais restent dénudés mais conservent ces grosses chaussettes de laine dont les villageois ne savent que faire. Même nu et mort, le soldat peut encore fournir des dents de rechange qu’on revend à prix d’or. Les Français avaient fait de même à Leipzig. Jusqu’à la guerre de Sécession, les horreurs de la guerre dispensent de fabriquer des prothèses. On trouve des bibles dans les poches des Prussiens et de nombreuses feuilles de chansons populaires dans celles des Français. Beaucoup de livrets militaires sont ramassés sur ces derniers. Walter Scott rapporte à Abbotsford celui d’un Mallet servant depuis 1791. A l’exception des Anglais, beaucoup de soldats sont porteurs de lettres de leurs fiancées ou de leurs mères.
50 jours après Waterloo, le drapeau tricolore flotte toujours
Dès le premier chapitre, O’Keeffe souligne les situations fausses nées des Cent-Jours et qui trouvent leur conclusion à Waterloo. Ainsi, c’est le 19 juin 1815, plusieurs heures après la défaite française, que la nouvelle du retour de l’aigle amène le gouverneur de la Guadeloupe à faire hisser le drapeau tricolore. Le fait est observé à distance par une vigie du HMS Venerable mais l’amiral Durham n’intervient pas et se contente de proposer son assistance, faute d’ordres venues de Londres. Si O’Keeffe aborde cet épisode, c’est parce que la Guadeloupe est bien le dernier endroit où flotte le drapeau tricolore en 1815. Et l’auteur de se régaler en ouvrant le dernier chapitre sur la synchronicité entre l’embarquement de Napoléon sur le Northumberland (7 août 1815) et le moment où le gouverneur bonapartiste de la colonie apprend la nouvelle de Waterloo par l’arrivée de trois vagues de débarquement britanniques (8-9 août 1815).
La perfectibilité de l’ouvrage réside sans doute dans ses sources, en anglais ou en français, très peu allemandes, jamais néerlandaises. Les témoignages particuliers sont toujours rétifs aux comptages. O’Keeffe pointe effectivement la propension antisémite des sources à attribuer à des juifs polonais ou russes la fonction de récupération des dents mais, justement, le style narratif se prête assez mal à la déconstruction de ces biais, fautes de chiffres. Malgré un caractère événementiel assumé, on apprécie cet ouvrage de narrative-history/ histoire-récit, écrite de façon un peu littéraire, jamais ennuyeuse et qui semble donner corps à ce que fut Waterloo au delà de l’histoire-bataille et des récits héroïques désincarnés. L’histoire est chair humaine et il y a de la chair humaine dans ce livre.