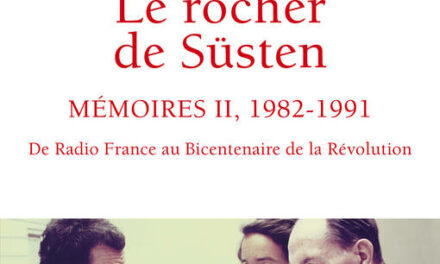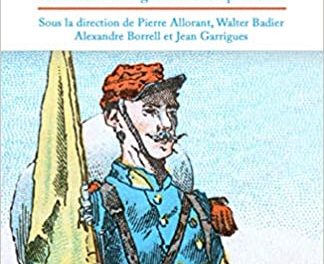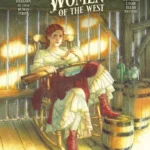La revue Parlement[s], Revue d’histoire politique
Créée en 2003 sous le titre Parlement[s], Histoire et politique, la revue du CHPP change de sous-titre en 2007 pour affirmer sa vocation à couvrir tous les domaines de l’histoire politique. Chaque volume est constitué pour l’essentiel d’un dossier thématique (partie Recherche), composé d’articles originaux soumis à un comité de lecture, qu’ils soient issus d’une journée d’études, commandés par la rédaction ou qu’ils proviennent de propositions spontanées. Quelques varia complètent régulièrement cette partie. La séquence (Sources) approfondit le thème du numéro en offrant au lecteur une sélection de sources écrites commentées et/ou les transcriptions d’entretiens réalisés pour l’occasion. Enfin, une rubrique (Lectures) regroupe les comptes rendus de lecture critiques d’ouvrages récents. Enfin, la revue se termine systématiquement par des résumés et des contributions écrits en français et en anglais (suivis de mots-clés).
Cette revue a été publiée successivement par plusieurs éditeurs : Gallimard (n° 0) en 2003, Armand Colin (n° 1 à 6, H-S n° 1 et 2) de 2004 à 2006, Pepper / L’Harmattan (n° 7 à 20, H-S n° 3 à 9) de 2007 à 2013, Classiques Garnier (n° 21 et 22, H-S n° 10) en 2014 et, enfin, les PUR (depuis le n° 23 et le H-S n° 11) à partir de 2016.
La revue Parlement[s]. Revue d’histoire politique – n° 38 a pour thème : L’école saisie par le politique (XIXe-XXIe siècle). Ce trente-huitième dossier a été coordonné sous la direction de Ismail Ferhat (Professeur à l’Université Paris-Nanterre, CREFi). Comme d’habitude, le dossier se compose de deux éléments distincts : une première partie consacrée à la [Recherche] (avec 5 contributions de 6 chercheurs ou chercheuses, jeunes ou confirmées : Fabien Conord, Ismail Ferhat, Rita Hofstetter et Émeline Brylinski, Clémence Pillot, Karin Fischer et la seconde à des [Sources] (au nombre de 3) commentées par trois enseignants-chercheurs : Jean Baubérot, Ismail Ferhat et Clémence Pillot. De plus, dans ce numéro, nous trouvons une [Varia] (avec la contribution de Jean-Charles Daumy) sans oublier une nouvelle rubrique [L’écho de l’histoire] (avec une communication de Martin Lefranc et à nouveau une partie consacrée à des [Lectures] (au nombre de 8) critiquées par 8 historiens (Julien Gondat, Giuliano Ferretti, Paul Chopelin, Clément Weiss, Paul Smith, Philippe Nord, Laurent Jalabert et, enfin, Arnaud Dupin) puis résumées par Jean-François Bérel, auteur des recensions de la revue Parlement[s]. Revue d’histoire politique pour le compte de « La Cliothèque », rubrique du site de l’association « Les Clionautes ».
Avec une introduction (p. 11-21) intitulée Une histoire politique de l’éducation ?, Ismail Ferhat présente le dossier intitulé L’école saisie par le politique (XIXe-XXIe siècle). École et politique. Le sujet peut paraître de prime abord étonnant – d’autant qu’il est inédit – dans une revue d’histoire politique comme Parlement[s]. Le champ éducatif est de ces thèmes pour lesquels la plupart des partis affichent de manière routinière la priorité qu’ils affectent d’y accorder. Quel responsable ou quelle organisation concourant au jeu démocratique pourrait, en effet, se positionner explicitement contre l’école ? Une telle interrogation ne constitue en rien une pirouette, tant la priorisation de l’éducation contraint aussi bien la construction des projets, la mise en place de l’agenda, la communication et la compétition des organisations politiques. Il n’est ainsi pas fortuit, entre autres exemples, que les quatre principaux candidats à l’élection présidentielle française de 2012, François Hollande, Marine le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Nicolas Sarkozy, par-delà des positionnements idéologiques très divergents, aient chacun consacré soit un discours majeur, soit une partie notable de leurs programmes à l’éducation. Les systèmes éducatifs, soumis à un investissement croissant de la part des organisations et responsables politiques, ont parfois réussi à absorber, limiter ou réduire les changements de trajectoire que ceux-ci leur destinaient. De l’Irlande aux assemblées internationales à Genève, du XXe siècle à nos jours, cette autonomie relative de l’institution scolaire n’est-elle pas, au fond, un hommage aux pouvoirs publics qui ont contribué à en faire une structure pérenne et déterminante au sein des démocraties libérales ? Ce n’est peut-être pas le moindre des paradoxes de la nécessaire histoire politique de l’éducation.
[RECHERCHE]
VU DE FRANCE
R 1- Les gauches françaises et l’EPS, 1945-1981 (p. 27-41)
Fabien Conord (Professeur d’histoire contemporaine à l’Université Clermont-Auvergne, CHEC)
Les gauches françaises portent un regard contrasté mais souvent méfiant à l’égard du sport et de ses manifestations ; en revanche, elles accordent une attention soutenue à l’éducation. À la charnière de ces deux domaines, l’enseignement de l’EPS constitue donc un terrain propice à l’étude de leurs ambitions et de leurs contradictions en matière éducative et sportive.
R 2- Les projets éducatifs à l’épreuve de la gestion du pouvoir. L’exemple des droites parlementaires face à la libéralisation de l’école durant les années 1980 (p. 43-58)
Ismail Ferhat (Professeur à l’Université Paris-Nanterre, CREFi)
Les droites parlementaires françaises ont connu une poussée libérale dans leurs projets et discours pour l’école durant la première moitié des années 1980. Cependant, durant la première cohabitation (1986-1988), leurs politiques éducatives ont été marquées par une grande continuité, un paradoxe que cet article souhaite expliquer en recourant à une approche interdisciplinaire (sciences de l’éducation, science politique). Il s’appuie sur l’analyse des programmes politiques et de la littérature grise du RPR, de l’UDF et de ses composantes, l’exploitation d’archives (cabinets du Ministre de l’Éducation nationale, syndicalisme enseignant).
PERSPERTIVES INTERNATIONALES
R 3- La saisie de l’école à l’échelle de la planète. Le défi du Bureau intergouvernemental de l’éducation (1929–1958) (p. 61-87)
Rita Hofstetter (Professeure, Université de Genève, ERHISE) et Émeline Brylinski (Postdoctorante, Université de Genève)
Sous l’égide de Jean Piaget (1929-1968), le Bureau international d’éducation prétend résoudre les problèmes éducatifs de la planète dans une « stricte neutralité et objectivité ». Est-il concevable de préserver des Conférences internationales de l’instruction publique de toute interférence et, le cas échéant, à quelles conditions ? La politisation peut être la résultante d’une accumulation de « petites » dynamiques comme de stratégies employées pour centraliser une idée dans un débat, ou des interventions rappelant des divergences idéologiques. Mais cela se perçoit aussi dans ce qui est invisible et non-dit : lorsqu’une idée évoquée n’est pas retenue dans la recommandation finale, lorsque des amendements ne sont pas pris en compte.
R 4- Public schools britanniques : l’impossible réforme ? (p. 89-105)
Clémence Pillot (Maîtresse de conférences en civilisation britannique, Université Paris 1-Panthéon Sorbonne, PRISM)
En dépit des avancées apportées par le Butler Education Act (1944), les public schools britanniques ont continué d’occuper, dans la seconde moitié du XXe siècle, une place centrale dans la formation des élites comme dans les représentations collectives. Cet article se propose d’étudier la façon dont ces établissements privés ont réussi à maintenir leur influence en dépit des tentatives répétées de réforme du Labour Party et sont progressivement devenus un enjeu de polarisation du débat politique britannique.
R 5- Quand le politique se dessaisit de l’école ? Un paradoxe irlandais persistant (p. 107-122)
Karin Fischer (Professeure à l’université d’Orléans, laboratoire RÉMÉLICE)
Le propos de cet article est de mettre en évidence deux tendances historiques contradictoires depuis la création de l’État irlandais en 1922, entre une volonté nette du politique de façonner l’école et les futurs citoyens et travailleurs irlandais d’une part, et des formes de délégation de pouvoir voire d’autocensure persistantes en termes de politiques éducatives nationales d’autre part, avec un rôle prépondérant toujours accordé à l’Église catholique. Du point de vue des contenus et objectifs assignés à l’école par l’État, l’examen historique donne à voir différentes phases depuis la création de l’État, et particulièrement au cours des dernières décennies depuis les années 1960, avec des priorités allant de la transmission identitaire au développement économique. En termes structurels, la délégation par l’État de la majeure partie du système scolaire à l’Église catholique (et dans une bien moindre mesure aux Églises protestantes) et plus largement aujourd’hui à des instances privées et/ou religieuses reste la norme en dépit de quelques inflexions, mais sur des bases maintenant plus néolibérales que théocratiques.
[SOURCES]
S 1- Jules Ferry, Lettre à « Monsieur l’Instituteur », 17 novembre 1883 (p. 125-139)
Jean Baubérot (Directeur de recherches, Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (EPHE – PSL – CNRS)
La « Lettre à Monsieur l’Instituteur » est le texte le plus célèbre de Jules Ferry. C’est aussi son « testament » en tant que ministre de l’Instruction publique, car il l’a rédigé lorsqu’il quittait ce ministère, occupé presque sans interruption durant quatre ans. C’est, enfin, un acte politique important, voulant indiquer la ligne à suivre pour pouvoir réussir le difficile pari d’une école publique laïque, donnant un enseignement moral dans le respect de la « liberté de conscience ».
S 2- Quand une organisation politique pense les mobilisations dans le secteur éducatif : l’Internationale socialiste en 1968 (p. 141-149)
Ismail Ferhat (Professeur à l’Université Paris-Nanterre, CREFi)
Les mobilisations dans le secteur éducatif constituent, dans les démocraties libérales, un sujet particulièrement sensible pour les forces politiques et les gouvernements. En effet, les protestations d’élèves et d’étudiants tendent à être relativement populaires, rendant leur traitement – notamment sécuritaire – plus difficile pour les pouvoirs publics. Les cas de mobilisations lycéennes et étudiantes contre le projet Devaquet de réforme de l’Enseignement supérieur en 1986, ou contre le CPE en 2006, en sont des exemples éloquents pour la France. La note de l’Internationale Socialiste, en réduisant la révolte estudiantine de mai 1968 à un mouvement d’enfants gâtés, révèle aussi le décalage générationnel qui se noue dans les années 1960 entre des partis globalement vieillissants et les jeunes nés après 1945.
S 3- En couverture, Margaret Thatcher dans une école à Birmingham (1971) (p. 150-155)
Clémence Pillot (Maîtresse de conférences en civilisation britannique, Université Paris 1-Panthéon Sorbonne, PRISM)
Le 12 novembre 1971, Margaret Thatcher, alors secrétaire d’État à l’Éducation dans le gouvernement d’Edward Heath, visite la Chandos Junior and Infants School de Deritend, à Birmingham. En déplacement dans les Midlands, région dont elle était elle-même issue, même si tout ou presque séparait la petite ville de Grantham des cités industrielles telles que Birmingham, Thatcher se rend successivement dans les écoles primaires de Deritend, d’Erdington, à l’est de la ville, et à la mairie de Birmingham. La photographie sur laquelle la secrétaire d’État, vêtue d’un ensemble de fourrure noire et blanche, observe d’un air bienveillant le travail de l’écolière Claire Coates, ne révèle rien du contexte politique troublé du moment. Margaret Thatcher est alors connue dans les cours de récréation du pays comme « la voleuse de lait » (« the milk snatcher »), le tabloïd The Sun allant jusqu’à la qualifier de « femme la plus impopulaire de Grande Bretagne » à la fin du mois.
[VARIA]
V 1- Des salons à l’Assemblée constituante : le duc de Liancourt ou la formation d’un aristocrate libéral et réformateur (1768-1827) (p. 159-175)
Jean-Charles Daumy (Doctorant en histoire moderne, CEMMC (EA 2958), Université Bordeaux Montaigne)
Le duc de La Rochefoucauld-Liancourt, connu sous l’Ancien Régime sous son premier titre de « duc de Liancourt », n’a laissé que quelques pages de mémoires politiques dans lesquelles, avec une modestie non dissimulée, il tente de revenir rapidement sur ses agissements pendant les temps révolutionnaires. C’est plus particulièrement son cheminement au sein de l’Assemblée nationale constituante qui l’occupe ici et il est à la fois remarquable et inattendu de lire, sous la plume d’un représentant d’une noblesse de la plus ancienne roche, qu’il fit partie du « côté gauche ». Il s’inscrit en cela dans le microcosme de la haute noblesse libérale qui participait de la grande diversité politique des noblesses au temps de la Révolution. Il faut néanmoins prendre du recul vis-à-vis de cette affirmation du duc, écrite rétrospectivement, d’autant plus qu’il fut un soutien inconditionnel de Louis XVI, ce qui le conduisit à l’exil. Cette grande noblesse était un vivier de ducs arborant des idées progressistes et pour le moins réformatrices, qui ont donné naissance à ce qui a été appelé le « parti des ducs ». Si certains membres du second ordre se sont illustrés par des idées en rupture totale avec le système monarchique, à l’image d’Antonelle et d’Hérault de Séchelles qui siégèrent avec la Montagne, la Grande-Bretagne et son régime parlementaire furent pour beaucoup d’autres un support de réflexion, voire un modèle politique dont la construction leur permettait de concilier leurs idées neuves et avec le souci de conserver leurs places, leur patrimoine et leur prestige social.
[L’ECHO DE L’HISTOIRE]
E 1- 50 ans après, quel bilan pour le Front national ? (p. 179-183)
Martin Lefranc (Doctorant à l’Université d’Orléans, Laboratoire POLEN – EA 4710)
« 50 ans après, quel bilan pour le Front national ? » : c’est le thème de la journée d’études qui s’est tenue le 28 octobre 2022, dans les locaux de l’Université de Valenciennes. À l’occasion du cinquantenaire de la création du parti d’extrême droite, plusieurs spécialistes se sont réunis à l’initiative de MM. Frédéric Attal, Christophe Bourseiller, Jean-Yves Camus et Sébastien Repaire, et de l’Observatoire des extrémismes et des signes émergents (OESE). Cette rencontre a été l’occasion de dresser un bilan des cinquante ans d’histoire du parti, en étudiant ses reconfigurations successives sur le temps long, ou en réduisant ponctuellement la focale sur quelques objets précis et moments clés de son histoire. La tenue de cette journée coïncide avec l’ouverture, il y a quelques mois, du fonds Christophe Bourseiller, composé de près de 45 000 documents d’archives, portant sur les courants extrémistes de la vie politique française depuis 1945. Ce fonds, dont les archives sont consultables à la Bibliothèque universitaire du Mont Houy à Valenciennes, renferme plus de 7 000 documents sur le seul Front national. Pour faire la synthèse de l’apport des deux tables rondes et des six différentes interventions, Frédéric Attal distingue différentes phases dans l’évolution idéologique du FN. Au stade de groupuscule, le parti a d’abord tenté un syncrétisme de l’offre disponible à l’extrême droite. Avec son émergence dans le jeu politique républicain, il a cherché à jouer sur le terrain de la droite de gouvernement. À partir des années 1990, le FN devient un parti « attrape-tout », qui veut séduire un électorat populaire. Aujourd’hui, le RN est structurellement installé dans le jeu politique français, et apparait comme une force d’alternance possible, dans un contexte international plutôt favorable, avec le succès récent de Fratelli d’Italia en Italie.
[LECTURES]
L 1- Anne Gangloff et Gilles Gorre (dir.), Le corps des souverains dans les mondes hellénistique et romain, Rennes, PUR, 2022, 422 p. par Julien Gondat / CRISES, Université Montpellier III (p. 189-192)
Parce que la monarchie transforme considérablement le monde grec dès la mort d’Alexandre et de la République romaine avec l’avènement d’Auguste, le corps des souverains est un objet d’étude indispensable à la compréhension des époques hellénistique et impériale. Longtemps laissé aux mains des médiévistes et des modernistes (le livre pionnier d’E. Kantorowicz, The King’s Two Bodies, date de 1957), le sujet est désormais très actuel. Et pour cause, depuis Homère, le corps présente des aspects symboliques relevant de la représentation et de la communication dans le but d’exprimer le pouvoir. Se cache cependant, derrière, une réalité physique difficile à saisir, celle d’hommes comme les autres, malades et mortels. Comment les rois et les empereurs ont-ils concilié les deux ? La réponse n’est pas toujours identique (comme le rappellent A. Gangloff et G. Gorre). Cet ouvrage collectif, fruit d’un colloque organisé à Rennes en 2018, a en effet pour but de comparer la conception que les Grecs et les Romains avaient du corps des souverains, en tant que construction culturelle et politique, en sollicitant tout type de source. Réunissant 18 contributions, le volume s’articule en quatre parties. Mais en préambule, les organisateurs ont judicieusement invité le médiéviste F. Mercier pour une mise au point concernant la fameuse théorie du double corps du roi de Kantorowicz, afin d’interroger sa pertinence pour l’Antiquité : dans l’Occident médiéval, le corps politique du roi s’incarne dans son corps naturel en imitant le processus d’incarnation du Christ propre à la théologie de cette période. L’auteur invite donc à la prudence.
L 2- Samuel Hayat, Corinne Péneau et Yves Sintomer (dir.), La représentation avant le gouvernement représentatif, Rennes, PUR, 2020, 366 p. par Giuliano Ferretti / LITT&ARTS, Université Grenoble Alpes (p. 192-194)
Savamment construit autour d’une double ambition, l’une interdisciplinaire – faire dialoguer l’histoire et la science politique – et l’autre comparatiste – réunir plusieurs spécialistes de ces disciplines –, cet ouvrage offre un cadre européen d’analyse allant de la France à la Russie et de la Suède à l’Italie, complété par une enquête originale des représentations en Chine. Le pari est celui d’offrir un panel d’études touchant plusieurs disciplines et aires géographiques pouvant aboutir à terme à une réflexion globale sur les formes de la représentation dans la période médiévale et moderne. Le résultat est plus que probant. D’abord, le volume offre une étude articulée des formes de délégation et de nomination, souvent jugées secondaires, comme celles des assemblées ; ensuite, il éclaire toutes sortes de pratiques représentatives, avec une attention particulière portée sur les mécanismes spécifiques qui rendent possible la représentation : le vote, le tirage au sort et la construction du dialogue entre gouvernants et gouvernés, en particulier dans les états, conseils, parlements et diètes.
L 3- Pauline Valade, Le goût de la joie. Réjouissances monarchiques et joie publique à Paris au XVIIIe siècle, Ceyzérieu, Champ Vallon, 2021, 383 p. par Paul Chopelin / LARHA, Université Jean Moulin Lyon 3 (p. 194-197)
Dans ce livre issu de sa thèse de doctorat, Pauline Valade jette un regard neuf sur l’histoire des émotions à l’époque moderne en s’intéressant aux manifestations de joie publique que constituent les réjouissances parisiennes, de la fin du règne de Louis XIV à l’été 1789. Distincte de la fête, même si tous les contemporains ne sont pas d’accord sur ce point, la réjouissance est considérée comme plus spontanée. Elle est une manifestation d’enthousiasme populaire à l’occasion d’événements gratifiants pour le public, gages de stabilité et de prospérité pour le royaume : les naissances et les mariages princiers, les victoires militaires et les accords de paix. Ce phénomène est étudié au prisme des riches archives parisiennes : archives de la Maison du roi, de la Ville, du Parlement, du Châtelet et de diverses autres juridictions aux Archives nationales, complétées par la masse de manuscrits et d’imprimés conservés dans les autres bibliothèques et dépôts d’archives de la capitale.
L 4- David A. Bell, Le culte des chefs. Charisme et pouvoir à l’âge des révolutions, traduction de l’anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat et Aude de Saint Loups, Paris, Fayard, 2022, 376 p. par Clément Weiss / IHMC, Université Paris-I (p. 197-200)
Après avoir proposé dans son précédent ouvrage une relecture « politique » des guerres européennes des années 1792-1815 suggérant que les belligérants ont, dans leurs discours et leurs intentions, renoncé aux limitations traditionnelles de l’intensité guerrière pour basculer vers un engagement « total », David Bell continue à éclairer le « potentiel plus sombre de l’âge révolutionnaire et de la culture des Lumières » (p. 16) en montrant comment l’émergence d’une culture démocratique a facilité la prise de pouvoir de cinq militaires érigés en « héros charismatiques ». En dépit d’origines sociales diverses, aucun de ces cinq hommes n’était destiné à régner et tous appartenaient à des territoires sous domination métropolitaine : une petite île méditerranéenne vendue par Gênes à la France (Pascal Paoli et Napoléon Bonaparte) ou des colonies anglaises, françaises ou espagnoles en Amérique (George Washington, Toussaint Louverture et Simón Bolívar). En cela, la dimension strictement personnelle de leur charisme les distingue de Louis XIV, Pierre Ier de Russie ou Frédéric II de Prusse car ils n’incarnent pas un principe monarchique qui les précède et doit leur succéder. Leurs ascensions en font au contraire les incarnations ambiguës d’une méritocratie davantage aristocratique que républicaine dans laquelle les prodiges et la popularité du meilleur chef de guerre lui permettent d’exercer un pouvoir autoritaire et de limiter l’expression de ce peuple dont il se prétend l’émanation à des acclamations triomphales.
L 5- Bernard Lachaise, À la gauche du gaullisme, Paris, Presses universitaires de France, 2022, 266 p. par Paul Smith / Université de Nottingham (p. 201-203)
La contribution de Bernard Lachaise à l’histoire du personnel politique français et des partis est déjà prolifique et ne manque jamais de satisfaire le lecteur. À la gauche du gaullisme en constitue un nouvel opus. Les relations et les rivalités – personnelles et doctrinales – entre les gaullistes de gauche entre eux sont soigneusement cataloguées et explorées avec la clarté à laquelle nous nous sommes habitués. Se frayer un chemin à travers l’enchevêtrement de cercles, de clubs et de groupuscules n’est pas facile, mais la feuille de route de Bernard Lachaise est précise et clairement balisée. Citons, par exemple, l’analyse de la période qui suit la réélection de De Gaulle et la réaction robuste en mai 1966 des gaullistes de gauche et de leurs alliés à la dérive droitière et conservatrice du parti sous l’égide de Pompidou. Voilà un livre qui ne commence pas, et ne termine pas non plus avec le Général. En fait, Bernard Lachaise fait un excellent travail en décrivant non seulement les origines des gaullistes de gauche mais aussi comment ils ont continué, bien au-delà de la République gaullienne, à s’opposer au pompidolisme, au giscardisme et même à Chirac, allant – pour ceux qui sont restés du moins – jusqu’à soutenir Jean-Pierre Chevènement à la présidentielle de 2002. C’est là toute l’importance du livre. Il s’étend sur toute la vie politique française d’après-guerre jusqu’au temps présent. C’est un handbook incontournable d’un mouvement assez mal connu et compris.
L 6- Sylvie Guillaume, Les rebelles de la politique, posture ou sincérité ? Paris, Armand Colin, 2022, 254 p. par Laurent Jalabert / ITEM, Université de Paul et des pays de l’Adour (p. 203-205)
Sylvie Guillaume, professeure émérite à l’Université de Bordeaux Montaigne, présente dans cet ouvrage sous la forme d’un essai historique une approche comparée des parcours politiques de quelques figures de la Ve République qu’elle considère comme des « Rebelles » : Charles de Gaulle, Pierre Mendès France, Georges Pompidou, Raymond Barre, Simone Veil, Robert Badinter, Michel Rocard, Jean-Pierre Chevènement, Philippe Seguin, Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron. Onze personnalités politiques, dix hommes, une femme, sont scrutés par l’historienne dans leurs cheminements politiques, par une démarche originale, à savoir par le prisme d’une posture politique, tant dans le jeu des institutions, que dans celui de leurs familles politiques respectives ou celui de leurs propres parcours personnels et familiaux. Cette posture est celle de « la rébellion », terme explicité par l’auteure dans l’introduction, qui l’aborde de façon « polymorphe » et surtout contextualisée. Être rebelle en juin 1940, ne signifie pas la même forme de rébellion qu’en mai 1958 ou mai 1968 ! De même, pour Sylvie Guillaume, si le rebelle est le plus souvent considéré comme une personnalité « contre », « hostile au système », dans une posture en général « subversive », ou qui se place en dehors de la norme dominante, il convient de ne pas oublier que la « rébellion si elle peut être destructrice, peut aussi et, c’est notre hypothèse, être constructive » (p. 17). Les rebelles de Sylvie Guillaume ne cherchent donc pas à détruire le système dans lequel ils gravitent, mais parce qu’ils sont « révoltés » en leur for intérieur, s’essaient dans le champ politique de leur temps à en changer « les normes », à les « moderniser », bref à bousculer les habitus sans en changer les socles. Si la définition peut être discutée, ainsi posée, elle inscrit les portraits comparés des rebelles dans une approche globale très claire et qui permet de suivre aisément le cheminement de chacun dans leur rébellion.
L 7- Jean-Pierre Chevènement, Qui veut risquer sa vie, la sauvera. Mémoires, Robert Laffont, 2020, 494 p. par Arnaud Dupin / ITEM, Université de Paul et des pays de l’Adour (p. 205-208)
Acteur majeur de la vie politique française des années 1970 aux années 2000, Jean-Pierre Chevènement livre dans Qui veut risquer sa vie, la sauvera son testament politique. Durant les années 1960-1970, à la SFIO puis au PS, il souhaite avec son entourage politique revivifier le marxisme afin de construire un parti de masse à gauche de nature à conquérir le pouvoir. En 1966, Chevènement et ses proches créent à cet effet le CERES, club de réflexion politique. Le CERES devient rapidement un courant politique à part entière. Face à l’agonie de la « vieille maison » dont l’inamovible secrétaire général est le principal responsable, il se rapproche de François Mitterrand qui défend comme lui une union de la gauche avec les communistes. C’est ainsi que lors du congrès d’Épinay, Jean-Pierre Chevènement et ses amis sont intégrés à la majorité mitterrandienne qui conquiert le parti. Malgré des soubresauts (rupture entre 1975 et 1979), le CERES fera partie de l’aventure de la victoire de 1981. D’ailleurs Jean-Pierre Chevènement devient ministre de la recherche et de la technologie après le 10 mai. En désaccord avec la « rigueur » mise en place par le gouvernement socialiste à partir de 1983, il démissionne. L’année suivante, Laurent Fabius lui attribue néanmoins le ministère de l’Éducation nationale. En 1986, Le CERES devient Socialisme et République. En 1988, Jean-Pierre Chevènement entre au gouvernement Rocard en tant que ministre de la Défense. Plus largement, Chevènement se trouve en désaccord avec les orientations du second septennat et démissionne du PS en 1993. Il crée alors le Mouvement Des Citoyens sans rompre avec la gauche en reconstruction. Accusé par les socialistes d’avoir causé la défaite de Jospin au premier tour, il se trouve marginalisé au sein de la gauche et décide alors de créer le Mouvement Radical et Citoyen afin de regrouper les républicains de tout bord. Sommé de se placer sur l’échiquier par la direction du MRC, il n’hésite pas à démissionner du mouvement en 2015. Souhaitant continuer à influencer le pouvoir malgré son âge, Chevènement se rapproche d’Emmanuel Macron.
L 8- Philippe Buton, Histoire du gauchisme. L’héritage de Mai 68, Paris, Perrin, 2021, 560 pages par Ismail Ferhat / CREF, Paris-Nanterre (p. 208-210)
Le gauchisme est une notion à manier avec précaution depuis sa popularisation par Lénine en 1920. C’est donc à un sujet loin d’être apaisé, et encore moins consensuel, que s’attaque Philippe Buton, spécialiste reconnu de l’histoire politique française contemporaine, dans un dense ouvrage. Celui-ci s’appuie sur un riche appareil archivistique, issu des organisations, des forces de l’ordre, de la littérature grise et sur des témoignages d’acteurs. Tout d’abord, comment définir le gauchisme ? Page 229, l’auteur emploie la belle forme d’une « volonté de brutaliser les rapports sociaux ». C’est bien cette obsession qui est commune à un courant par ailleurs divisé en chapelles concurrentes. Philippe Buton concentre sa riche étude sur la décennie de plus forte influence des gauchistes, à savoir les années 1968-1981. Comment expliquer cette éruption – qui n’est d’ailleurs, l’auteur le rappelle à plusieurs reprises, pas propre à la France ? Trois facteurs apparaissent, de nature sociologique, politique et culturelle. Le premier est la distorsion croissante entre une société française bouleversée par les mutations (baby-boom, croissance économique, urbanisation) et une présidence gaullienne très conservatrice en matière de mœurs. Le deuxième est l’institutionnalisation du PCF, dont les responsables font désormais figure de notables, créant un espace politique inédit sur sa gauche. Le troisième est la démocratisation scolaire : la massification (relative) de l’accès au baccalauréat et le triplement dans les années 1960 du nombre d’étudiants font de la jeunesse scolarisée un groupe social inédit. Le gauchisme profite de cette triple tension, qui converge dans l’explosion de Mai 68.
© Les Clionautes (Jean-François Bérel pour La Cliothèque)