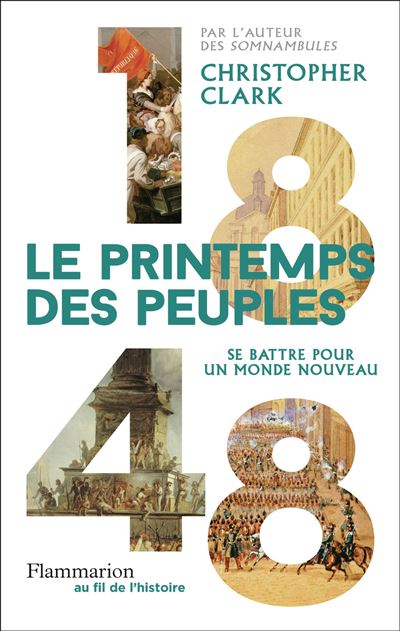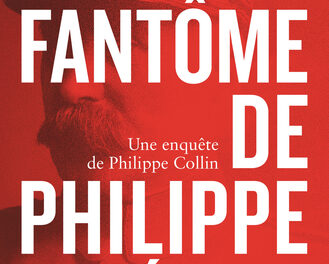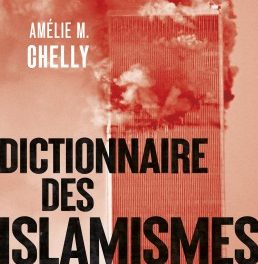Il y a onze ans, la publication des Somnambules, magistrale relecture des origines du premier conflit mondial, projetait sur le devant de la scène historiographique le professeur Christopher Clark. Australien d’origine, ayant d’abord étudié à Sydney, Christopher Clark a ensuite orienté ses recherches vers l’Europe (et en particulier la Prusse) à Berlin, puis à Cambridge ; c’est dans cette université qu’il enseigne encore aujourd’hui au sein du St Catharine’s college. Il occupe de nouveau depuis quelques mois l’actualité littéraire avec une nouvelle fresque de grande ampleur, qu’on ne peut que remercier Flammarion de rendre enfin accessible au public francophone après de premières éditions allemande, anglaise, espagnole… et qui est consacrée à un autre spectaculaire moment de turbulence européenne. Le « printemps des peuples » devait en effet, pendant quelques mois de l’année 1848, se matérialiser par une série de révolutions aux quatre coins de notre continent, l’effondrement de l’ordre politique mis en place à la chute de Napoléon quelques décennies plus tôt, et maintes autres évolutions, avant que les régimes au pouvoir ne réinstaurent progressivement un contrôle sévère sur les Etats impactés – sans pour autant faire l’économie de la prise en compte des changements issus d’une période foisonnante et extraordinaire.
Aux sources de 1848
Par l’ampleur géographique et typologique des événements, le pari est ambitieux ; mais l’auteur se donne les moyens de l’aborder à travers un texte dense (pour la présente édition française, due au travail de traduction de Marie-Anne de Béru et Gabriel Boniecki, plus de 700 pages d’une écriture serrée) et structuré en neuf gros chapitres. Il en détaille les enjeux dans une prenante introduction (p.11-23) : nationalisées à posteriori, les révolutions de 1848 apparaissent en réalité comme un phénomène d’ampleur unique dans l’histoire européenne, aux répercussions mondiales ; elles ont brassé nombre de problématiques (les droits sociaux, la pauvreté, le droit au travail, en lien avec l’exercice des libertés…) qui n’ont rien perdu de leur actualité ; et leur échec n’est qu’apparent.
L’auteur entame ensuite son étude sur un tableau fouillé des « Questions sociales » (chapitre 1, p.25-99) à la veille de 1848, arrière-plan indispensable à la compréhension des événements, et progressivement objet de l’intérêt d’un certain nombre d’esprits de l’époque. Il en ressort que l’Europe du deuxième quart du XIXè siècle est marquée par des situations de précarité économique et d’anxiété omniprésente ; l’expression « paupérisme » caractérise cette pauvreté systémique, qui semble découler d’un accroissement démographique massif qui expose d’autant plus la population en cas de crise toujours possible dans un contexte de gestion des ressources fragile – et 1845-1847 est marquée par une grave crise agraire et industrielle. Du mécontentent social découle une polarisation politique croissante, l’exaspération conduisant parfois à l’ultraviolence, comme l’illustrent, entre autres épisodes, la révolte des Canuts à Lyon (1834), les troubles de Bohême-Moravie et de Silésie (1843-1844), et les sanglants et méconnus événements de Galicie en 1846, au cours duquel c’est significativement une contre-insurrection paysanne qui met fin à la tentative de soulèvement national des élites polonaises.
Le chapitre suivant amène ensuite l’attention à se porter sur un essai de définition des identités, encore mouvantes, qui alimentent les débats intellectuels et politiques de l’époque (« Visions du monde », p.100-172). Quelques figures précurseuses tentent en vain de secouer le carcan d’une inégalité de sexes encore très marquée. Tandis que les libéraux s’accordent sur la revendication de libertés, très tempérées pour éviter les excès, à leur gauche les radicaux (au nombre desquels socialistes et démocrates) revendiquent le suffrage universel, s’intéressent à la répartition des richesses et prônent l’action directe, alors que les conservateurs s’attachent à défendre un état des choses légitimé par l’ordre naturel et/ou divin. Le sentiment religieux connaît un nouvel essor, stimulé par le découplage de la foi par rapport aux structures de l’autorité ecclésiastique affaiblies par les périodes révolutionnaire et napoléonienne et une plus grande individualisation. Qu’elle soit vue comme héritage du passé ou construction à élaborer, la nation prend quant à elle une consistance certaine dans les années 1830-1840 – du moins dans les villes, et sans pour autant supplanter toutes les autres identités avec lesquelles elle doit cohabiter. Enfin, si les consciences reconnaissent l’impératif moral de l’abolition d’un esclavage toujours massif, le poids social de celui-ci la rend encore hypothétique. C’est donc dans un archipel d’arguments et de chaînes de pensées en pleine évolution que les Européens de l’époque tracent un parcours qui peut par conséquent être mouvant.
Dans ce contexte, les deux décennies précédant 1848 sont marquées par des conflits politiques diversifiés (chapitre 3, « Confrontation », p.173-263). Les Trois Glorieuses parisiennes de 1830, triomphe des libéraux les plus modérés, sont suivies par la multiplication des insurrections armées, radicales en France (1832, 1834, 1839…), nationales en Italie, sous l’influence de Mazzini, aux racines et manifestations complexes en Allemagne où elles témoignent d’une politisation croissante des sociétés. De la question de la réforme constitutionnelle, imbriquée avec des clivages religieux très anciens, découlent plusieurs conflits qui déchirent les cantons suisses ; en Hongrie, les patriotes menés par Kossuth obtiennent une audience croissante. Le « roc de l’ordre » symbolisé par l’autrichien Metternich tente de répondre aux défis des activistes par le développement de tout un appareil sécuritaire diversifié ; mais, orienté vers la lutte contre les conspirations, il n’est en rien préparé aux phénomènes de masse qui vont marquer les débuts du Printemps des peuples. Dans le contexte de la crise agricole de 1846-1847, les tensions s’accumulent : en France, le conservatisme prôné par Guizot se heurte à une opposition de plus en plus forte qui s’exprime lors de la « campagne des banquets » ; la montée sur le trône papal du réformiste modéré Pie IX en fait bientôt l’espoir de tous les patriotes italiens, tandis que dans le même temps la victoire de la Diète fédérale suisse sur les cantons conservateurs ligués au sein du Sonderbund déclenche l’enthousiasme des libéraux européens…
Un printemps européen
Voici venu le temps des « Détonations » (chapitre 4, p.264-340) : la première éclate à Palerme en janvier 1848, l’insurrection conduisant le roi des Deux-Siciles à abandonner l’île, puis à promettre une constitution aux Napolitains. En février, les Parisiens poussent Louis-Philippe à l’abdication ; dans les semaines qui suivent, les troubles s’accélèrent et se complexifient à travers toute l’Europe : tandis que Metternich doit s’enfuir de Vienne, les Hongrois imposent aux Habsbourg un gouvernement autonome. A Berlin, le roi Frédéric-Guillaume doit consentir à réformer après des affrontements sanglants. « Les cinq jours de Milan » amènent les Autrichiens à évacuer la ville et une bonne partie de la Lombardie. Revendications d’une constitution, des libertés, de la création d’une garde civile (ou nationale), du droit de vote…, l’auteur rappelle l’improvisation des évènements et la similitude des mots d’ordre aux quatre coins du continent, le tout découlant de l’importance, dans ce qui semble être un mouvement irrépressible, de l’interconnexion des courants d’idées et des nouvelles. Au rebours de certains présupposés selon lesquels les pays du nord-ouest de l’Europe ont échappé à la Révolution de 1848 parce que des réformes politiques et sociales avaient déjà apaisé leur population, il montre pareillement que c’est par une gestion proactive, alliant aspects sociaux et sécuritaires, que la Belgique et la Grande-Bretagne évitent les troubles, tandis que Pays-Bas et Espagne, par une réactivité adaptée de leurs gouvernants, parviennent à très vite les étouffer.
Partout ailleurs, des « Changements de régime » (chapitre 5, p.341-401) s’imposent et se matérialisent. Les espaces urbains qui en ont été le cadre sont sublimés, les morts tombés au cours des combats sont honorés, des gouvernements provisoires s’établissent progressivement à Paris, Milan, Venise, Palerme, Bucarest… tandis que, dans les pays où les structures de souveraineté pré-révolutionnaire restent en place, personnalités anciennes et nouvelles doivent partager le pouvoir. Ces processus qui mènent à la quasi-stabilisation d’un ordre post-insurrectionnel se révèlent extraordinairement divers ; nonobstant leur fragilité, l’engagement des révolutionnaires en faveur un gouvernement représentatif débouche rapidement sur la convocation de chambres élues auxquelles il revient d’établir un cadre juridique durable, capable de canaliser les acquis de la révolution dans un ordre politique stable et pérenne – un parlement national allemand, visant à superviser l’union politique des Etats germaniques, se réunissant même à Francfort. En découle une floraison d’assemblées (d’ailleurs majoritairement conservatrices) et de constitutions ; que les unes comme les autres se soient finalement avérées, dans certains cas de figure, très temporaires ne doit pas, selon l’auteur, masquer leur importance en terme d’espaces de maturation de l’expérience politique et de normalisation dans les esprits contemporains de ce type de textes contractuels.
Les quelques mois qui suivent les révolutions de février-mars 1848 sont aussi l’enjeu d’« Emancipations » (chapitre 6, p.402-457). L’auteur s’attache à démontrer que, quelles que soient intentions et déclarations, et certaines interprétations téléologiques ultérieures, celles-ci s’avèrent tortueuses et incomplètes. En France, si le décret du 27 avril inspiré par Schoelcher impose l’abolition de l’esclavage, le processus qui l’efface comme réalité sociale se révélera long, complexe, différencié selon les espaces géographiques. Dans une société à la structure patriarcale inébranlable, la lutte que mènent quelques militantes contre les multiples incapacités légales et politiques qui s’imposent aux femmes ne débouche sur rien. Pareillement, la disparition des lois spéciales et restrictives qui s’appliquent à la plupart des Juifs d’Europe – la France constituant dans ce domaine une exception – va se révéler interminable et ponctuée d’à-coups, ne pouvant être considérée comme aboutie, dans les faits plutôt que dans les consciences, que plus de deux décennies plus tard ; tout comme l’émancipation légale des esclaves roms de Valachie.
« Silence aux pauvres » / l’Empire contre-attaque
Bientôt, l’élan révolutionnaire se heurte à une « Entropie » certaine (chapitre 7, p.458-547). L’ivresse unificatrice des premiers jours se fissure progressivement ; l’émergence de nouvelles formes de pouvoir concurrentes rend l’atmosphère volatile. A Paris, à Berlin, les relations se tendent entre radicaux et libéraux ou conservateurs ; une insurrection radicale est écrasée en Bade, tandis qu’à Vienne, la fuite de la cour à la mi-mai laisse les révolutionnaires maîtres de la ville. Le monde rural reste en outre ignoré par les nouvelles élites urbaines. Favorisés par les événements, des nationalismes militants émergent et complexifient encore la donne. En Italie, le Piémont, rejoint par des contingents venus de toute la péninsule, est entraîné à envahir la Lombardie – mais c’est pour en être piteusement débouté par l’Autrichien Radetzy fin juillet-début août. La confédération germanique s’engage pareillement au bénéfice du duché du Schleswig annexé par le Danemark. Les territoires de l’empire autrichien lui-même sont le théâtre de similaires mobilisations nationales imbriquées, Slaves et Roumains s’opposant aux prétentions hongroises, polonaises ou allemandes. Des dynamiques centripètes atteignent leur paroxysme ; à Paris, les tragiques « journées de juin » voient l’écrasement dans le sang des mouvements radicaux par les libéraux modérés. De fait, le cours des événements va maintenant suivre un reflux politique, sans que disparaissent pour autant les idéologies qu’ils ont amenées au premier plan.
Car s’annonce la « Contre-révolution » (chapitre 8, p.548-650). Dès la mi-mai, la réaction prend le dessus à Naples ; après une brutale répression, parlement et constitution sont progressivement mis de côté, tandis qu’un corps expéditionnaire reconquiert brutalement la Sicile à partir de septembre. Partout, les conservateurs relèvent la tête. Dans l’empire d’Autriche, la contre-révolution est menée par quelques personnalités remarquables agissant presqu’indépendamment du gouvernement resté à Vienne. Windischgrätz mâte les velléités insurrectionnelles de Prague en juin ; pendant l’été, les succès déjà évoqués de Radetzy amènent la reconquête de la Lombardie et la dissolution des efforts pan-italiens ; en septembre, le parti Habsbourg décide de la reprise en main de la Hongrie et lance contre elle Jellacic, que les Croates se sont donnés comme ban. La décision provoque un nouveau soulèvement à Vienne, le 6 octobre ; mais la ville, livrée aux radicaux, est reprise par la force par Windischgrätz à la fin du mois. Dans la foulée, le même et le ministre Schwarzenberg poussent le faible empereur Ferdinand à abdiquer en faveur de son jeune neveu François-Joseph, que les événements n’ont pas compromis. A Paris, le virage à droite se poursuit, et se traduit par le choix pour l’exécutif d’un président élu par le peuple ; et c’est Louis-Napoléon Bonaparte que les élections de décembre portent au pouvoir. L’ordre et l’autorité monarchiques sont pareillement rétablis en Prusse en novembre. Le Royaume-Uni lui-même mène une violente répression contre les élans progressistes qui se manifestent dans son protectorat des îles ioniennes. 1849 est le théâtre d’une seconde vague contre-révolutionnaire, qui doit faire face à de nouveaux soulèvements dominés par des radicaux mieux organisés. Le pape, qui s’est enfui de Rome où la République a été proclamée en février, y est rétabli par un corps expéditionnaire français et y supprime tous les acquis de 1848. Les violentes insurrections qui touchent les royaumes de Saxe, de Bade, et d’autres régions allemandes sont pareillement finalement réprimées à l’été, souvent par le concours des troupes prussiennes restées indéfectiblement fidèles à leur souverain et plus généralement à une conception de l’ordre social. En Moldavie et Valachie, la Russie impose aux Ottomans une occupation conjointe qui met fin à la révolution. Le cas de la Hongrie s’avère plus complexe, et encore plus violent. Se proclamant indépendant en avril, l’État magyar de Kossuth est en butte non seulement à l’opposition de la monarchie Habsbourg mais aussi aux dissensions internes et à l’hostilité à ses minorités ; l’intervention armée de la Russie, sollicitée par François-Joseph, lui porte un coup fatal en août. C’est sur le triomphe, dans les mentalités, du pragmatisme et des rapports de force (symbolisé aussi par la « reculade d’Olmütz » en 1850, qui voit enterré sous la pression de l’Autriche le projet d’une union allemande sous l’égide de la Prusse) que l’auteur conclut ce long chapitre… non sans mentionner les milliers de morts, parfois exemplaires, souvent anonymes, que laissent derrière eux les événements.
Retour vers le futur
Pour les vivants, que reste t-il, « Après 1848 » (chapitre 9, p.651-704) ? La répression qui suit les révolutions provoque des vagues de déplacements forcés ; si nombre de ceux qui ont fui les combats parviennent ensuite à rentrer chez eux, toute une génération est contrainte à l’exil pour motifs politiques. Elle contribue à diffuser dans le monde extra-européen l’audience de la révolution – avec, souligne l’auteur, un impact au demeurant bien faible, car étroitement dépendant des luttes et contestations déjà en jeu. En Europe, le carcan remis en place par les pouvoirs raffermis ne se traduit pas par un retour au statu quo ante prérévolutionnaire, la politique y ayant profondément changé de forme et de ton. Quel que soit le régime, on assiste en effet dans tous les Etats à un rapprochement des programmes politiques, qui prennent en compte les aspirations des plus modérés des anciens progressistes et les éléments les plus innovateurs et entreprenariaux de l’ancienne élite conservatrice, conduisant à une marginalisation de la gauche démocratique et de la droite traditionnelle. Cette stabilisation permet la mise en œuvre de mesures réformistes ; les gouvernements post-révolutionnaires développent l’interventionnisme économique à grande échelle, avec pour objectif la stimulation de la croissance – un lien explicite étant fait avec le maintien de la tranquillité publique. C’est dans le même esprit que les espaces urbains sont remodelés ; Paris, Vienne, Berlin, Madrid connaissent ainsi d’importantes transformations après 1850. Pareillement, c’est par le passage d’un régime de censure à un système de gestion de l’information que les gouvernements répondent à la politisation accrue des populations – à l’exception notable de l’Empire russe, où la tendance est inverse.
Pour l’auteur, cette période post-1848 marquée par une vision politique technocratique, transnationale, évoque les aspirations qui se manifesteront après les autres grands bouleversements européens de 1945 et 1989. Là n’est pas le seul lien des événements avec le présent, comme il le développe dans une brève conclusion (p.705-714) revenant sur la portée du printemps des peuples. Dépassant le débat entre ses supposés échec ou réussite, il en rappelle d’abord les importantes conséquences : une profonde modernisation des idées et des pratiques politiques – au prix de l’exclusion persistante des classes populaires, un certain nombre de décennies étant encore nécessaires avant que le suffrage universel ne se généralise en Europe ; et une transformation du champ géopolitique, par l’adossement pragmatiques des aspirations nationalistes à la puissance des Etats, l’émergence des Etats-nations allemand et italien dans les années 1859-71, et leurs caractéristiques réciproques, en découlant directement. Il souligne ensuite combien nombre des constats de l’époque pré-révolutionnaire restent, ou redeviennent, actuels dans un contexte où tous les éléments structurants de la période industrielle qui a suivi apparaissent en pleine recomposition : l’instabilité des cadres, la disparité des idéologies, le caractère protéen, mobile et improvisé d’une part importante des dissidences actuelles, l’attention accrue portée à la précarité et la préoccupation face au risque de délitement social… annoncent peut-être, dans un contexte où une solution non-révolutionnaire à la crise multiple que nous traversons apparaît de plus en plus improbable, un nouveau 1848.
C’est la tête toute emplie de faits, de visages, de bruit et de flammes qu’on referme l’ouvrage, tant l’auteur se livre à une vertigineuse histoire, politique, culturelle, intellectuelle, sociale, des événements. Il faut assurément lui reconnaître le mérite d’une synthèse d’ampleur ; en premier lieu sur le plan géopolitique puisque comme évoqué à maintes reprises ci-dessus, c’est l’ensemble des théâtres européens et extra-européens qui sont évoqués, ce qui permet entre autres d’amener l’attention sur certains épisodes moins connus (les troubles meurtriers de Galicie, l’étonnante révolution roumaine, les brefs mais sanglants soulèvements espagnols…) ; et en second lieu dans sa tentative d’embrasser l’ensemble des aspects des révolutions de 1848, à la fois dans leurs origines, leur déroulement, et leurs conséquences. D’évidence, Christopher Clark s’est livré à un travail colossal, auquel ne rendent qu’imparfaitement hommage les très denses notes (p.717-796) au sein desquelles est répartie et parfois commentée l’abondante bibliographie utilisée. Le texte, précédé de quatre utiles cartes, parsemé de quelques illustrations qu’il exploite, est très efficace. Jouant des personnages, des lieux et des perspectives, lumineux sur bien des aspects, plein de souffle dans la narration de certains épisodes, il se parcourt avec un intérêt constant. L’un de ses mérites, et non des moindres, est de mettre l’accent par l’approche choisie sur la dimension européenne des évènements, à rebours de certaines relectures nationales ultérieures ; on le trouvera en cela un peu plus novateur que dans l’interprétation de leur supposé insuccès.
Pour autant, ainsi que l’auteur le reconnaît lui-même en ouverture de ses remerciements (p.803-804), il y a évidemment de la gageure à vouloir restituer l’exhaustivité d’un bouleversement aussi polymorphe – la longueur inusitée de ce compte-rendu en apportant d’ailleurs pareillement témoignage. Si la structuration en grands chapitres est intellectuellement solide et le texte aéré d’intertitres, on sera parfois un peu dérouté par le va-et-vient constant auquel il se livre, sans forcément de transition, entre les différents épicentres des événements ou leurs différentes approches ; et la limitation des outils de recherche internes à l’ouvrage à un seul index des personnes ne permet pas de le compenser. Pareillement, la multitude des faits et idées à évoquer peut forcément entraîner sélectivité voire déséquilibre dans le traitement, générateurs d’une certaine frustration ; entre autres exemples, à la lecture des quelques lignes expédiant les véritables opérations de guerre auxquelles le printemps des peuples donna lieu, en particulier en Italie et en Hongrie, l’amateur (et l’on sait que l’auteur de ces lignes s’inscrit dans cette catégorie) ne pourra ainsi qu’être amené à la conclusion qu’une histoire militaire francophone des événements reste à écrire.
Il n’en reste pas moins que ce travail ample, profond et prenant ne peut dorénavant apparaître que comme un incontournable pour tout lecteur désireux d’en savoir plus sur une période qui, comme évoqué, n’est pas sans similitudes avec la nôtre.