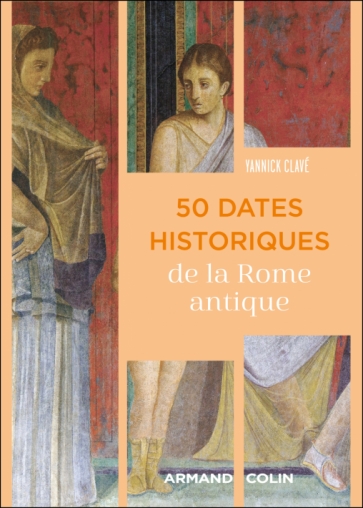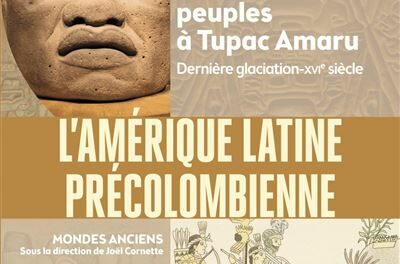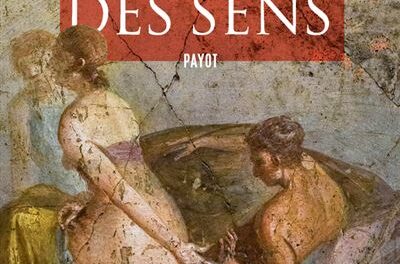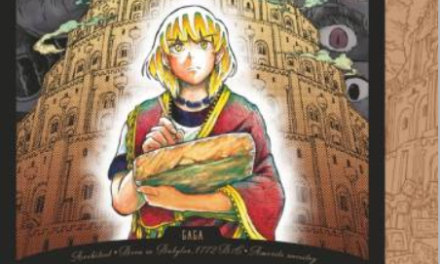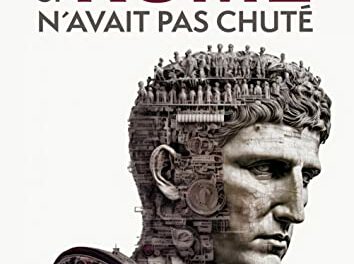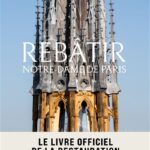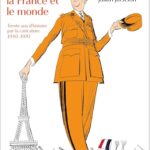S’il est bien un terme associé à l’histoire, c’est l’événement. Pourtant, son statut a changé au sein de la recherche historique. Au cœur de l’histoire méthodique du XIXe, rejeté ensuite par les Annales et leurs héritiers, l’événement a connu un retour en grâce ces dernières décennies. Pour autant, il n’est plus question de prendre l’événement de façon isolée, mais de l’utiliser comme révélateur d’un contexte et d’une époque. La nouvelle collection « Les 50 dates historiques » nous propose donc, par ce biais, de mieux connaître la Rome antique.
Pourquoi proposer 50 dates pour présenter la civilisation romaine ?
L’événement, au coeur de la démarche actuelle de l’historien
Yannick Clavé nous présente d’emblée le principal défi de son ouvrage : retenir 50 dates pour résumer l’histoire romaine, cela relève d’une gageure. Certes, quelques-uns semblent d’emblée incontournables. La fondation de Rome en -753, l’assassinat de César en -44, la chute de Rome en 476 s’imposent comme des choix évidents en apparence. En effet, ces dates sont non seulement connues des historiens, mais aussi du grand public. Mais comment choisir les autres ?
C’est là le rôle de l’historien que de pointer certains événements qui, sans avoir nécessairement frappé les contemporains ou les générations futures, marquent, pourtant, une bascule ou sont des révélateurs d’une époque. Prenons un exemple. Un article est consacré à la nomination de Pline le Jeune comme gouverneur de la Bithynie en 111. Ce choix peut surprendre. Pour autant, cet événement permet à l’auteur de nous montrer les relations entre un gouverneur et son empereur par la riche correspondance qui nous est parvenue. En outre, de façon plus large, ce choix sert de révélateur pour comprendre les rapports entre les cités grecques et le pouvoir impérial et les enjeux de la montrée du christianisme dans l’empire. C’est là tout l’intérêt actuel porté par les historiens sur l’événement. Ce dernier n’est plus uniquement traité selon sa portée politique, mais aussi (et peut-être bien davantage) comme révélateur de phénomènes sociaux et culturels. Ainsi, par l’événement, nous pouvons mieux appréhender une civilisation.
Un nécessaire travail de contextualisation
Dans le même temps, un autre mérite de cet ouvrage est de nous rappeler que l’événement ne peut s’étudier seul, mais qu’il doit être nécessairement contextualisé. En effet, et malgré ce qu’on croit parfois, aucune date ne constitue à elle seule une rupture totale. L’instauration du Principat par Auguste à partir de -27 s’apparente à un moment de bascule : la République s’efface, l’Empire s’affirme. Pour autant, Yannick Clavé insiste bien sur le long processus de concentration de pouvoir entre les mains d’hommes « forts » (Marius, Sylla, Pompée, César…) face aux crises de la République tout au long du Ier siècle avant notre ère. La mise en place du Principat s’inscrit donc dans ce processus. Au sein de l’ouvrage, cette continuité est d’ailleurs visible à travers les renvois fréquents vers d’autres articles.
Comme nous l’avons montré avec le traitement accordé à l’événement, ce n’est pas seulement une histoire politique mais plus largement une histoire de la civilisation romaine qui nous est proposée.
Un ouvrage grand public mais révélateur de débats scientifiques
Une chronologie revue de la civilisation romaine
L’ouvrage est pensé pour un lectorat grand public. Chaque événement est introduit par une citation issue d’une source. L’événement nous est ensuite présenté puis différents paragraphes nous permettent d’élargir le regard sur son contexte, ses causes, ses conséquences et sa portée. Chaque article fait généralement entre 5 et 7 pages avec quelques sources et éléments de biographie. Cela permet de picorer l’ouvrage et rend ainsi la lecture facile.
On peut être surpris que les dates retenues se prolongent jusqu’en 800, correspondant au couronnement de Charlemagne. Ce choix est pourtant révélateur des questionnements des historiens sur la périodisation et, en particulier, la remise en cause des 4 périodes « canoniques » (Antiquité, Moyen-Âge, époques Moderne et Contemporaine).
La chute de Rome en 476 est un repère pratique, généralement utilisé pour dater la fin de l’Antiquité. Mais ce repère est très largement remis en cause, comme nous le montre cet ouvrage. Tout d’abord, ce n’est pas la fin de l’empire romain car sa partie orientale subsiste. De plus, cela faisait déjà plusieurs décennies que le pouvoir était aux mains de chefs « barbares » : l’empire d’occident n’existait plus dans les faits. Enfin, la chute de Romulus Augustule ne marque pas une disparition du monde romain car les nouveaux pouvoirs en place s’inscrivent largement dans la continuité du fonctionnement romain.
Sur le plan culturel, cette chronologie élargie nous montre comment l’héritage romain demeure très vif dans les esprits, malgré la disparition de l’empire. Finalement, ce sont peut-être davantage l’échec de Justinien au VIe siècle puis les conquêtes arabo-musulmanes des VIIe – VIIIe siècle qui marquent véritablement la fin de l’ère romaine.
Une histoire encore source de débats
Certaines dates sont aussi l’occasion de nous montrer la prise de recul critique des historiens sur certains savoirs. Yannick Clavé nous rappelle que la date de fondation de Rome en -753 est évidemment légendaire. Les figures de Romulus et Rémus le sont tout autant mais, cependant, l’archéologie nous confirme la présence d’une cité fondée au milieu du VIIIe siècle. Les historiens ne sont pas en mesure de trancher l’identité du ou des fondateurs de Rome mais savent qu’il ne s’agit pas de Romulus et Rémus (et sont en mesure d’affirmer que les Romains étaient également conscients du caractère légendaire de cette fondation). Pour autant, l’auteur n’hésite pas à nous proposer un récit de cette fondation, non pas dans l’optique de la disqualifier, mais pour nous montrer ce qu’elle nous apprend sur l’univers mental des romains.
Enfin, certains débats d’historiens demeurent visibles à la lecture de l’ouvrage croisé avec d’autres. On peut prendre l’exemple de la conquête romaine en Grèce. L’auteur nous présente l’attaque romaine contre le Royaume de Macédoine de Persée à partir de -172 comme le fruit d’une infamie : le roi grec aurait rompu le traité signé par son père en -197 et ainsi fait trahit sa fides (bonne foi, très importante pour les Romains). Or l’ouvrage de Patrice Brun traitant des 50 dates historiques de la Grèce antique affirme, de son côté, que Persée s’est attaché à respecter ce traité (tout en cherchant une marge de manœuvre). Selon lui, ce sont les Romains qui auraient alors trouvé un prétexte pour attaquer ce royaume potentiellement concurrent. Il semble donc que l’affaire ne soit pas tranchée entre historiens.
À partir de ces 50 dates, c’est donc un large panorama de la civilisation romaine qui nous est proposé. D’une lecture facile, cet ouvrage peut donc attirer un large lectorat tout en nous familiarisant avec les progrès de la recherche ainsi qu’un certain nombre de débats au sein de la communauté scientifique.