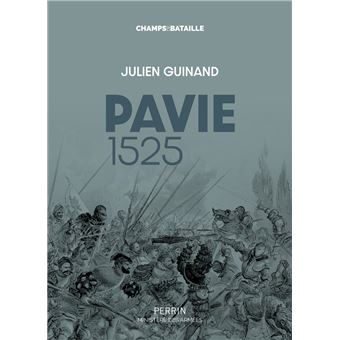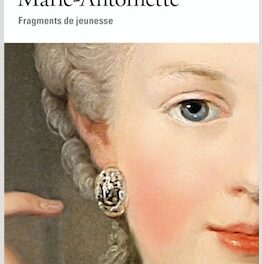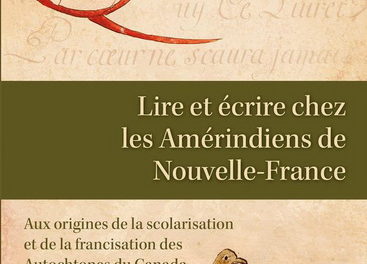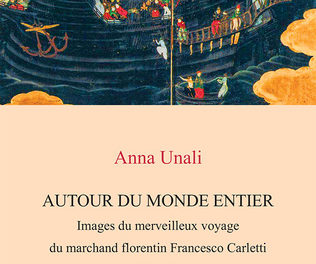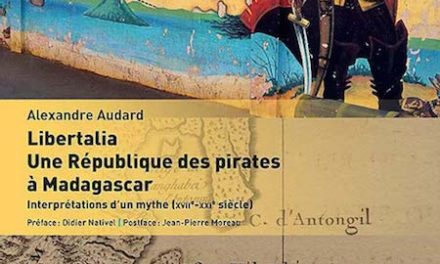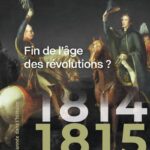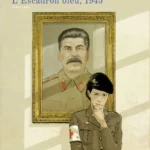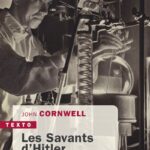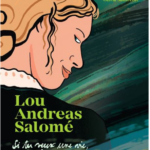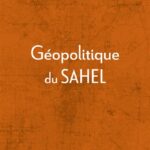Depuis trois ans, la collection « Champs de bataille » co-éditée par Perrin et le Ministère des Armées (en vertu de sa politique de soutien financier) trace son sillon, avec la parution de sept titres qui embrassent différents affrontements des époques médiévale (Crécy 1346, Constantinople 1453) et contemporaine (Gettysburg 1863, Verdun 1916, Kharkov 1942, Okinawa 1945) ; les derniers en date ouvrant sur l’époque moderne avec le très réussi Malplaquet 1709 de Clément Oury, et donc ce tout récent huitième opus fort opportunément consacré à la bataille de Pavie dont c’était il y a quelques semaines le 500ème anniversaire.
Pavie, ou l’antithèse de la gloire de la célèbre victoire de Marignan (1515), qui donne le duché de Milan à la couronne de France : le 24 février 1525, au terme d’un siège de quatre mois, l’armée de François 1er est lourdement défaite devant la ville par les troupes de l’empereur Charles Quint, le roi lui-même tombant aux mains de ses ennemis. La péninsule italienne est définitivement perdue pour la France, et le retentissement du désastre immense en Europe. La bataille a donné lieu à une littérature abondante, dès l’origine et jusqu’à nos jours ; on citera particulièrement l’ouvrage de Jean Giono publié dans la collection « Trente Journées qui ont fait la France » chez Galimard (1963), et l’étude de Jean-Marie Le Gall parue en 2015 chez Payot… qui en ressort cette année une édition revue et augmentée. Julien Guinand, docteur en histoire moderne, maître de conférences à l’Université Catholique de Lyon, se propose pourtant d’en offrir ici une lecture réactualisée, fort des travaux qu’il mène depuis quelques années sur l’histoire du fait guerrier, des sociétés frontalières et des pouvoirs de la première modernité (XVIè-XVIIè), auxquels le grand public a pu accéder par le biais, particulièrement, de son ouvrage La guerre du roi aux portes de l’Italie : 1515-1559 (PUR, 2020) et de sa collaboration à l’Atlas des guerres modernes (Autrement, 2023).
Pavie, pas pris
De fait, après un avant-propos qui pose les faits et les intentions, ce Pavie 1525 reprend le plan tripartite devenu classique de la collection.
Une guerre de rivalités
La première partie expose ainsi le contexte qui va mener à la bataille. A partir de 1494, l’Italie, et surtout le riche duché de Milan et le Royaume de Naples, sont l’objet des ambitions des Valois ; les affrontements impliquant toutes les puissances locales se fondent bientôt dans une rivalité plus large entre le Royaume de France et la puissante maison des Hasbourg, qui s’accentue avec l’avènement du roi d’Espagne Charles Quint au trône du Saint-Empire en 1519. Maîtres de Milan depuis Marignan, les Français en sont chassés par leurs ennemis en 1521. La contre-attaque orchestrée par François 1er et menée sur place par Lautrec échoue d’abord une première fois devant Pavie, puis se laisse entraîner à l’attaque du camp impérial établi non loin de Milan, au lieu-dit La Bicoque. La bataille qui s’ensuit, le 27 mai 1522, voit le triomphe des retranchements et des arquebuses espagnoles sur l’impétuosité des Suisses au service du roi de France ; sévèrement battus, les Français évacuent le Milanais. François 1er n’est cependant pas décidé à y renoncer, et renvoie l’année suivante une armée en Italie ; retenu par la trahison du duc de Bourbon, l’un des plus importants personnages du royaume, il la confie à un intime, l’amiral de Bonnivet. En face, la Sainte-Ligue mobilise, sous l’autorité du Flamand Charles de Lannoy, vice-roi de Naples, et, au printemps 1524, les Français doivent de nouveau repasser les Alpes, poursuivi par les Impériaux menés par Bourbon et Pescara. Le siège mis par ceux-ci devant Marseille à l’été échoue cependant ; devant ce nouveau revirement, le roi de France décide début octobre de conduire encore une fois en Italie la puissante armée qu’il a réunie.
Les opérations se reportent donc dans le Milanais à l’automne ; si Milan est reprise par les Français, les Impériaux restent maîtres d’Alexandrie, Pavie et Lodi, où le gros de leurs forces se regroupe. François 1er choisit alors de marcher sur Pavie, qui est rapidement investie. L’échec d’un assaut en règle, le 8 novembre, amène les Français à s’installer dans une plus longue temporalité ; des deux côtés, on est résolu à faire durer dans l’espoir du succès, et les semaines suivantes voient se déployer renforts, opérations diplomatiques et de diversion… Derrière le récit des événements rapidement brossés dans les lignes précédentes, on appréciera les très intéressantes analyses livrées par Julien Guinand sur leurs soubassements : les évolutions de l’art de la guerre, le caractère composite des contingents alignés des deux côtés, l’impact du financement (ou du non-financement) des combattants sur les évènements, les processus de contrôle des opérations et l’évolution des relations de pouvoir à l’oeuvre côté français, la situation de la ville de Pavie à l’époque du siège, la maîtrise opérationnelle, mais aussi la pugnacité, démontrée par les deux armées dans le franchissement des Alpes, le quotidien d’une guerre de position au XVIe siècle.
L’avènement de la bataille
A partir de la fin janvier 1525, tout se cristallise progressivement. Le renforcement de leurs troupes, et leur impécuniosité, poussent Lannoy et Bourbon à l’offensive. Les 5 et 6 février, les Impériaux apparaissent aux abords de Pavie et installent leur camp à l’est du mur du vieux parc de loisir et de chasse des Visconti, tandis que les Français renforcent leurs retranchements. A ce moment, les deux armées comptent environ 25 000 hommes, avec un net avantage en artillerie pour les seconds. Dans les semaines qui suivent, les troupes de Charles Quint multiplient les coups de griffe ; en face, les Français se cantonnent à une défensive attentiste, stratégie entérinée par le conseil de guerre du 20 février. Voyant leur armée menacée de dissolution, les généraux impériaux se décident alors à forcer le destin.
« De toutes choses ne m’est demeuré que l’honneur et la vie sauve »
Dans la nuit du 23 au 24, ils mènent leurs troupes le long du mur jusqu’au bout du parc, à plusieurs km du camp français, où une brèche est faite. Surpris, François 1er prend la décision de marcher à l’ennemi ; au petit matin, les adversaires sont en présence. L’artillerie française ouvre le feu ; les cavaleries s’entrechoquent, et les gendarmes français au sein desquels combat le roi prennent d’abord l’avantage. Ils sont alors confrontés à un mouvement en avant des arquebusiers espagnols, qui les déciment ; l’infanterie royale, surclassée par le nombre et le feu, cède progressivement à la panique, qui entraîne pareillement les troupes qui continuent à monter du camp français, tandis que les assiégés mènent dans leur dos une sortie réussie. Isolé, François 1er est capturé ; en milieu de journée, la déroute est totale pour les vaincus pourchassés, dont près de la moitié a péri et 6 à 8 000 restent entre les mains des Impériaux.
Appuyé sur le croisement de nombreuses sources, issues de la recherche historiographique comme des témoignages plus ou moins contemporains des acteurs et spectateurs de l’événement, le tout remis en perspective, l’auteur propose ici une analyse fort convaincante de la bataille. Pour lui, celle-ci ne découle pas des hasards d’une tentative de ravitaillement des assiégés, comme le prétend une partie des écrits ultérieurs, mais bien d’une recherche et d’une acceptation délibérée de l’affrontement. Il bat pareillement en brèche l’image d’un roi français irréfléchi et de deux pratiques de la guerre, l’une téméraire et chevaleresque, l’autre pragmatique et moderne par l’emploi des armes à feu, montrant deux adversaires qui tentent de combattre au mieux de leurs capacités dans le chaos des aléas ; le rôle tactique prétendument décisif et avorté de l’artillerie française, entre autres, est de beaucoup minoré. Et, là encore, il livre de passionnants aperçus sur le vécu des événements à hauteur d’homme.
La nouvelle du désastre se répand partout en Europe dans le mois qui suit ; elle est évidemment accueillie avec désarroi en France, que la régente Louise de Savoie met en état de défense, alors qu’elle décuple les ambitions des Habsbourg qui ont repris dans la foulée le contrôle du Milanais. Si la dénonciation par François 1er du traité qui lui a été imposé à Madrid en janvier 1526 et le jeu mouvant des alliances relance les opérations en Italie les années suivantes, le coup porté aux ambitions françaises dans la péninsule s’avère définitif, amenant en cela l’auteur à catégoriser la bataille comme décisive.
Mémoires du combat
La troisième partie s’attache dès lors classiquement à en retracer la postérité. Elle est très vive au XVIe siècle, à travers écrits et iconographie. Des deux côtés, une interprétation pensée est mise en œuvre, l’éclat de la victoire étant mise au service des prétentions universalistes des Habsbourg, l’accent portant du côté français sur la glorieuse bravoure des vaincus. La valeur de l’infanterie espagnole et de l’emploi des armes à feu en ressort confirmée, le souvenir de Pavie semblant influencer les opérations dans la seconde partie du règne de François 1er ; la bataille favorise pareillement dans les années suivantes la mise en œuvre des réformes militaires (recours croissant à une infanterie nationale et à l’arquebuse en France, affermissement du tercio en Espagne…) Pareillement, l’auteur décrit de façon convaincante comment la version erronée de la charge irréfléchie de la chevalerie du roi de France faisant taire son artillerie victorieuse s’est progressivement imposée dans l’historiographie. Il détaille enfin comment la bataille de Pavie reste aujourd’hui encore un héritage européen, partagé de façons diverses, et fluctuante selon les époques, par les nations héritières des divers protagonistes (France, Espagne, Autriche, Allemagne…), marqué par l’impact du célèbre ouvrage de Giono, et dont la prise en compte locale semble enfin se faire jour après des siècles de désintérêt.
Appuyé sur un solide travail de fond, l’ouvrage présente les qualités didactiques communes à la collection « Champs de bataille » (dont on rappellera qu’elle est dirigée par le talentueux et prolifique Jean Lopez) : un plan clair et charpenté, le complément de cartes détaillées tout en restant très lisibles, de notes et outils de recherche (index et table), de précieux annexes sur les ordres de bataille, et une riche bibliographie. On trouvera peut-être une limite à l’absence d’illustrations, particulièrement quand l’auteur décrit l’iconographie inspirée par la bataille au XVIe siècle ; mais l’étude, complexe et passionnante, n’en paraît pas moins destinée à devenir incontournable pour tout amateur de la période.