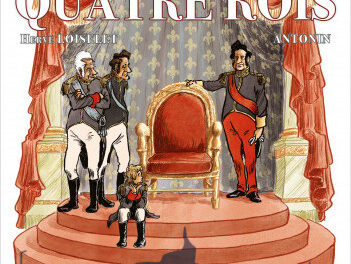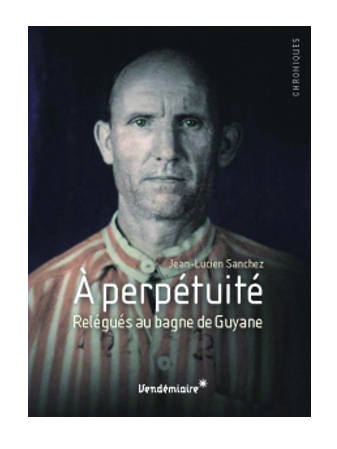
En ces périodes de débats sécuritaires, à propos de telle ou telle catégorie qui serait « incapable de s’intégrer », le travail de Jean Lucien Sanchez tombe à bien nommé pour éclairer par un travail d’historien les démarches qui ont pu conduire la IIIe République à mettre en œuvre un système de rééducation à perpétuité pour des personnes dont le profil les rendrait « inassimilables ».
Ce travail d’historien présente l’intérêt de s’inscrire au confluent de plusieurs sujets. Il est question tout d’abord des bagnes coloniaux qui ont accueilli entre 1887 et 1949 plus de 22 000 personnes. Mais il est question aussi de colonisation, et par voie de conséquence d’une mise en valeur des territoires qui a été conçue par les puissances coloniales comme une sorte d’amortisseur social permettant de régler différents problèmes, celui de la récidive pour des détenus que la prison suffirait pas à amender, mais aussi celui de fournir une main-d’œuvre propice à des travaux pénibles aux entreprises de colonisation.
Enfin cet ouvrage présent un concept juridique unique en droit français, élaboré entre 1880 et 1885, voter au Parlement sur proposition du ministre de l’intérieur Pierre Waldeck-Rousseau, le 12 mai 1885. Cela rappelle curieusement quelques démarches récentes de modification du droit pénal, notamment les peines planchers et les multiples lois sur la récidive. Pour la loi de 1885 l’article quatre prévoit que les récidivistes seront réglés lorsqu’ils ont, dans un intervalle de 10 ans, encourus de condamnation, y compris pour le vagabondage ou la mendicité. Cette mesure de relégation s’inscrit contre un condamné, une fois sa peine principale purgée. Ici aussi, on a du mal à penser à des dispositions proposées par l’un des Garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy, concernant toutefois des détenus condamnés pour des crimes très particuliers.
Mais il n’empêche, le paradigme pénal différencie clairement les délinquants et criminels d’occasions d’accidents des délinquants et criminels d’habitude, les récidivistes. Ce sont ces récidivistes qui doivent subir cette sorte de double peine qui est la relégation.
L’ouvrage est divisé en 13 chapitres qui peuvent être parcourus indépendamment les uns des autres en fonction des centres d’intérêts. Il se termine par la « liquidation de cette erreur » qui met un terme à cette histoire tragique. Les éditions vendémiaire ont réalisé, comme à leur habitude un excellent travail d’éditeur en intégrant un cahier de photographies au centre de l’ouvrage, une carte de la Guyane et une bibliographie très complète avec un classement en rubriques particulièrement utile.
Dans les arcanes de la pénitentiaire
Le premier chapitre présente les arcanes de l’administration pénitentiaire et le cas particulier de la Guyane avec une organisation administrative où l’on essaie d’associer le volet répressif avec la relégation et le volet colonial. Des situations particulières à la Guyane semblent avoir aggravé d’ailleurs la situation en matière de suivi. Une rotation très rapide des gouverneurs, près de 60 entre 1852 et 1944, laisse au directeur de l’administration pénitentiaire les mains libres en matière de gestion. En réalité en Guyane, d’après Jean Lucien Sanchez il existe un pouvoir civil une administration de type militaire avec une différenciation spatiale entre la colonie et les territoires pénitentiaires du Maroni.
Malgré le cadre juridique dans lequel la relégation est mise en œuvre, le ministère de la marine et des colonies semblent avoir fonctionné dans l’improvisation la plus totale. Au passage il existe une sorte d’embouteillage entre les déportés au bagne et les relégués qui sont d’ailleurs séparés, y compris par les uniformes. Les relégués sont installés dans un village, celui de Saint-Jean, qui ne comporte pas de mur d’enceinte, puisque initialement ils sont destinés à la mise en valeur du territoire. Il n’empêche que les conditions d’installation sont particulièrement difficiles pendant les premières années de mise en place du village de relégation la mortalité dépasse les 30 %. Le pénitencier de Saint-Jean est d’ailleurs qualifié de « camp de la mort ». Contrairement à ce qui a pu être initialement prévu, très rapidement, les concessions individuelles permettant aux relégués une sorte d’émancipation par le travail ne sont plus délivrées qu’au compte goutte, et la relégation ressemble très clairement un régime de travaux forcés dans un pénitencier.
Le monde du pénitencier de Saint-Jean semble avoir été clos. Les surveillants sont des militaires, sous-officiers, puis simple soldat à partir de 1906. Cette baisse du niveau pose d’ailleurs un problème constaté par l’absence de culture primaire pour la majorité des surveillants en 1933. Ces derniers ne sont d’ailleurs pas d’une grande moralité, et cherche à exploiter la situation, y compris au détriment des relégués. Les commandants du camp couvrent d’ailleurs leurs subordonnés en empêchant les visites judiciaires qu’il dénonce comme autant d’ingérences inadmissibles.
Un monde hors la loi
Dans le quatrième chapitre et les suivants, Jean Lucien Sanchez traite tous les aspects de cette vie carcérale qui est quand même très particulière, puisque pour des condamnations mineures, elle se traduit par une détention à perpétuité. Au vu des conditions particulières du climat équatorial, et de l’absence de préoccupations sanitaires de l’administration pénitentiaire, la situation des relégués apparaît comme proprement insupportable. Les taux de mortalité atteignent largement les 30 % au bout de un an de séjour. Il faut attendre la période qui suit la fin de la guerre de 14 18 pour voir ce pourcentage baisser. À ce propos l’auteur évoque avec beaucoup de pertinence les témoignages de détenus qui se sont portés volontaires pour aller combattre au front lors de la première guerre mondiale. Au passage, on notera que l’administration pénitentiaire a eu tendance à rejeter ces demandes. Cela n’est pas forcément surprenant, dans la mesure où les relégués sont considérés comme irrécupérables a priori.
Irrécupérables !
Au moment de la seconde guerre mondiale, au moment où s’organisent les derniers convois de relégués, ce sont des évadés vers la Guyane hollandaise qui ont essayé de rejoindre la France libre, souvent dans des conditions particulièrement difficiles. Les difficultés d’approvisionnement pendant cette période, les indications en matière de rigueur qui semble avoir été données par l’État français ont eu comme conséquence un excès de zèle de l’administration pénitentiaire. Le taux de mortalité renoue avec les chiffres des premiers temps de l’installation, près de 30 % en 1942, et les taux d’évasion augmentent également. Encore une fois la situation des relégués est infiniment plus dure que celle des transportés, des bagnards, et le témoignage d’un fonctionnaire civil de l’administration pénitentiaire parle des « hommes squelettes ». Ce livre d’une immense richesse dans la mesure où tous les aspects de cette vie particulière de relégués à vie pour cause de récidive, sont traités. Les conditions de détention qui sont faites laisse très peu de place à une quelconque réinsertion. Le statut de relégués en concessions individuelles est extrêmement difficile à obtenir, d’autant plus que les efforts, même timide de réinsertion conduit par des associations caritatives sont davantage destinés aux transportés.
Les régimes disciplinaires des camps sont plutôt variables, et dépendent largement de la perception que les responsables successifs peuvent avoir de leur mission. Il est clair que, selon les époques, les sanctions ont été plus ou moins dures. Les chantiers forestiers servaient par exemple à mater les récalcitrants, surtout lorsque des refus collectifs du travail sont organisés, comme en 1931 où l’on ne compte pas moins que 1200 grévistes.
Il faut attendre le début des années 50 pour que les autorités prennent la décision de mettre un terme à cette anomalie judiciaire que constitue la relégation. Il faut se rappeler des conditions de mise en œuvre de ces lois de 1885 qui créaient ipso facto une catégorie judiciaire basée sur l’automaticité des peines et sur une sorte de sanction collective. Il faut d’ailleurs souligner que pendant toute la période où ces lois de relégation ont été mises en œuvre les magistrats ont été particulièrement prudents, et s’ils avaient fait preuve de plus de zèle, c’est-à-dire appliquant de façon systématique les seuils de condamnation à des durées supérieures à trois mois, le nombre de relégués aurait été sans doute beaucoup plus important.
Au moment où le débat sur la délinquance, sur la récidive semble relancé, dans la France de 2013 comme il l’a été en 2008 et en 2009, cet ouvrage apparaît nécessaire. Certes les systèmes de détention apparaissent comme incontestablement plus humains que ceux de la fin du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle, mais les démarches intellectuelles qui sous-tendent l’application des textes de loi sur la récidive ne semblent pas forcément remises en cause. Il est extrêmement difficile de trancher sur ces débats, qui vont d’ailleurs très au-delà des questions de la délinquance stricto sensu. Comment intégrer une population présentant des caractéristiques particulières ? Existe-t-il une possibilité de rédemption par le travail ?
Et au final quelle conception de la nature humaine que le corps social développe-t’il à l’encontre de ceux qui ont été à un moment donné en rupture avec la société ?
Sont-ils amendables ? Irrécupérables ? Pour les concepteurs de la loi de la relégation la réponse ne fait aucun doute. Pour les lecteurs de cet ouvrage qui éclaire d’un jour particulier cette face d’ombre du système judiciaire français, la question mérite d’être posée.