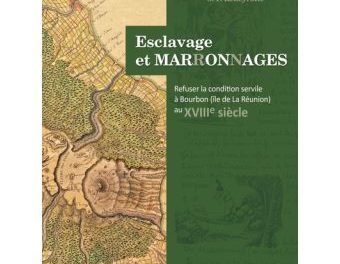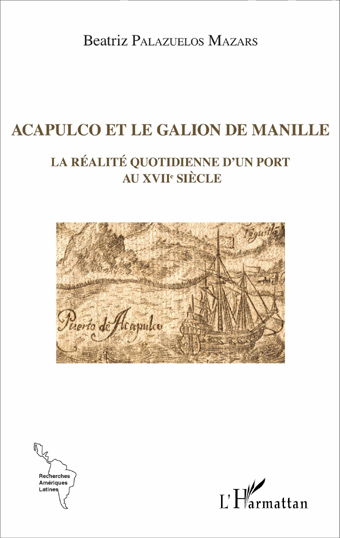
C’est au XVIè siècle qu’émerge la cité dont la baie ouvre sur l’océan Pacifique. Andrés de Urdaneta, chargé par le roi de trouver la torna-vuelta (la route du retour des Philippines vers la Nouvelle-Espagne), aurait convaincu Philippe II de choisir Acapulco, au détriment du port de Navidad, comme terminal du galion de Manille. Outre le fait que la cité était relativement proche de Mexico, Andrés de Urdaneta en vantait le mouillage, dans une baie profonde et bien protégée du vent. Poissonneuse à souhait, elle pouvait en outre largement subvenir aux besoins alimentaires des populations locales et des équipages de passage. Quant aux nombreuses essences d’arbres de la région, elles pourraient s’avérer utile pour la construction et le calfatage des bateaux. Ultérieurement, on allait s’apercevoir qu’en matière de construction navale les Philippines étaient bien mieux loties, en essences adaptées, et plus qualifiées, en termes de main-d’oeuvre, que la Nouvelle-Espagne : c’est en effet dans l’archipel qu’on a construit la majorité des galions au XVIIe siècle.
Tout comme Acapulco, l’activité du port et de la ville de Manille était centrée autour du galion. C’était l’unique moyen permettant de relier les Philippines et l’Espagne, via la Nouvelle-Espagne. Avant les années 1620, on envoyait entre trois et cinq galions depuis les Philippines, puis, jusque dans les années 1660, deux galions voguaient vers la Nouvelle-Espagne. Par la suite, on n’affréta plus qu’un galion de fort tonnage. Le galion de Manille, haut et très souvent en surcharge, était un « galion obèse » (p. 102), dont la faible capacité de manœuvre posait problème dans les passages resserrés ou les canaux de l’archipel des Philippines, d’où le grand nombre (la majorité) d’échouages et de naufrages qui survenait dans les parages.
Beatriz Palazuelos Mazars indique que les voyages aller-retour se faisaient en général « sur deux années contiguës : normalement, le galion appareillait de Manille fin juin ou début juillet de l’année N, arrivait à Acapulco à la fin de l’année N ou au début de l’année N+1, et le retour était entamé au mois de mars pour entrer dans la baie de Manille début juin de l’année N+1. » (p. 104). Quand il n’y avait pas de galion, on envoyait des avisos. La traversée était éprouvante pour tous, équipage comme passagers.
L’auteure signale d’ailleurs un cas extrême quand, en 1657, le Nuestra Señora de la Victoria dériva au large d’Acapulco ; à bord, on ne trouva que des squelettes… L’arrivée en vue des côtes de la Nouvelle-Espagne était vécue comme un immense soulagement, à tel point, par exemple, que les commerçants philippins pariaient aux combats de coqs le montant des bénéfices qu’ils comptaient réaliser à la foire d’Acapulco.
La dureté du voyage et du traitement qu’on leur infligeait poussait les équipages à déserter à leur arrivée à Acapulco. Pour reconstituer des équipages pour le voyage de retour, on enrôlait donc de force vagabonds ou désoeuvrés. Par ailleurs, on manquait de bons pilotes, car ces derniers, une fois fortune faite, abandonnaient leurs fonctions. Malgré les restrictions, et l’interdiction de 1696, on employa régulièrement des pilotes étrangers pour faire face à la pénurie.
Très progressivement, sous l’effet du choix d’Acapulco comme pièce essentielle du dispositif de colonisation et d’exploitation des Philippines, le tissu urbain se densifia : au début du XVIIè siècle furent construits les principaux bâtiments liés au trafic du galion (notamment la Douane et les entrepôts), le fort de San Diego (pour protéger la cité contre les menées des ennemis de l’Espagne et des pirates), l’arsenal, des ateliers de ferronnerie et de tonnellerie ainsi qu’un hôpital digne de ce nom.
Différents quartiers virent le jour, comme celui de Tecomate, situé dans la partie basse du fort où résidaient les soldats, ou encore, au milieu du siècle, celui de Guinea, habité par les Noirs. Beatriz Palazuelos Mazars affirme à ce propos que la population d’Acapulco était au XVIIè siècle majoritairement noire, mais elle ne fournit pas de statistiques à l’appui de son affirmation. Les vecinos d’Acapulco n’hésitaient pas à louer les services, bien rémunérés, de leurs esclaves lors de la foire. La cité se trouvant dans une zone sismique, les constructions ne dépassaient pas un étage. Les toits à deux pans étaient recouverts de feuilles de cocotiers, une technique rapportée des Philippines. La nature du bâti était donc propice aux incendies, tel que celui de 1648, la quema universal, qui ravagea une bonne partie de la ville dont le célèbre hôpital.
Lorsque l’arrivée du galion était annoncée, la ville d’Acapulco sortait de sa léthargie : l’élite et les fonctionnaires revenaient dans la cité après l’avoir désertée une bonne partie de l’année en raison des conditions climatiques et la population triplait aux dires de l’aut eure. La feria d’Acapulco était sans doute la plus importante de la Nouvelle-Espagne à l’époque. On y vendait un certain nombre de marchandises en provenance de l’Asie orientale, fort prisées au Nouveau Monde, à commencer par la soie : d’ailleurs, en raison de son chargement le plus précieux, le galion de Manille était qualifié de « galion de la soie » à son arrivée au port. La Couronne veillait toutefois à limiter la valeur de la cargaison de soie chinoise à 250 000 pesos. Venaient ensuite différents objets destinés à l’embellissement des riches demeures de Mexico notamment, comme des christs en ivoire, des biombos (paravents), des porcelaines ainsi que de la cire et des épices (clou de girofle, cannelle, poivre). Les influences asiatiques se firent sentir dans bien des domaines : par exemple, le rebozo,sorte de châle porté par les populations de Nouvelle-Espagne, subit, à partir du XVIIè siècle « des transformations inspirées des tissus originaires d’Inde », puis au siècle suivant, « fut brodé de dragons, faisans et galions, imitant les broderies chinoises joliment finies et à grande combinaison de couleurs. » (p. 217).
La foire était méticuleusement organisée : la cargaison était débarquée sur ordre du vice-roi, vérifiée à la Douane puis conservée dans les entrepôts. Une fois les impôts payés et la foire autorisée par arrêtés royaux, les marchandises étaient exposées sur la Grand Place. Une fois les transactions réglées, les marchandises étaient acheminées vers la rue principale et les ruelles adjacentes où les attendaient les files de mules et d’ânes qui les transporteraient vers l’intérieur de la Nouvelle-Espagne (le métier de muletier était d’ailleurs une des spécialités, fort lucratives, des petites villes voisines d’Acapulco : Tixtla ou Chilapa). Le chemin qui menait à Mexico était « étroit, sinueux, escarpé » (p. 80) et infesté de bandits en raison des richesses qui l’empruntaient. Tout au long du siècle, malgré quelques améliorations, ce chemin « ne fut pas à la hauteur de l’importance de la circulation et du commerce pratiqué à Acapulco par temps de foire. » (p. 81).
Quoi qu’il en soit, le trafic lié au galion enrichissait de nombreux acteurs, et pas seulement ceux qui y avaient été autorisés par la Couronne. En théorie, seule la Nouvelle-Espagne était autorisée par celle-ci à commercer avec les Philippines. La Permission générale de 1593 avait réorganisé les règles concernant la navigation entre l’Amérique hispanique et l’Asie orientale. Retenons notamment que le commerce était autorisé uniquement entre les Philippines et la Nouvelle-Espagne, ce qui avait conduit à la suppression de la ligne régulière entre Manille et Callao au Pérou ; que seules les Philippines pouvaient commercer avec la Chine ; que la vente des marchandises en provenance du galion sous l’égide de ‘la communauté des Philippines’ était réservée à la Nouvelle-Espagne. Bien entendu, de nombreuses entorses eurent lieu, favorisées par la distance et les difficultés de communication entre le cœur du pouvoir royal espagnol et l’empire. Tout le monde trouva un intérêt, tant en Amérique qu’aux Philippines, à contourner les règles fixées par la monarchie : « les commerçants novohispanos cherchèrent à participer directement à ce commerce ; les Péruviens trouvèrent des subterfuges pour aller à la foire ; les fonctionnaires d’Acapulco, du vice-royaume, les officiers et équipages du galion, cherchèrent à améliorer leurs situations en commerçant […]. » (p. 38) Dans un ouvrage récent, Pierre Ragon a par exemple montré tout l’intérêt que le comte de Baños, vice-roi de Nouvelle-Espagne au milieu du siècle, portait au galion de Manille et la manière dont il s’y prenait pour en retirer de gros profits malgré l’interdiction royale.
Quand la foire était terminée, l’élite désertait la cité et le galion s’en retournait à Manille, transformé. Il tenait alors plus du navire militaire que du navire de commerce : en effet, outre les cargaisons commerciales du retour (cochenille d’Antequera destinée à teindre la soie, savon, chapeaux de drap utilisés par les religieux et les membres du gouvernement des Philippines, chocolat et tabac), le navire transportait le situado (soutien financier) et le socorro (soutien militaire) destinés à Manille.
La réalité quotidienne d’un port au XVIIè siècleLe volume d’argent mexicain, formé de pièces de huit réaux, était limité par les autorités pour éviter une évasion massive vers la Chine, surtout. L’auteure indique par exemple, après d’autres, que la plus grande partie de l’argent parti d’Acapulco entre 1597 et 1602 sous forme de lingots ou de pesos de huit réaux disparut en Chine…
Le galion du retour transportait également des soldats, du matériel militaire et de la poudre. Les Philippines devaient en effet assurer leur sécurité contre d’éventuelles agressions européennes et, surtout, faire face aux éventuelles révoltes des populations chinoises et japonaises de Manille ainsi qu’à la menace constante des pirates malais de Jolo et de Mindanao. Les soldats enrôlés pour les Philippines l’étaient sur le sol de la Nouvelle-Espagne : comme ils étaient fort peu expérimentés (au contraire des soldats espagnols ayant combattu régulièrement sur les théâtres européens) et souvent très jeunes (moins de douze ans !), le secours n’était guère efficace…
Parmi les passagers figuraient aussi des Novohispanos impliqués dans le commerce de Manille qui devaient alors résider au moins huit ans aux Philippines ainsi qu’un fort contingent de religieux. Comme l’archipel des Philippines était une terre d’évangélisation, la plus grande partie des missionnaires (augustins, franciscains, dominicains, jésuites) qui y étaient envoyés passaient à Acapulco après un long voyage depuis l’Europe : « La quantité de religieux en instance de départ était telle qu’ils étaient parfois dans l’obligation de louer des maisons pour entreposer leurs bagages, même s’ils disposaient d’un couvent à Acapulco » (p. 200).
Au début de son livre, Beatriz Palazuelos Mazars semble justifier son titre et esquisser une perspective : « Difficulté, distance, et temps sont les mots-clés d’Acapulco et du galion de Manille. Leur association modifia la vie quotidienne de cette ville au XVIIè siècle. » (p. 19) La suite nous apprend indéniablement beaucoup, sur la cité, certes, mais surtout sur les relations commerciales et maritimes entre elle et les Philippines, via le galion de Manille, objet de toutes les attentions de l’auteure. De sorte que le livre s’écarte en partie des promesses du titre. Cela tient sans doute à plusieurs traits : l’introduction ne formule pas de problématique explicite susceptible de conforter l’idée que la recherche va réellement questionner et explorer le quotidien d’Acapulco; le plan proposé, trop fragmenté et parfois incohérent, conforte, hélas, cette première impression et organise mal la masse de connaissances exposée. Il aurait sans doute fallu davantage centrer le propos sur Acapulco ainsi que sur quelques portraits d’acteurs, individuels ou collectifs, et structurer autrement le discours. Par ailleurs, si l’ouvrage comporte quelques documents iconographiques, trop sommairement commentés, il ne comprend pas de plan de la ville et de son port à différentes époques ni de statistiques utiles sur les groupes sociaux évoqués (poids relatif, statuts, fortunes, etc.).