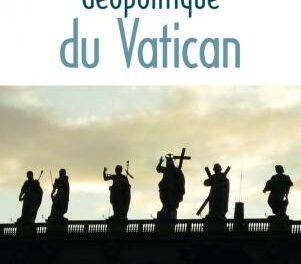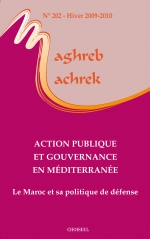
« Action publique et gouvernance en Méditerranée » Maghreb Machrek, numéro 202, hiver 2009-2010, Choiseul édition.
Ce numéro de Maghreb Machrek est une réflexion sociologique sur le concept de gouvernance, sa pertinence ou sa non pertinence dans le cas des pays arabes méditerranéens.
Une bonne partie de chaque article porte sur des considérations sociologiques théoriques. Je n’en parlerai pas et me concentrerai plutôt sur ce qui est plus proche de l’histoire et de la géographie.
Jean Yves Moisseron, qui présente ce numéro, s’interroge sur l’idée de gouvernance. Le mot sous-entend un cap, une direction, un but. Mais rien ne dit que l’on atteindra ce dernier, notamment dans les pays étudiés. En particulier le succès d’une gouvernance suppose l’existence d’un État au sens classique du terme, alors que la sociologie montre que, surtout dans les pays étudiés, l’État n’est pas un décideur mais un lieu d’affrontement d’intérêts variés. Le pouvoir arabe fort est un mythe et « sa rationalité est moins rationnelle que procédurale ». Suit une remarque tout à fait pertinente sur « la dynamique d’intégration des hommes d’affaires dans les logiques rentières » des gouvernants.
Le monde arabe parle le langage de la bonne gouvernance lorsqu’il s’agit de se présenter comme bon élève vis-à-vis des bailleurs de fonds internationaux, comme le fait la Tunisie (j’ajouterai le Maroc). Mais la réalité a été moins étudiée que la question de l’autoritarisme, qui intrigue les chercheurs car c’est la seule région du monde où il ne recule pas.
L’anthropologie et la sociologie du monde arabe ont longtemps été à base marxiste et structuraliste, avant d’être bousculées par « le paradigme néolibéral ». L’auteur plaide sur la nécessité de «mener une réflexion sur « l’inefficacité, l’inefficience et l’ineffectivité des politiques publiques ».
Claude de Miras s’interroge dans le deuxième article sur l’action publique territoriale au Maroc. Après une partie théorique l’auteur décrit la déconcentration du pouvoir et sa double hiérarchie. La première, politique, sous la responsabilité du ministre de l’intérieur est toujours orientée vers la sécurité et l’ordre public avec maintenant quelques compétences économiques ; l’autre est administrative à partir des ministères compétents. Les deux appuient et encadrent des collectivités locales encore fragiles.
Le résultat est que les protestations locales, dans les bidonvilles par exemple, ne débouchent pas sur un mouvement social, le maillage fin et efficace de l’administration permetant de tout désamorcer sans recourir à la répression ni à des concessions du pouvoir (sauf pour des groupes corporatifs bien organisés). Corrélativement ce ne sont ni les médias ni les partis politiques qui prennent en charge les revendications.
Finalement l’État réussit à concilier « sécurité, continuité politique, stabilité sociale et dynamisme économique »
Aude-Annabelle Canesse analyse dans un troisième article le développement rural en Tunisie. Elle rappelle qu’il s’agit d’un pays historiquement centralisé par la dynastie locale au pouvoir depuis 1705, qui veillait à ce que les Turcs n’aient qu’une autorité nominale. Les Français ont continué cette politique puis ont opéré un début de décentralisation avec des assemblées élues dans les villes. Les campagnes sont restées sans élus et c’est le parti présidentiel, le RCD, qui se charge du maillage, de la remontée des informations et des demandes d’emploi ou d’aide, auxquels s’ajoutent ses fonctions de contrôle politique.
C’est dans ce contexte que sont apparues de nouvelles instances locales élues, les GDA, pour, si j’ai bien compris, faire bonne figure auprès des bailleurs de fonds internationaux, bien qu’en fait ils auraient été mis en place pour « permettre l’interventionnisme de l’État »
Rigas Arvanitis, Hatem M’Henni et Léna Tsipouri font le point des systèmes d’innovation dans un quatrième article. C’est un souci récent dans le monde arabe, qui donne lieu à une rhétorique à usage externe mais n’est en fait reconnu ni par l’État dans la société. L’étude porte sur l’Égypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie qui ont bénéficié d’un programme de « mise à niveau » par l’union européenne de leur recherche scientifique et de l’innovation. Les auteurs commencent par décrire la recherche académique, qu’il voit pilotée de fait par les chercheurs ayant eu une reconnaissance internationale, qui par ailleurs ne rapporte la plus grosse part de leur financement. Parallèlement sont apparus les bureaux d’études qui se font rémunérer leur expertise tant par les gouvernants que par l’étranger et qui souvent sont animés par les mêmes personnes. Les auteurs signalent quelques spécialités : physique chimie mathématique et science de l’ingénieur pour ces huit pays, avec un point fort en Tunisie et au Liban pour les sciences du vivant et la médecine. L’ensemble de cette activité publique ou parapublique ne génère toutefois que très peu de brevets.
Parallèlement les entreprises commencent à se soucier de recherche-développement, mais se méfie de la distraction et de l’État, et donc profite peu des incitations publiques proposées.
Bruno romani, dans la cinquième article analyse « la modernisation » du secteur de l’huile d’argan au Maroc. Après avoir décrit la percée internationale et chic de ce produit « artisanal et bio », puis ses mécanismes commerciaux, il se demande si les objectifs de cette réussite commerciale sont atteints. Il s’agissait de donner des revenus complémentaires aux paysans pauvres, mais ni les circuits classiques, ni les coopératives de femmes berbères « folklorisées », ni le commerce équitable n’ont donné ce résultat, ni permis de maintenir la forêt des arganiers dans les zones périurbaines ou irrigables, notamment autour d’Agadir. À mon avis, c’est une problématique assez classique dans l’agriculture mondiale, y compris au Nord. Plus généralement, en économie, les exploitants locaux pauvres et dispersés sont en position de faiblesse difficilement évitable face à des professionnels aguerris et à une administration théoriquement protectrice mais en pratique corrompue.
Sur un autre sujet, Brahim Saydi nous expose la politique de défense du Maroc et la politique extérieure qui lui est liée. Il insiste sur l’articulation de l’interne et externe : maintien de l’ordre, défense de la monarchie, défense des frontières contre l’Algérie et le front Polisario. La France jouait déjà ce rôle à l’époque du protectorat. Équiper cette armée est coûteux (1,5 à 2 milliards de dollars par an, ce qui reste très inférieur au budget algérien, mais le Maroc n’a pas les ressources en gaz et pétrole de son voisin). L’auteur note que le Maroc n’a jamais été attiré par la prolifération nucléaire biologique ou chimique ni par par l’acquisition de missiles. Il est signataire du traité de non-prolifération ce qui lui confère le droit d’accès à la technologie nucléaire à des fins pacifiques. Après une phase d’inquiétude force est de constater que l’Algérie qui avait eu des velléités dans ce domaine semble les avoir abandonnés. En politique extérieure l’armée marocaine est active dans les missions onusiennes de maintien de la paix pour garder une audience internationale ; elle soutient les armées et les forces de sécurité de l’Arabie et des émirats, qui l’aident financièrement. Le Maroc est également membre de plusieurs organisations de défense de sécurité aux côtés de l’Europe et des États-Unis.
Le numéro se termine par le compte rendu d’un ouvrage historique sur l’Iran et d’un autre sur la lente agonie d’Al Qaïda.
Ce numéro permet d’avoir un éclairage inhabituel sur la rive arabe de la Méditerranée. Je remarque en particulier qu’il n’est jamais question de religion ni de langue, alors que l’islam d’une part, l’arabité d’autre part (et donc le rôle du français ou de l’anglais selon les pays) jouent un rôle à la fois dans les proclamations et dans les pratiques.