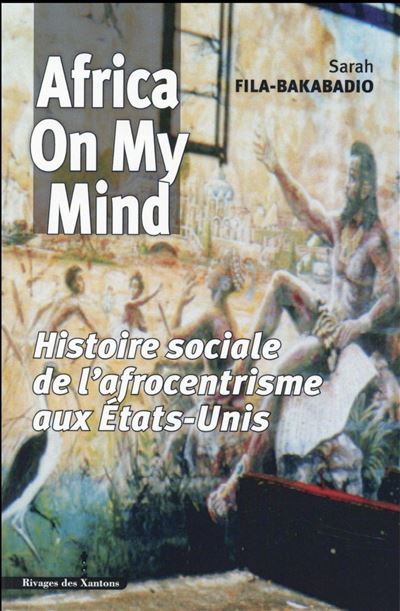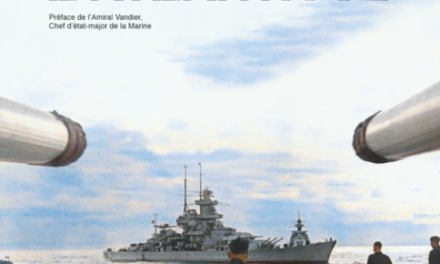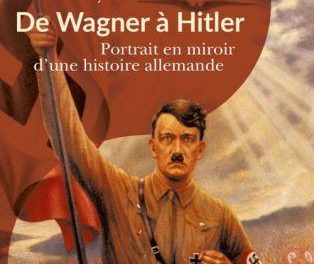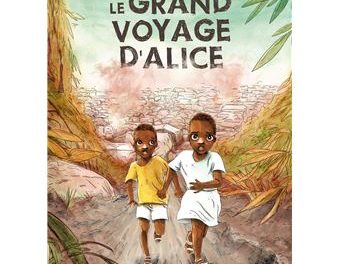Composée dans les années trente, la chanson Georgia on my Mind est devenue un symbole de la lutte contre la ségrégation raciale à travers l’interprétation magnifique qu’en a faite Ray Charles, au point de devenir l’hymne officiel (State Song) de l’État de Géorgie. Sarah Fila-Bakabadio s’en est manifestement inspirée pour le choix du titre de cet ouvrage. L’autrice a poursuivi dans son travail de thèse une exploration en profondeur de l’afrocentrisme, qui se développa aux États-Unis au cours des années 1980 pour atteindre son apogée vers l’an 2000. Historienne en études américaines et afro-américaines, aujourd’hui Maître de conférences à l’Université de Cergy-Pontoise, elle en est incontestablement la meilleure spécialiste en France. Outre ses lectures, en particulier les publications non-traduites des théoriciens, elle a mené plusieurs enquêtes de terrain, notamment à New York dans le quartier de Harlem. Elle s’est entretenue avec des étudiants et universitaires états-uniens se revendiquant de l’afrocentrisme, a participé à des rassemblements, visité des librairies et des boutiques, écouté des musiques, s’est intéressée aux arts de rues, a visionné des films et documentaires afrocentrés. L’autrice propose ainsi une critique très documentée de l’afrocentrisme.
Peu après les indépendances africaines, l’afrocentrisme s’est développé en contexte états-unien, dans le sillage du mouvement des droits civiques, pour poursuivre voire relancer la lutte contre des discriminations toujours vivaces. Il s’agit d’un nationalisme en lutte contre la suprématie blanche, défendant l’autodétermination des peuples noirs. L’afrocentrisme a proposé une nouvelle représentation, une autre invention de l’Afrique, incarnant pour ce continent une construction exogène de plus, destinée à concurrencer les interprétations européennes et euro-américaines. Travaillant sans cesse le thème de la continuité culturelle tissée depuis l’Égypte, défendant notamment les idées d’antériorité et d’africanité de la civilisation de l’Égypte antique, les afrocentristes ne se sont pas contentés d’explorer le passé pour en diffuser la connaissance, ils ont mêlé science historique et politique.
Sarah Fila-Bakabadio nous apprend que les afrocentristes ont réhabilité une vision biologisante des individus, ne laissant manifestement la place à aucun libre-arbitre. Ils ont sédimenté des oppositions entre Blancs et Noirs, négligeant par là même tout ce qui n’est ni « africain » ni « européen ». Ils ont essentialisé la racine africaine et ainsi se sont inscrits dans un déterminisme racial laissant peu de place à une discussion sur la diversité africaine et l’hybridation des cultures. L’autrice s’appuie pour sa part sur l’approche de Paul Gilroy dans L’Atlantique noir (1993, traduit en Français en 2017 aux Éditions Amsterdam), qui a renouvelé en profondeur la manière de penser l’histoire culturelle de la diaspora africaine. Sarah Fila-Bakabadio voit une opposition entre un nationalisme noir à tendance séparatiste présent au sein des afrocentrismes et ce que l’on pourrait peut-être nommer un panafricanisme atlantique. Elle aspire manifestement à une intensification des échanges transnationaux pour une circulation réelle des idées, des hommes et des cultures à travers l’Atlantique.
Comme son sous-titre l’indique, l’ouvrage est une histoire sociale de l’afrocentrisme. L’autrice se montre particulièrement critique à l’égard de ses trois principaux théoriciens, les universitaires Maulana Karenga, Molefi Asante et Leonard Jeffries. Ils semblent en premier lieu avoir voulu fonder l’Afrocentrisme, avec une majuscule, dans le but d’ajouter leurs noms sur la liste des grands penseurs et leaders africains-américains, à la suite de W. E. B. Du Bois, Marcus Garvey, Martin Luther King et Malcolm X. Mais leur ambition de créer un mouvement unifié n’est pas devenue réalité. Au delà d’une certaine unité de façade, ils ont finalement évolué dans des cellules éparses voire concurrentielles. Ils n’ont pas réussi la jonction avec les afrocentrismes populaires, sans majuscule et au pluriel. Ces derniers sont demeurés pour l’essentiel une revendication de l’africanité des Africains-Américains, ouverte à cette hybridation entre héritages américains et africains précisément écartée par les théoriciens.
La critique des théoriciens est peut-être parfois sévère. Ils ont tout de même favorisé l’apparition et le développement des études africaines et afro-américaines dans les universités états-uniennes. Aussi, Maulana Karenga a créé la fête de Kwanzaa, devenue très populaire aux sein des communautés africaines-américaines. Pour sa part, Asante a lu les « pères fondateurs » des nations africaines tels Kwame N’Krumah ou Julius Nyerere. Il s’est aussi beaucoup inspiré du sénégalais Cheick Anta Diop qu’il a personnellement rencontré. Ainsi, le panthéon afrocentriste n’est pas exclusivement américain puisque Diop figure précisément avec Marcus Garvey et Malcolm X parmi les trois grands « prophètes afrocentristes » (p. 90). Asante s’est en outre appuyé sur la notion d’agency, qui remet au moins partiellement en question le déterminisme racial et donne une marge d’expression au libre-arbitre.
Placé parmi les trois principaux théoriciens de l’Afrocentrisme par l’autrice, Leonard Jeffries paraît pourtant moins connu et influent qu’Asante et même Karenga. Il a incarné une variante extrême des afrocentrismes, entachée d’antisémitisme. Il semble à vrai dire que tant que le suprémacisme blanc sera une réalité, la tentation – aussi peu féconde soit-elle – de s’opposer par simple inversion du racisme eurocentré existera. Sarah Fila- Bakabadio sous-estime peut-être dans cet ouvrage la profondeur et les permanences du racisme aux États-Unis.
Pourtant, la lutte intellectuelle des Noirs états-uniens ne date pas d’hier. Lorsque l’autrice affirme que Martin Delany et Alexander Crummell ont été des « pionniers de la tradition du pasteur militant » (p. 285), elle oublie les combats menés deux ou trois générations plus tôt par Absalom Jones et Richard Allen à Philadelphie, sans parler de Prince Hall, qui semble-t-il ne fut pas plus pasteur que Delany mais fonda la franc-maçonnerie noire à Boston dans le dernier quart du XVIIIe siècle également.
Par ailleurs, avant les afrocentristes, les suprémacistes blancs avaient eux-mêmes instrumentalisé l’histoire de l’Égypte antique. Par exemple George Robin Gliddon (1809 – 1857), égyptologue anglais et vice-consul des États-Unis au Caire, réfuta l’idée défendue notamment par Hérodote et le Français Volney selon laquelle les Égyptiens de l’antiquité étaient noirs. Gliddon affirma qu’ils étaient blancs et que les différences et la hiérarchie raciales existaient dès l’époque des pharaons, dans un ouvrage qui fut un grand succès d’édition notamment dans les États du sud des États-Unis(1). Les intellectuels noirs, en particulier ceux férus d’Égyptologie comme Cheikh Anta Diop et les afrocentristes, connaissaient sans aucun doute l’École américaine d’ethnologie dont fit partie Gliddon. Ses thèses racistes furent déconstruites dès 1854 par Frederick Douglass dans son fameux discours « The Claims of the Negro, ethnologically considered ».
Ces quelques remarques et précisions n’enlèvent en rien la qualité de ce travail de recherche remarquable réalisé par Sarah Fila-Bakabadio. Elle demeure attachée aujourd’hui au sujet de sa thèse, soutenue en 2009, puisque sa dernière publication porte sur l’histoire des panafricanismes, dans l’ouvrage collectif dirigé par François-Xavier Fauvelle et Anne Lafont, intitulé L’Afrique et le monde : histoires renouées (Paris, La Découverte, 2022).
_______________
(1) William Stanton, The Leopard’s Spots. Scientific Attitudes toward Race in America, 1815-1859, Chicago & Londres, The University of Chicago Press, 1960, p. 50, 163, 176. Un contresens de l’autrice apparaît au sujet de la pensée de Volney (p. 60, 84 et 106), voir Sarga Moussa, « Noirceur orientale. L’Égypte de Volney », mai 2007, Hal-00910102, p. 10-11, https://core.ac.uk/download/pdf/52309528.pdf