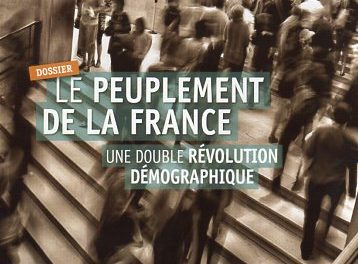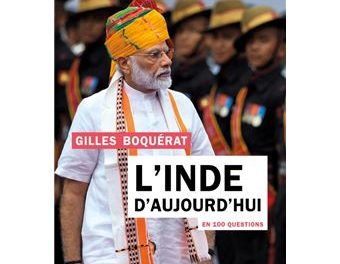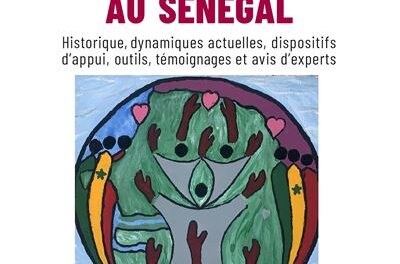Le numéro d’été de «Problèmes d’Amérique Latine» propose un panorama complet des difficultés de la démocratie en Amérique centrale, incluant des aspects économiques et sociaux. L’ensemble des quatre articles fait bien émerger les diverses fragilités de ces pays intermédiaires dont on entend peu parler, sauf en cas de catastrophe naturelle ou de grande criminalité liée au trafic de drogue.
DIFFICULTÉS DE L’INTEGRATION ÉCONOMIQUE ET DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE CENTRALE
Le premier article rédigé par Philippe Létrilliart, du CERI, s’attache à faire un état des lieux de l’intégration centre-américaine. Un des premiers soucis des pays d’Amérique centrale est d’être coincé entre deux grandes organisations régionales puissantes, l’ALENA au nord et le MERCOSUR au sud, avec un manque de visibilité et de manoeuvre pour le SICA (Sistema de la Integracciòn Centroaméricana, crée en 1991 pour remplacer l’Organisation des Etats Centre Americains de 1951),le CAFTA ( Central America Free Trade Agreement) et le MCCA (Mercado Commùn Centroamericano, 1960). Ces organisations régionales ne regroupent pas tous les pays d’Amérique centrale. Le SICA comprend le Guatemala, le Belize, le Salvador, le Honduras, Panama, le Costa Rica et le Nicaragua. Le CAFTA intègre, outre les Etats-Unis et la République Dominicaine, le Salvador, le Honduras, le Costa Rica, le Guatemala et le Nicaragua. Ces cinq états forment aussi le MCCA. Il y a une différence de fond entre le SICA et le CAFTA-MCCA. Le premier s’inspire plutôt du modèle d’intégration européen, avec coopération institutionnalisée, marchés régulés et institutions supranationales. L’autre, sous l’égide des Etats-Unis, est un simple accord de libre échange de type «gouvernance globale» avec maintien de la souveraineté des états et code de bonne conduite en terme de réglementation. Le premier est soutenu par l’Union Européenne, l’autre, évidemment, par les Etats-Unis. Le bilan du SICA est mitigé : il s’agit plus de coopération que d’action véritablement supranationale. Les institutions communes peinent à fonctionner. En revanche, les sommets permettent de d’aborder des sujets négligés comme les migrations internationales ou les questions d’environnement. En ce qui concerne le MCCA, Philippe Létrilliart note son dynamisme économique mais pointe aussi son inertie sociale. Un autre problème de ces organisations régionales est que, pour un certain nombre de représentants, les fonctions occupées tiennent plus de la sinécure que d’une réelle implication personnelle. Dans ce contexte, la plupart des états se font pragmatiques et misent sur une ouverture régionale plutôt favorable au CAFTA.
Le second article traite plus directement de la fragilité des systèmes démocratiques en prenant l’exemple des dernières élections de 2007 au Guatemala qui virent la victoire d’Alvaro Colom du parti Unité Nationale et Espoir. On est d’abord surpris par le nombre important de candidats, alors que l’abstention (35,5%) est considérable. Toutefois la majorité de ceux-ci est négligée par les médias qui se concentrent sur deux candidats, dans une configuration à l’américaine, réunis autour du thème de la sécurité. Une candidate, dont on a un peu parlé en France et en Europe, le prix Nobel de la Paix Rigoberta Menchu, fut peu couverte par les médias de son pays et ne recueillit que 3,1% des voix, consacrant là la faiblesse de la gauche au Guatemala, de tradition centre-droit.
Les sommes investies pour les campagnes, très consensuelles et fortement personnalisées, sont importantes et non limitées. Paradoxalement, le parti qui a le plus dépensé et qui partait favori, le Parti Populaire du général Perez n’a pas remporté la victoire. Même si, au final, l’abstention a un peu reculé par rapport aux précédentes élections, l’article pose le problème de l’efficacité de l’action des politiques dans un pays pauvre, socialement contrasté, miné par le crime, la drogue, l’absence de citoyenneté réelle et où la corruption reste de mise, entrainant démotivation, passivité, repli sur soi et volatilité du vote essentiellement fondé sur le charisme, beaucoup plus que sur le projet politique.
POLÉMIQUES NICARAGUAYENNES
Rédigé par Delphine Lacombe de l’EHESS, le troisième article s’attache à l’affaire Zoilamérica Narvaez : fille adoptive du dirigeant sandiniste Daniel Ortega, actuellement président du Nicaragua, elle a accusé en 1998 ce dernier d’attouchements et de viols à partir de l’âge de onze ans. Des accusations qui eurent un grand retentissement au Nicaragua en raison de l’aura mythique de Daniel Ortega, qui incarna le combattant révolutionnaire sandiniste même si, actuellement, Ortega ne représente plus que lui même, ou plus précisément ce qu’on appelle le «daniélisme» ou «l’ortegisme». Le fait que Zoilamérica se réclame toujours militante sandiniste a aussi son importance, car le sandinisme se présentait comme anti-machiste et en faveur de l’égalité des sexes.
Trois attitudes, pour schématiser, ont été adoptées lors de cette affaire : la première, issue des cercles proches d’Ortega, a consisté à discréditer Zoilamérica et à considérer les attaques contre Daniel Ortega comme des atteintes insupportables à sa réputation. La seconde attitude a été de reconnaître, à demi-mot, la responsabilité d’Ortega, mais de la justifier : Zoilamérica devait, au fond, accepter d’être «sacrifiée» pour le bien-être psychologique d’Ortega afin de lui permettre de gouverner le pays dans le bon sens. Enfin la troisième réaction a été de soutenir Zoilamérica, ce qui fut le fait de nombreuses femmes, militantes sandinistes ou psychologues, mais aussi d’une partie de des anti-sandinistes avant qu’un accord soit passé entre elle et Ortega pour que l’affaire soit négligée. En échange du silence d’Ortega sur la corruption du président de l’époque, Arnoldo Aleman, ce dernier soutenait Ortega contre sa fille adoptive. L’affaire s’enlisa, les tribunaux temporisèrent, Ortega fut réélu en 2006, après un intermède de seize ans d’opposition, et Zoilamérica lâcha prise bien qu’ayant tout de même provoqué une prise de conscience sur les violences faites aux femmes au Nicaragua.
Le dernier article est en quelque sorte lié au précédent, il s’agit d’une réflexion politique sur l’avenir du sandinisme «réel», opposé au daniélisme, qui émane de la part de Dora Maria Tellez, dirigeante du Mouvement Rénovateur Sandiniste. C’est une réflexion sur l’avenir de la gauche au Nicaragua et en Amérique Latine, dans laquelle ni Ortega ni Chavez ne sont considérés comme étant de gauche, Tellez considérant le brésilien Luiz Ignacio Lula Da Silva et l’urugayen Tabare Vasquez comme les seul modèles de gauche crédibles en Amérique latine.
GUERILLA ANTICASTRISTE A CUBA
Cette série de quatre articles est complétée par un article sans rapport avec le thème général mais qui reste très intéressant au point de vue historique : les maquis de montagne (alzamientos) à Cuba du temps de Fidel Castro, de 1959 jusqu’à leur disparition en 1965. Le mérite de Vincent Bloch, de l’EHESS, est d’inscrire ce phénomène dans une trame historique plus large. A Cuba, la région montagneuse et centrale de l’Escambray, au sud-est de La Havane, a toujours été un lieu de refuge pour les personnes opposées aux autorités de l’île malgré sa faible altitude (931 mètres à son point culminant). Du temps de la domination espagnole, il s’agit de palenques où se réfugiaient les «nègres marrons», les bandits et les hors-la-loi. Avec l’indépendance, la région des montes abrita les opposants au premier président Cubain qui favorisait les grands propriétaires, puis les forces opposées aux gouvernements pro-américains, jusqu’à Fidel Castro lui-même. On est là dans une certaine forme de tradition de guérillero, «prendre le mont», «prendre le maquis», avec des rites, des images, une certaine fascination pour celui qui à le courage de vivre de presque rien dans le «pays en dehors». Il était donc normal qu’une fois le régime communiste de Castro établi cette région continue à accueillir des combattants, cette fois-ci anticastristes : soit des déçus du régime, soit d’authentiques supporters de Battista soutenus et armés par la CIA et bardés de la même aura mythique que leurs prédécesseurs. Cette guérilla contrôlera des pans entiers du pays entre 1959 et 1963. A partir de cette année, les revers se multiplient et les chefs, de plus en plus jeunes, sont progressivement éliminés pour disparaître totalement en 1965. L’explication de ce revers est simple : les forces anticastristes sont des victimes collatérales de la crise de Cuba. En échange du retrait des missiles, Kennedy s’était engagé à ne plus tenter de déstabiliser Cuba. Coupés de l’aide américaine, les guérilleros ne pouvaient plus mener le combat bien longtemps. Cet article a donc le mérite de mettre en lumière un phénomène méconnu, de l’insérer dans une tradition latino-américaine et de le lier à la «grande» histoire, celle de la Guerre Froide.