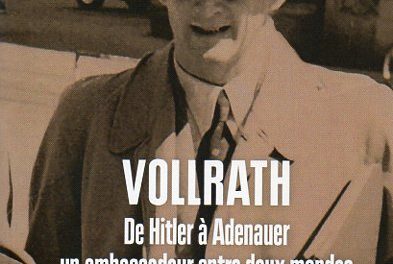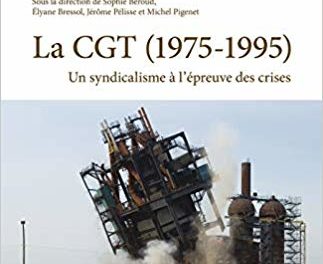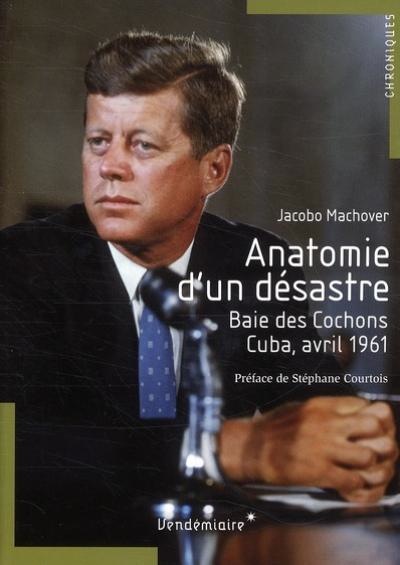
La Crise des fusées à Cuba en 1962 a été un des pics de la Guerre Froide. Les péripéties de ce bras de fer stratégique remporté par Kennedy figurent parmi les classiques incontournables des programmes scolaires de lycée et des épreuves de Bac – avant comme après la réforme en cours. Mais l’affaire de la Baie des Cochons n’y apparaît que comme un arrière-plan flou du contentieux entre le jeune régime castriste et la puissance américaine en mal de «roll back». La synthèse formulée dans ce livre par Jacobo Machover, enseignant-chercheur spécialiste du Castrisme et lui-même d’origine cubaine, a précisément pour objet de restituer le contexte préparatoire à la confrontation de 1962 et d’éclairer ce qui en fut la première manche, perdue par les États-Unis. Il en résulte une mise au point précise et exhaustive qui possède tous les attributs pour faire référence, et remédie à avantageusement à une lacune historiographique.
Introduite par une préface incisive de l’historien du communisme Stéphane Courtois, la publication de cet ouvrage, aussi accessible au débutant qu’utile à l’initié, s’inscrit dans une logique commémorative, à l’occasion du cinquantenaire du désastre de la Baie des Cochons. Ce moment déterminant a enraciné le pouvoir et le prestige du leader des «Barbudos», parvenu au pouvoir en 1959 en renversant le dictateur Fulgencio Batista. Largement délaissé par la littérature historique en langue française, ainsi que le confirme la bibliographie utilisée et commentée par l’auteur, pour l’essentiel en langues anglaise et espagnole, cet épisode s’avère pourtant une pièce essentielle à la compréhension non seulement de la Crise des fusées, mais également de la présidence Kennedy et de l’histoire contemporaine funeste du peuple cubain.
Le défi castriste
Le premier mérite de Jacobo Machover est de souligner avec clarté les spécificités de la mise en œuvre du Castrisme. Il ne s’agit pas d’un énième avatar du traditionnel caudillisme sud-américain mais d’un système totalitaire performant, où l’alibi idéologique du communisme légitime la domination et les privilèges d’une nouvelle classe dirigeante dominée par Fidel Castro, «égocrate» doué, et fort de l’encadrement policier et idéologique serré imposé à la population. Initialement, la nature réelle du régime n’a pas été perçue par les États-Unis. Ils ont même manifesté une authentique sympathie à l’égard du jeune héros vu comme une sorte de nouveau Bolívar. Mais ils sont vite révulsés par la réalité du Castrisme : la répression sanguinaire accompagnant la mise en place de la dictature communiste, et l’expropriation massive et sans indemnisation des 400 compagnies américaines implantées dans l’économie cubaine (pétrole, sucre, transports, services). A cela s’ajoute l’hostilité ouverte du nouveau régime à l’égard de son puissant voisin, poussée jusqu’à la rupture des relations diplomatiques en janvier 1961. Le rapprochement de l’île avec l’URSS confère bientôt au défi régional une épaisseur stratégique que l’affaire des fusées devait rendre vitale.
Face à cette situation, la réaction des Américains se situe dans la logique de la Doctrine Monroe. Le cas cubain est abordé comme une affaire interne, et considéré comme le Berlin-Ouest du continent américain. La confiance est d’autant plus de mise que les décideurs raisonnent par analogie avec le succès aisé obtenu en 1954 au Guatemala. En mars 1960, le président Eisenhower autorise donc la CIA à soutenir les projets des exilés anti-castristes à Miami. L’opération est patronnée par le vice-président Nixon, alors convaincu de succéder à son mentor. Ironie du verdict des urnes, c’est finalement son challenger John Kennedy qui devait assumer le passage à l’acte, et les conséquences de son échec…
La désastreuse Opération Zapata
Vus dans l’île comme des mercenaires de la contre-révolution, les réfugiés anticastristes en exil sont considérés par leurs appuis américains comme d’authentiques révolutionnaires trahis par un leader infidèle. Une opération militaire de reconquête est élaborée. Ses préparatifs sont de notoriété publique et justifient la répression féroce organisée dans l’île pour annihiler tout soutien potentiel aux futurs assaillants. Ceux-ci s’organisent au sein de la brigade 2506, constituée de 1500 combattants. Si quelque-uns sont d’anciens Batististes, la plupart sont de révolutionnaires déçus, avec une forte représentation sociologique des classes moyennes et 15% d’anciens militaires. Ils ont pour ciment idéologique commun un fort anticommunisme. Leur formation est dispensée au Guatelama par des instructeurs américains dépendant de la CIA. La direction politique de l’entreprise est assumée par un collège d’exilés de Miami, sous l’autorité d’ex-ministres de Castro passés dans l’opposition. Ils ont l’intention de former un gouvernement provisoire dans la zone libérée par le débarquement. Nourris par de mauvais renseignements et beaucoup d’illusions, les exilés ont la conviction que la population est acquise à leur cause et va se soulever spontanément à leur arrivée pour renverser Castro.
L’expédition embarque au Nicaragua sur une petite armada privée de vieux cargos appartenant à un armateur cubain en exil. A son arrivée devant Cuba, l’«Opération Zapata» est lancée dans la nuit du 16 au 17 avril 1961. Mais son déroulement est catastrophique, victime d’un lourd cumul de handicaps tactiques : l’insuffisance et l’inefficacité du soutien aérien, un posé nocturne sur un point de débarquement mal choisi et mal connu, inadapté à un abord amphibie à cause de récifs de corail sur lesquels coulent plusieurs chaloupes de débarquement, une approche non dissimulée qui annihile tout effet de surprise, et enfin l’abandon des mesures de diversion prévues sur d’autres secteurs côtiers, ce qui autorise une concentration de la riposte castriste. Sur le rivage, les assaillants sont immédiatement en infériorité numérique malgré la puissance de feu assurée par les moyens mécanisés en leur possession (quelques chars, canons et mortiers). L’aviation castriste, qui n’a pas été neutralisée, utilise sa supériorité aérienne pour couler deux des quatre navires de débarquement avec leur cargaison vitale de matériel militaire. Acculée, la brigade est incapable de consolider une tête de pont où aurait pu venir s’établir le gouvernement en exil pour demander l’appui des pays amis. Retranchés sur la plage sans solution de repli, les combattants anticastristes sont submergés par le nombre après 72h de combats, malgré les pertes terribles essuyées par l’adversaire, notamment parmi les miliciens locaux engagés massivement en premier lieu, avant l’arrivée des forces régulières dotées d’un armement lourd. A bout de munitions, le gros de la troupe met finalement bas les armes, tandis qu’encerclés dans les marais côtiers, où ils ont tenté de s’enfuir, quelque dizaines d’irréductibles (dont les trois principaux chefs militaires de la brigade) sont capturés au bout de plusieurs jours, vaincus par la soif et le quadrillage du terrain. En tout, 1150 captifs tombent aux mains de Castro, quelques hommes étant parvenus à s’échapper par la mer. En revanche, seule lacune perceptible de l’information délivrée par l’auteur, le bilan des tués n’est pas précisé.
Les erreurs de Kennedy et le triomphe de Castro
Ce désastre sans appel ne s’explique pas seulement par l’accumulation des défauts tactiques qui ont obéré sa viabilité militaire. Il a aussi pour substrat des erreurs stratégiques de fond. L’expédition a été sous-dimensionnée, mal soutenue et lâchée précipitamment par ses commanditaires. Une mauvaise coordination a régné au sein des centres de décision américains. La volonté de la CIA d’aller au bout de l’équipée s’inscrit dans un contexte de forte autonomie de l’agence par rapport à la Maison Blanche. Les hommes de l’ombre nourrissent en effet un solide sentiment de défiance envers l’inexpérience de la nouvelle équipe gouvernementale entourant Kennedy. Les événements ne leur donnent pas tort : impressionné par la vigueur de la bronca que l’annonce du débarquement soulève à l’ONU, alors en séance plénière, saisi par le vacarme médiatique entourant l’événement, et troublé par la menace nette formulée par le Kremlin d’une possible réaction à Berlin, Kennedy a déprogrammé deux des trois raids aériens prévus pour soutenir l’attaque et pour détruire l’aviation gouvernementale cubaine. L’administration américaine va jusqu’à nier contre toute évidence son implication dans l’opération. En un curieux jeu à fronts renversés, les États-Unis cherchent ainsi à occulter leur part de responsabilité, tandis que Castro minimise le plus possible le rôle des opposants politiques cubains. Après la défaite, Kennedy assume pourtant la responsabilité de l’échec militaire sanglant de la tentative : il en va en effet du rétablissement de sa crédibilité internationale.
Effet vertueux de cette proclamation, les prisonniers apparaissent dès lors comme de simples pions d’une puissance étrangère. Cela leur sauve la vie au prix de leur démonétisation comme opposants politiques. Seuls quelques captifs sont fusillés immédiatement en tant qu’anciens militaires batististes. Les autres bénéficient d’un procès médiatique à grand spectacle. Leur sort prend la tournure d’une habile opération de communication médiatique : humiliation télévisuelle et procès public exemplaire sont destinés à faire de l’opération un cas d’école exemplaire de la lutte des classes. Les combattants noirs de la brigade (dont le N°2 de l’expédition) en sont écartés, car leur présence contrarie la thèse castriste sur le soutien de ce groupe discriminé à l’égard de son régime. Mais l’attitude courageuse et digne des captifs face à leurs accusateurs éveille la sympathie des spectateurs. Malgré le risque du peloton d’exécution, leur attitude est peu coopérative. Il n’y a qu’une poignée de repentis, les autres assumant pleinement leur engagement. Castro fait pourtant preuve d’une magnanimité inattendue, qui permet de voiler une répression interne sans faiblesse. Même les trois chefs militaires de l’expédition sont épargnés. Le procès collectif s’achève en meeting où le camarade Fidel annonce que les détenus deviennent une monnaie d’échange. Habile communicant, Castro exige des tracteurs, des médicaments et des aliments pour enfants. Cette mise à prix est supposée «indemniser le peuple cubain». Les pourparlers s’effectuent hors de tout lien visible avec les autorités américaines, même si Robert Kennedy est dans la coulisse des organisations privées qui dialoguent avec Castro. Un négociateur en chef apte à gagner la confiance des deux parties est désigné : il s’agit de l’avocat international James Donovan, qui avait été le médiateur de l’échange berlinois entre le maître espion Rudolf Abel et le pilote d’U2 Francis Gary Powers. Interrompues par la Crise des fusées, les discussions reprennent ensuite et aboutissent en décembre 1962 à un échange global.
La Crise des fusées, revanche de la Baie des Cochons
Castro est donc le grand vainqueur de la Baie des Cochons. Magnifiant sa victoire en se posant en David ayant terrassé Goliath, il acquiert gloire et légitimité internationale. Il profite de l’agression pour proclamer officiellement la nature socialiste de son régime. Il fait montre d’une attitude insultante envers Kennedy. De son côté, ce dernier est le principal perdant de l’épisode. Le lâchage de ses protégés anticastristes démontre son inexpérience, et son attitude en cette circonstance est vue par l’adversaire comme une preuve de faiblesse à sa propre frontière, ce qui autorise de plus grandes audaces à son encontre. En cela, le débarquement avorté de la Baie des Cochons constitue une brique essentielle et indissociable de la Crise des fusées. Il en résulte un intéressant réajustement de perspective suggéré par Jacobo Machover. La Baie des Cochons apparaît en effet comme un préalable fondateur et central. Malgré son caractère dramatique, la Crise des fusées peut bel et bien être perçue comme une incidente de ce premier acte, un simple chapitre du bras de fer inauguré par celui-ci.
Car, si l’installation des missiles à Cuba est le fruit d’une convergence d’intérêts entre le grand frère soviétique et son petit frère cubain, elle s’appuie sur la conviction partagée que l’irrésolution de Kennedy laisse le champ libre à leurs projets. Leur plan de déploiement sur le territoire cubain présente un caractère trop massif pour passer inaperçu. Si les dirigeants castristes n’ont aucun contrôle sur cet outil militaire, ils sont rassérénés par le fait que sa présence constitue en soi une garantie pour la survie de leur régime. Tout comme leurs parrains soviétiques, ils sous-estiment profondément la volonté de réaction américaine, étalonnée sur l’indécision montrée lors de la Baie des Cochons. Tous sont donc d’autant plus surpris par la fermeté de la riposte, qui fait suite à un débat interne arbitrant entre une ligne dure préconisant une invasion militaire de grande ampleur à Cuba, et la ligne attentiste de la quarantaine navale adoptée par Kennedy. Cette fois-ci, le président américain gagne la bataille de la communication à la télévision comme à l’ONU. Humiliation suprême pour Castro, ce dernier est totalement ignoré en qualité d’interlocuteur valable. Kennedy ne négocie qu’avec les dirigeants soviétiques. Dans la coulisse, Castro et ses acolytes se distinguent pourtant en s’affirmant prêts à l’immolation nucléaire et exhortent les Soviétiques à la fermeté ! Mesurant le caractère irresponsable et aventuriste de cette posture, Khrouchtchev préfère entrer en négociation avec les Américains.
L’issue de la confrontation est connue. Castro sauve son régime au prix d’un refroidissement momentané de ses relations avec l’URSS. Il est frustré dans ses espoirs d’exporter la révolution en Amérique Latine. Il n’est cependant pas le seul perdant de l’affaire. Khrouchtchev a lui aussi été affaibli, et devra céder son fauteuil à Brejnev deux ans plus tard. Enfin les pions de manœuvre de la Baie des Cochons, les exilés anticastristes, sont eux aussi lésés par l’issue de la Crise des fusées : floués dans leurs espérances par la garantie de non-invasion de Cuba donnée par le gouvernement américain, ils sont toujours à Miami. De même que, pour on ne sait combien de temps encore, Cuba demeure sous la mainmise du clan Castro.