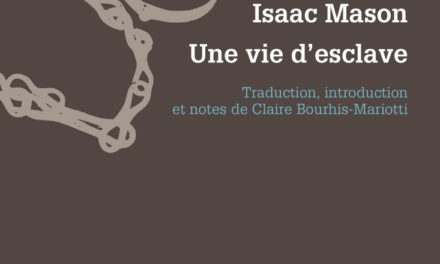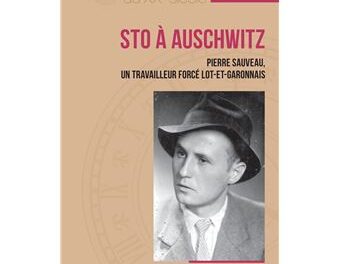Ce livre est le résultat du travail commun de trois des meilleurs spécialistes mondiaux (et Français) du nazisme. Dans ce travail qui s’étend, volontairement, de la fin de la Première Guerre mondiale à la fin de la Seconde, les trois historiens veulent offrir la synthèse la plus à la pointe sur un sujet dont l’historiographie s’est profondément bouleversée ces vingt dernières années.
Dès l’introduction, l’accent est mis sur les ambitions des auteurs. Présenter le nazisme dans un temps plus long que simplement l’arrivée au pouvoir en 1933 et, chemin faisant, déconstruire un certain nombre d’idées reçues. Ensuite, faire le point le plus complet sur les dernières recherches en France, en Europe et dans le monde sur l’ensemble des thématiques évoquées dans cet énorme ouvrage. Avec, à l’appui du lecteur le plus curieux, une énorme bibliographie de plus de 800 titres, témoin de la culture et de la curiosité intellectuelles, ainsi que de la volonté de mise à jour, des trois auteurs.
Le livre est découpé en 3 parties subdivisées chacune en 4 chapitres. Chaque partie est introduite par un court texte qui en fixe les attentes scientifiques, méthodologiques et historiographiques, tout en essayant d’être le plus accessible possible aux non initiés. L’ensemble se veut chronologique sans être téléologique.
La conquête du pouvoir
Le premier chapitre « Une vision du monde à l’histoire longue » est clairement une synthèse des travaux de Johann Chapoutot, présentés notamment dans La Révolution culturelle nazie ou Nazisme et Antiquité. Elle montre comment les Nazis ne sont, au final, que les récupérateurs d’idées, de logorrhées qui pré-existaient à leur arrivée au pouvoir. Ils ont utilisé des éléments (scientisme, darwinisme, crânologie, antisémitisme…) pour les coller à leur discours racial et biologique. Traumatisés par la défaite de 1918, le traité de Versailles, la perte de territoires et les pertes démographiques, les Nazis font de la « race » et de la guerre des « races » le moteur de leur projet politico-culturel.
Le deuxième chapitre s’attarde sur la période « De la Grande Guerre à la défaite ». A l’intérieur, il est contextualisé la création du NSDAP et l’irruption progressive d’Hitler dans cet univers. Les auteurs veulent montrer que la Grande Guerre a une influence sur la médiatisation du national-socialisme, sans être le vecteur exclusif ni de sa prospérité, ni de son arrivée au pouvoir. La guerre de 1914-18 semble agir comme une expérience de la brutalisation, telle que l’entend George Mossé, mais dans un sens large. A la fois, comme expérience de la mort et du combat, mais aussi comme expérience de solidarité. La très grande partie des dignitaires du futur NSDAP partagent ce vécu. Tout comme l’antisémitisme qui vaut aux Allemands de confession juive d’être accusés, pendant la guerre, d’être des planqués. Beaucoup des futurs cadres du régime partagent aussi la violence de l’après-guerre, notamment dans la participation aux corps francs qui déstabilisent la jeune République de Weimar, au même titre que certains révolutionnaires communistes, qu’ils affrontent dans des combats de rue.
Le chapitre 3 évoque « Un parti politique sans importance » de « 1920 » à « 1928 ». Le DAP qui devient rapidement le NSDAP a du mal à se faire un nom au niveau national. Dans une Bavière effervescente, le parti est d’abord traversé par les querelles d’ego, la recherche d’un leader et l’absence de stratégie claire. Cela aboutit notamment à au putsch raté de 1923 à Munich et à la rédaction de Mein Kampf, dont de nombreuses pages sont consacrées par Hitler à d’abord régler ses comptes avec les autres membres de la sphère « völkisch ».
Cette période est marquée par la répression de l’Etat, ce qui crée toujours plus de solidarité entre les membres. Elle est aussi marquée par l’omniprésence de la violence: dans les discours, dans le militantisme de rue, dans les logorrhées du Bundestag, dans les campagnes d’intimidation d’hommes politiques. Le parti renforce ses positions misogynes et antisémites, révolutionnaires, au sens copernicien du terme, c’est-à-dire conservatrices. Il décide, après Münich, d’emprunter « une voie légale » qui mène aux élections de 1928 et aux 2,6% de voix.
Se pose déjà la question de l’origine sociale des électeurs: le parti se veut transcendant. On y trouve des ouvriers, des paysans, des artisans, des membres de la classe moyenne et de la bourgeoisie, des anciens soldats. Comme sur beaucoup d’autres aspects, le NSDAP montre que son « socialisme » ne correspond à pas grand chose sociologiquement et idéologiquement. Et surtout pas à un vote ouvrier quasi monopolisé par d’autres partis comme le KPD et le SPD.
Le dernier chapitre de cette partie parle de la période 1928-1933. Les auteurs y traitent « La fin de la démocratie et le basculement dans la dictature ». C’est clairement le chapitre le plus dense de cette première partie. La chronologie y est particulièrement précise et détaillée, pour suivre, étape par étape, le cheminement vers un pouvoir absolu.
L’idée est ici de relativiser, sans le nier toutefois, l’impact de la crise de 1929 en montrant une République déjà minée par les difficultés avant 1929 : conséquences financières du traité de Versailles au moment où se renégocient les traités, violences et intimidations toujours plus fortes de la part des partis extrêmes, déception vis-à-vis des politiques mises en place par le SPD. 1929 ne fait que renforcer et accentuer tout cela, en particulier en raison des échecs multiples des politiques de relance.
Dans ce contexte, le parti nazi progresse électoralement en élargissant son discours. L’antisémitisme n’est pas laissé de côté, tout comme l’exaltation du nationalisme. L’anti-Weimar, la lutte contre les menaces étrangères et la volonté de célébrer « une communauté du peuple » désormais appellée « communauté de combat » sont de nouveaux axes qui trouvent leur public.
Goebbels excelle alors dans la propagande en utilisant des moyens plus modernes, comme la radio. Cela touche bien sûr les jeunes, base originelle du parti, ceux qui ont connu la guerre et la défaite en naissant dans les années 1890, mais aussi ceux nés juste avant ou pendant la guerre, marqués par la défaite, la chute du IIe Reich, l’hyperinflation.. Mais la base électorale s’élargit toujours plus vers les classes moyennes et une partie de la bourgeoisie, sensibles à la crise économique, au souvenir du début des années 20 et effrayées par le chiffon rouge communiste.
Cette partie permet aussi de battre en brèche deux autres grands clichés : non, la majorité des Allemands n’a jamais voté pour le NSDAP. 37% des voix en juillet 32 ne fait pas une majorité. Non, l’arrivée au pouvoir n’est pas légale compte tenu des agissements des SA et des SS, des combats de rues (plusieurs centaines de morts), des pressions sur le personnel politique (notamment en province) de Weimar et des tractations politiques en coulisse au moment de nommer un chancelier en janvier 33. L’arrivée au pouvoir des Nazis doit beaucoup au rôle des élites de Weimar, élites conservatrices, partiellement convaincues par le discours nazi, totalement convaincues sur leur capacité à manipuler Adolf Hitler et le fait de rester au pouvoir confortablement.
Pourtant, fin 32, l’arrivée au pouvoir d’Hitler se semble pas encore inéluctable. Le NSDAP vient de perdre 2 millions d’électeurs par rapport à juillet. Des tensions se font jour entre Hitler et le chef des SA, Ernst Röhm. Des militants doutent de la capacité du chef à arriver au bout du projet de s’emparer du pouvoir. Certes, les Nazis ont su conquérir, depuis 1930, certains Ländern, ou obtenir dans certains des postes importants. Mais les vieilles élites pensent encore pouvoir manœuvrer avec la tambouille politicienne habituelle. Hitler parvient à la fois à se rendre indispensable, convaincant et menaçant. Néanmoins, malgré le discours officiel nazi sur la « prise du pouvoir », c’est bien Hindenburg qui nomme Hitler chancelier fin janvier 33.
Au sein d’un gouvernement de coalition qui va devoir préparer de nouvelles législatives pour mars, les Nazis ont des postes clés, comme celui du ministère de l’intérieur, qui va, dès lors, légitimer tous les moyens de violence contre les opposants. L’incendie du Reichsatg, que les auteurs attribuent grâce aux sources à un commando de SA, accélère la négation de la démocratie et du pluralisme politique. Un lieu incarne ce basculement: l’ouverture du camp de concentration de Dachau. Malgré cela, en mars 33, le NSDAP n’obtient « que » 43% des voix. Pas de majorité encore une fois, ce qui est un échec flagrant, compte tenu des nouveaux moyens de répression à disposition. La solution trouvée: gouverner par décrets-lois, ce que permet la loi d’habilitation de mars 33. L’Allemagne n’est plus une démocratie.
Anatomie d’une dictature
« La « mise au pas » et l’émergence de l’État nazi » sont au menu du 5e chapitre qui s’étend de 1934 à 1939. Entre 33 et 39, les Nazis détruisent un monde qu’ils rejettent: fin du multipartisme, des syndicats, du droit de grève, purge de la fonction publique. Le Droit est désormais la volonté du Führer et toute contestation est sévèrement punie, comme en témoigne la Nuit des longs couteaux. L’Etat nazi est original dans le sens où l’ambition finale est de voir cet Etat disparaître, au profit d’un conglomérat d’agences concurrentes les unes envers les autres. Dans un gloubi-goulba difficile à identifier, une grande part de liberté est laissée à chacun, dans cette volonté d’Hitler (qui cumule depuis 34 les fonctions de chancelier et président) de tirer le meilleur de chacun par la concurrence et l’émulation. Ce système polycratique est l’un des apports majeurs de l’historiographie récente, développée notamment par Johann Chapoutot dans Libres d’obéir.
Dans le même cadre temporel que le précédent, le 6e chapitre évoque « Terreur et Résistances ». Un des apports de l’historiographie récente est de montrer à quel point le régime nazi est ambivalent. Les auteurs de le démontrer en expliquant que la terreur touchait, cela semble évident, les ennemis du régime: asociaux, opposants politiques, juifs allemands, persécutés et humiliés publiquement et dans leurs espaces privés et intimes. Mais les Nazis savent aussi se montrer généreux avec ceux qui rentrent dans leurs normes, « créant même une dictature au service du peuple et de son bien-être » (p.223) selon les mots de l’historien Götz Ali.
Les auteurs profitent de ce chapitre pour battre en brèche, à nouveau, les comparaisons entre systèmes de terreur nazi et stalinien. Notamment dans les chiffres des victimes et dans cette volonté d’aller-retour des prisonniers chez les Nazis afin de répandre au sein des ennemis de la race cette peur incommensurable.
L’apartheid que subissent les juifs allemands augmente crescendo tout au long des années 30, dans un silence diplomatique assourdissant, de nombreux pays refusant d’accueillir ceux qui sont poussés à l’exil. De 1933 et de leur écartement de la fonction publique au pogrom de la Nuit de Cristal (qui s’étend sur plusieurs jours et nuits), les juifs allemands sont écartés, bafoués, spoliés dans leurs droits, leur intimité, leurs possessions, leurs amours désormais interdites.
Comment résister? Quelles résistances? Le livre développe les apports récents de l’historiographie. Au-delà des moments très connus (la Rose Blanche, l’attentat de 1944), elle montre à la fois une diversité des actions et de vraies résultats. Malgré une répression qui a décapité bon nombre de tentatives, une partie des Allemands a su dépasser les contraintes. Quelques exemples étayent cette démonstration: l’opposition à l’action T4, des manifestations de femmes pour récupérer leurs maris juifs, des caches de juifs ou de témoins de Jehovah… Quoique rares, ces multiples témoignages nuancent de manière convaincante les formulations hâtives du type « tous des Nazis ».
Le 7e chapitre embraye sur cette question de la « fabrique du consentement ». Ce chapitre 7 est en tout point remarquable et apporte une focale inédite et édifiante. Christian Ingrao y fait d’abord une mise au point très technique sur la catégorisation sociale de la population allemande, les évolutions historiographiques successives quant à cette question de l’identification et de l’attachement au national-socialisme. Cet attachement vient d’abord par le haut, par la politique de relance économique (qui doit amener ensuite vers l’autarcie) pour diminuer le chômage, par la construction (insuffisante) de logements, par la mobilisation culturelle (qui échoue au final à créer un véritable art nazi) qui définit et bannit l’art dégénéré, en même temps qu’elle monte au pinacle les artistes officiels.
L’attachement se fait aussi par la création d’une « société de la célébration, du faire et du geste nazis » (p.277). Les Nazis multiplient les commémorations, les rituels, les pratiques individuelles et collectives. A travers eux sont véhiculés le discours officiel, la vision de l’histoire, ce que doit être la Volkgemeinschaft. Et à l’intérieur, l’historien s’interroge sur l’Eigensinn, la capacité d’autonomie de chaque individu pour dresser le plus de nuances possibles et éclairer sur la composition de la société. Sujet d’autant plus délicat que cette société voulue par le pouvoir mêle habilement « charité, bienveillance, mobilisation constante et inculcation gestuelle » (p. 277) ainsi que surveillance permanente, créant ainsi une « dictature de la participation » (p.278).
Le chapitre 8 conclut cette deuxième partie. « La politique extérieure nazie 1933-1939 » sert de transition évidente vers la IIIe partie chronologiquement consacrée aux années de guerre. Mais elle n’est évidemment pas que cela. Cette politique s’appuie d’abord sur une dénonciation du traité de Versailles, également très critiqué par l’auteur du chapitre (Johann Chapoutot?) pour nombre de ses clauses « inutiles ». Dès son arrivée au pouvoir, Hitler confie à l’état-major sa volonté de remilitariser et ses ambitions impérialistes. Pour cela, il compte à la fois sur ses forces supposées (liées en partie à la grandeur de la race), les non-réactions des démocraties européennes (France et Grande-Bretagne) et le soutien de la population allemande et le succès quasi complet des Jeux olympiques de 1936.
Après des tergiversations stratégiques avec l’Italie mussolinienne, Hitler s’empare de l’Autriche entre 1934 et 1938, remilitarise et ‘envahit » la Rhénanie. L’invasion violente et persécutrice de l’Autriche déclenche alors une vague de migration juive à travers l’Europe et le monde, mais dont personne ne veut… L’absence de réaction laisse libre champ à la prise des Sudètes, validée par les gouvernements anglais et français à Münich en 1938. Elle laisse pantois Staline et aboutit, en partie, en 1939, à la signature du pacte germano-soviétique. Le succès du démembrement progressif de la Tchécoslovaquie fait tourner les têtes nazies vers la Pologne, territoire essentiel (et historique du point de vue nazi) du futur Lebensraum, peuplé de juifs et responsable de la perte d’une partie du territoire après la Première Guerre mondiale (Dantzig).
Une guerre génocide
Le chapitre 9 est sobrement intitulé « Combattre. 1939-1945. » Il replace le conflit dans la mémoire et le temps long, notamment l’omniprésence d’un esprit de revanche habitant les dirigeants du IIIe Reich, mais aussi les leçons à tirer du premier conflit mondial. L’invasion de la Pologne puis de la France sont très symboliques de cet état d’esprit. L’opération Barbarossa occupe une bonne partie de ce chapitre, l’assassinat massif de pans entiers de population étant pour la première fois un objectif clairement assumé par l’état-major nazi. Derrière l’anéantissement de l’ennemi géopolitique et idéologique soviétique, « La promesse de l’Est« , la création d’un Lebensraum vidé des ennemis de la race aryenne, la solution à toutes les angoisses pour le devenir de celle-ci. Et pour cela, libre court à une violence sans égale dans l’histoire de la Wehrmacht. Cette violence est au cœur d’une réflexion historiographique intense, mise à jour dans cet ouvrage.
Ce chapitre ouvre la voie aussi à une réflexion particulièrement intéressante. L’échec de l’offensive en Russie entraîne la conjonction de projets distincts au sein de l’élite dirigeante nazie: l’anéantissement racial, la « prédation humaine » c’est-à-dire l’utilisation des prisonniers étrangers, la survie alimentaire du Reich et le développement du programme d’armement. L’industrialisation et l’extrémisme de l’ensemble de ces stratégies entraînent la réaction des opposants et poussent, entre autre, Roosevelt à une inflexion de sa politique vis-à-vis de Staline, notamment dans le but d’éviter l’expansion germanique à l’Est et reprendre l’initiative des combats.
« L’Europe des abîmes » est le 10e chapitre. Les auteurs développent ici la polycratie nazie en étudiant l’ensemble du mille-feuille organisationnel nazi. « La diversité des institutions et des situations transforme cet empire nazi en une mosaïque de statuts et de contextes » que ce soir au niveau national, régional ou local. Cet ensemble, longtemps analysé comme pyramidal, est aujourd’hui vu comme un moteur d’ascension sociale (éphémère à l’aube des 12 ans du régime nazi) et d’autonomie relative pour chacun des acteurs. Ce mille-feuille est d’autant plus impressionnant qu’il se retrouve à la fois dans les institutions civiles et militaires. Plusieurs schémas et cartes, dans le chapitre et en annexes, viennent illustrer ce passage et éclaircissent notre compréhension d’une thématique très nébuleuse, ne serait-ce que pour l’appréhension de l’ensemble des acronymes liées à cette structure. La fin du chapitre essaie de faire une chronologie, peu évidente étant donné l’étendu du territoire soumis, de la mise en place, chaotique car l’administration est clairement en sous-effectif, du mille-feuille.
Une partie du chapitre est consacrée à l’expérience de la guerre au sein des populations européennes dominées et allemandes. Entre propagande, manipulation et réelles oppositions, ces dernières sont soumises à l’héroïsation des combats, la volonté étatique de ne pas faire étalage de la réalité de la guerre (notamment au niveau des restrictions alimentaires), mais aussi la forte présence étrangère, en opposition avec le discours officiel de pureté de la race. Cela vaut d’ailleurs à certaines femmes allemandes des humiliations publiques lorsqu’elles sont soupçonnées d’avoir eu des relations sexuelles non-autorisées. Si les auteurs soulignent la grande diversité des modalités d’occupation en Europe, ils distinguent des points communs et pratiques que partagent les populations soumises: la faim, les violences, la collaboration et les résistances. L’une des grandes richesses de ce livre est très présente dans ce chapitre: la multiplication des terrains d’observation, des échelles et des personnages analysés.
Le 11e chapitre est appelé « Détruire ». Deux citations du livre peuvent éclairer les apports, enjeux et difficultés d’un tel chapitre: « Quand on sait qu’il existait, dans l’Europe de Hitler, 44 000 sites de détention et de persécution, répertoriés par l’immense programme de L’Encyclopédie des camps et des ghettos du Centre de recherche du musée mémorial de l’Holocauste de Washington, on mesure la difficulté à produire un récit, ne serait-ce que lisible sur la question. » ; « La revalorisation de l’importance des populations locales dans la Solution Finale donne aujourd’hui une toute autre image du génocide, qui ne fut pas une mécanique de précision bien coordonnée depuis Berlin. La Shoah n’aurait jamais été possible dans toute son ampleur, sans l’adhésion et la participation active des institutions et des populations européennes, à l’Ouest comme à l’Est. » Des centaines de milliers de documents, des années de recherches d’historiens, de multiples supports de témoignages… difficile d’en faire un récit synthétique satisfaisant. Un des atouts du livre est de faire le lien, avec nuance toujours, entre destruction et germanisation des territoires de l’Est de l’Europe: les deux projets ne sont pas hiérarchisés et sont intimement consanguins, terme qui trouve toute sa place dans la logique culturelle derrière les atrocités subies par ceux définis comme ennemis de la race.
Ce livre se voulant un manuel destiné au plus grand nombre et les enseignants étant particulièrement cibles et demandeurs d’un tel ouvrage, ce chapitre permet une remise à jour nécessaire, à la fois sur le vocabulaire, les étapes du processus de mise à mort et les sources. Parmi ceux-ci: les Pogroms de Novembre et non la Nuit de Cristal ; ne pas faire de Mein Kampf un plan pré-établi de la mise à mort des juifs; le tournant crucial de 1938-1939 où les Nazis passent de la politique d’expulsion à celle d’une mise à mort systématique puis industrielle en 1941… La liste des apports est longue et nécessaire pour chacun de ceux qui doivent enseigner en secondaire et qui, malheureusement, ont souvent à faire à des manuels scolaires dépassés à plus d’un titre. Les sources présentes dans ce chapitre sont autant de documents réutilisables et appuis irréfutables de la réalité de ces drames, le négationnisme étant désormais réellement ancré dans beaucoup de milieux. Les politiques de destruction visent aussi d’autres populations : handicapés, Tziganes, Slaves, résistants. Les auteurs le rappellent: les évoquer, ce n’est pas négliger ni relativiser la Shoah, c’est intégrer ces assassinats dans la large politique hygiéniste nazie.
Le dernier chapitre est consacré à « L’effondrement 1944-1945 ». Ce chapitre évoque des événements qui ont secoué l’historiographie et déposé le cénacle intellectuel de ce milieu. Tout d’abord, la question de la réalité des connaissances des Allemands sur ce qui se passait à l’Est, sur l’arrivée des troupes alliées et particulièrement les soviétiques. Ensuite, les difficultés du ravitaillement quotidien montrent que le pays est bien en guerre: chaque famille allemande connait les restrictions.
Que ce soit chez les civils tout comme chez les élites dirigeantes (Hitler, Goebbels), la vague de suicides du printemps 1945 témoigne des angoisses qui traversaient le pays: refus de l’échec, peur du lendemain et de l’inconnu, peur du soldat soviétique, peur de la justice des futurs vainqueurs. Ce phénomène est peu connu encore aujourd’hui du grand public, mais il marque particulièrement les Soviétiques à leur entrée dans certaines villes allemandes.
La problématique des procès, particulièrement ceux de Nüremberg, permet aussi d’évoquer la mise en place des réseaux de fuite des dignitaires nazis. Notamment, à travers le rôle de la CIA et du Vatican dans ce processus. L’Allemagne rentre alors dans des sujets délicats: celui de la mémoire, celui de la responsabilité à assumer, celui de la nature des sanctions.
La conclusion, écrite par Johann Chapoutot, est de celle qui suscite la réaction, la réflexion et peut-être, chez certains, l’incompréhension voire le rejet. En tout cas, elle ne peut laisser indifférent. Les trois historiens ne cachent pas leur opinion politique, mais surtout la présence de l’historien dans les débats sociaux actuels. Christian Ingrao, ancien directeur de l’IHTP, Johann Chapoutot, très présent dans les médias de gauche, à l’instar de Nicolas Patin, ancrent leur réflexion dans ce qui fait notre quotidien.
Johann Chapoutot démarre par résumer brillamment tous les fils conducteurs des analyses qui ont parsemé ce livre. Il en apporte de la cohérence et de l’envergure intellectuelles. A travers ces quelques pages, le lecteur est réellement édifié par le projet nazi, sa nature, ses conséquences, ce qui a été construit puis détruit en 12 ans.
Il arrive à un constat évident: 1945 ne signifie en rien la fin du nazisme. Tout d’abord, parce que la dénazification a été limitée et parce que des Nazis ont continué à opérer après la guerre, particulièrement en Amérique du Sud. Ensuite, et ce passage va forcément faire parler, en dressant un parallèle entre les politiques de ségrégations et les politiques coloniales occidentales et plusieurs éléments mis en place durant l’ère nazie. La culture nazie est aussi replacée dans le foisonnement intellectuel occidental de la fin du XIXe et XXe siècle. Concentrer le mal sur le nazisme serait ainsi un moyen efficace et volontaire de ne pas voir dans d’autres politiques menées par les pays démocratiques les points communs. 1945 serait alors la destruction du mal et rien ne saurait s’y comparer.
L’historien termine sur l’objectif fondamental du livre : la compréhension profonde du nazisme. Non pas dans une vision trop angélique du « plus jamais ça ». Mais plutôt dans une appréhension de la réalité de ce que fut cette culture pour éviter les a-propos, les raccourcis et, forcément, les erreurs d’interprétation.
Bilan final
Au terme de cette longue analyse/critique/fiche de lecture de cet ouvrage, il apparat très clairement que c’est un livre que chacun doit avoir lu un jour. Les trois auteurs ont créé un objet qui n’existait pas, qui est utile à tout à chacun, qui nécessite une lecture attentive. Le livre est d’abord fascinant par la qualité d’écriture, la qualité des réflexions, cette volonté de mettre à jour et de donner de la cohérence à un univers si vaste. La somme des connaissances, des exemples, des personnages évoqués, des événements est tout simplement impressionnante. Elle montre le vertige de la tâche qui se présente aux historiens lorsqu’ils travaillent ce sujet.
Dans un contexte actuel de vitesse, de traitement toujours plus rapide des informations, d’absence de nuance et de baisse du niveau global de l’école, ce livre prend le pari et le parti de faire une analyse détaillée, précise, sourcée, nuancée du nazisme. Il n’édulcore rien de ce qui en fait la nature, il en évoque l’organisation, les objectifs, les conséquences, les complicités et les résistances.
Le professeur d’Histoire sort de cette lecture avec appréhension. La mise à jour est à la fois jouissive intellectuellement et brutale. L’immersion dans cet univers ne peut que susciter l’émotion. Mais elle ramène aussi à ce qui est transmis à nos élèves. Certaines corrections semblent faciles à faire, notamment pour les notions, dates et structures du régime.
Cependant, devant cet océan de connaissances, de réalités du quotidien, de souffrances, mais aussi d’organisation, comment arriver à faire tenir cela dans des programmes qui demandent de traiter ces sujets en une poignée d’heures, la plupart du temps dans une comparaison avec le fascisme italien et le stalinisme qui ne sont que peu comparables au final?
Dans une conférence, Johann Chapoutot regrettait que lui et ses confrères ne soient jamais sollicités par le ministère dans le cadre de la rédaction des programmes et que les manuels soient très en décalage avec la réalité des recherches universitaires, notamment pour des intérêts économiques. A la lecture de cet ouvrage, évoquer un thème intitulé ‘Les régimes totalitaires » dans une démarche comparative dépassée intellectuellement, où la notion même de totalitarisme est remise en cause, semble illusoire. Car elle ne permet en rien de traiter en profondeur chacun de ces systèmes politiques. Christian Ingrao et Nicolas Patin vont dans ce sens dans une interview plus récente. Mais, pour le moment, cela semble compliqué à appliquer dans la réalité des cours. A voir avec les futurs programmes…