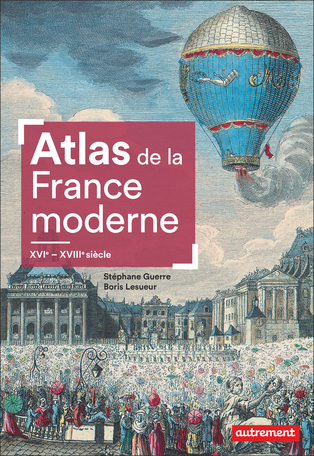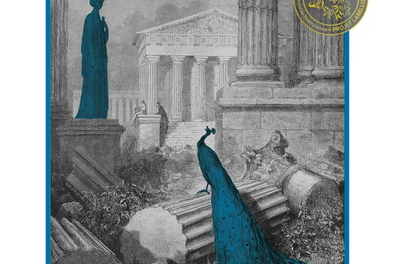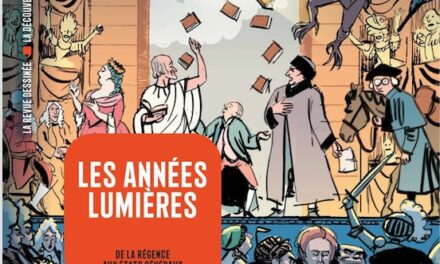Le parti pris de cet atlas de la célèbre collection de chez Autrement est d’insister sur les transformations à l’oeuvre durant une période qui est tout, sauf immobile. Entre le XVIe et le XVIII e siècle, quelle part faire aux permanences et aux mutations ?
Permanences et mutations
Les structures sociales peuvent donner l’impression d’une profonde stabilité. Des forces de changement existent cependant, conduisant à penser que cette stabilité n’est qu’une apparence. Il faut aussi considérer l’ouverture du royaume sur l’Europe et le monde et cartographier une histoire mondiale de la France.
Les évolutions politiques : XVI-XVIIIe siècle
Le concept d’Etat dans un sens proche du nôtre se généralise en France au XVIe siècle. Une dynamique est enclenchée. Les auteurs s’intéressent d’abord aux pouvoirs de François Ier. En réalité, les pouvoirs du roi sont limités dans un royaume qui s’auto-administre en partie. Le premier moyen pour François Ier de régner est de se montrer. Il a séjourné dans 728 lieux différents mais certaines provinces ne furent jamais visitées. Les guerres de religion marquèrent aussi le territoire et la question a été renouvelée par les travaux de Jérémie Foa. L’Edit de Nantes est le fruit de deux ans de négociation entre catholiques et protestants. L’édit impose la paix civile et refonde l’unité politique du royaume derrière le roi en sacrifiant son unité religieuse. Richelieu, contrairement aux favoris des Valois au XVIe siècle, n’est pas le représentant d’une faction aristocratique mais bien l’homme du roi. L’un des moteurs de l’émergence de cette monarchie administrative est la collecte des impôts pour financer la guerre.
La société d’Ancien Régime
La France est un géant démographique à l’échelle de l’Europe et elle est deux à trois fois plus peuplée que n’importe quel autre Etat en 1700. 1709 est une année de crise où 600 000 personnes sont mortes. La plupart des déplacements relevaient de la micromobilité et se réduisaient à un cercle de 10 à 20 kilomètres autour du village. Il y a aussi des départs vers le Canada. On peut noter la permanence du monde des campagnes. De 60 à 80 000 seigneuries existent, souvent morcelées, elles ne correspondent pas toujours aux paroisses. Il y eut des tentatives répétées d’imposer la libre circulation des grains ce qui montre que l’Etat royal est sensible aux nouvelles idées physiocratiques. La culture du maïs s’étend avec des rendements élevés. Cependant, des régions entières restent à l’écart de toute évolution. Les villes sont minoritaires mais structurent le territoire. Il y a également une France proto-industrielle. On assiste aussi à la transformation de la consommation. Le tabac devient un produit de consommation populaire. La mise en place d’un Etat militaro-fiscal s’accompagne de châtiments exemplaires.
Société et culture
On note une curiosité pour « les novelletés ». Instruction et alphabétisation franchissent des étapes décisives. L’alliance du trône et de l’autel est un des fondements de l’Etat monarchique, les paroisses assurant le maillage du territoire. Il faut se méfier de visions datées comme celle du « beau XVIe siècle ». En effet, cette expression ne tient compte ni des spécificités ni des traditions toujours bien vivantes et encore moins du climat d’inquiétude religieuse. Il y a un risque d’anachronisme à ne retenir que certaines publications élitistes. Plusieurs pages évoquent la France des Lumières, la diffusion de l’information et dessinent, in fine, une géographie culturelle du pays à la fin de l’Ancien-Régime.
La France en Europe et dans le monde
En Europe, la guerre construit le territoire. C’est l’époque également de la constitution d’un premier empire colonial à la fois territorial et commercial. Les frontières du territoire sont longtemps de simples marches militaires. Ni la langue, ni l’histoire, ni le peuplement ou la géographie n’imposent une limité claire et reconnue. La guerre le fera. On a souvent tendance à exagérer la domination culturelle de Louis XIV. L’Angleterre est un autre modèle. Par ailleurs, la guerre de Sept ans est vue aujourd’hui comme la première Guerre mondiale. La France est en tout cas ouverte sur le monde.
En conclusion, les auteurs reviennent sur des propos de Tocqueville. Si la révolution est rupture dans les esprits, elle se révèle souvent continuité dans les pratiques. Si notre modernité s’est construite en partie contre l’Ancien-Régime, elle ne doit pas pour autant masquer les processus de longue durée à l’oeuvre : les métropoles actuelles, par exemple, sont les héritières des grandes villes des provinces, souvent sièges d’un parlement.