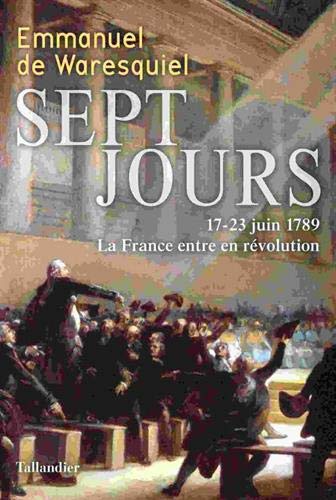Comment débute une révolution ? C’est la question qui fascine tout historien du politique et en particulier celui de la Révolution française.
Par le renversement d’une monarchie et d’une société pluriséculaire, la Révolution française étonne autant qu’elle inquiète et fascine. On a longtemps cherché les clés de cette mécanique révolutionnaire dans des origines plus ou moins lointaines puis dans des causes implacables. Il n’en est rien, le phénomène révolutionnaire garde ses mystères et reste imprévisible. C’est ce qui en fait sa portée.
Depuis vingt ans maintenant, quelques historiens anglo-saxons puis français ont emprunté d’autres chemins pour percer au jour la mécanique de la Révolution française. Ils ont plutôt cherché dans l’instant, au jour le jour, l’émergence de la rupture.
Un des premiers à renouveler l’approche de la Révolution en traquant cet instant de basculement fut sans doute Timothy Tackett, auteur d’un des ouvrages les plus pertinents sur la période depuis trente ans, Par la volonté du peuple en 1997. En s’intéressant en premier lieu aux acteurs, les députés du tiers état, et à leur psychologie, il jette un regard nouveau sur la temporalité de la Révolution ainsi que sa nature et sa mécanique. D’autres après lui se sont ensuite penchés sur la genèse de la Terreur.
Ici, c’est au tour d’Emmanuel de Waresquiel, historien du XIXème reconnu pour ses biographies de Fouché et Talleyrand, de s’intéresser à la mécanique du processus révolutionnaire. Pour ce faire, il a décidé d’abandonner la sphère des idées et des interprétations qui a tant éloigné les historiens de la Révolution de son réel matériau[1], les évènements et les acteurs. C’est sans surprise que de Waresquiel porte son regard sur les journées des 17 au 23 juin 1789, jours décisifs qui marquent la rupture et la quasi-impossibilité de retour en arrière. A l’aide d’archives inédites selon l’auteur, il part à la recherche de ces instants de basculement où la rupture avec l’Ancien régime est consommée.
« Les Français jetés dans le vide », l’impréparation des Etats-généraux par la monarchie
Si certains se lanceront dans une recherche vaine des origines de la révolution en remontant au commerce atlantique ou à la gouvernance louis-quatorzienne, de Waresquiel reste en grande partie dans le temps court. Selon lui, c’est la monarchie qui a permit la révolution du tiers état en prenant ici par la convocation des Etats-généraux, une prise de risque inouïe dont ont conscience certains contemporains.
Au-delà de la personne du roi sur laquelle revient l’auteur dans plusieurs chapitres, c’est l’impréparation globale de l’administration royale et la volonté de ne pas contrôler les élections qui créent un immense « appel d’air[2] ». Le symbole de cette impréparation voire naïveté est l’incapacité à contrôler la presse durant les élections.
Mais cette impréparation n’est que le reflet d’une monarchie affaiblie en 1789 par de multiples fragilités selon de Waresquiel. Ainsi,
Impréparation de la monarchie n’est pas pour autant synonyme d’impréparation de tous les acteurs. Comme l’a souligné Tackett avant de Waresquiel, les députés du Tiers sont les enfants d’un monde dans lequel l’enrichissement et l’idée de droit naturel le disputent à la naissance.
De janvier à mai 1789, on assiste alors en France à la rencontre d’une attente de plus en plus répandue dans la société et de ces élections improbables qui en permettent l’expression. A cela s’ajoute une monarchie fébrile constituant selon l’auteur le cocktail détonnant de ces journées de juin.
Le glissement révolutionnaire, d’une révolution littéraire à une révolution politique
C’est donc portés par l’enthousiasme et l’attente suscités par ces élections associées à la légitimé qu’elles leur apportent que les députés du tiers arrivent à Versailles au début du mois de mai 1789.
Mais très vite l’absence de directives comme de consignes de vote de la part de la monarchie crée une situation de flottement et d’inaction propice à la prise d’initiative (et de risque) de quelques députés du tiers.
« On ne naît pas révolutionnaire, on le devient » affirme l’auteur, reprenant ici la ligne directrice suivie par Tackett. Selon de Waresquiel, ce glissement presque imperceptible s’opère d’abord par les mots avant de passer ensuite par les actes. « Les députés se sont saisit des choses par les mots[3] ». Pour de Waresquiel, toute la révolution est là, dans le pouvoir incantatoire des mots : on se présente comme « députés des communes », à l’anglaise, puis « députés de la nation ». Par les mots, les députés se saisissent de l’insaisissable, le peuple, la volonté générale. Par ces mots, la Révolution est faite, la souveraineté est prise au roi et les structures sociales sont renversées au nom des principes de liberté, d’égalité et d’unité[4].
Cette révolution littéraire se nourrit avant tout de la culture juridique de la plupart des députés du tiers puis des premiers débats au sein de l’assemblée auxquels ils sont désormais habitués depuis le mois de janvier. Le phénomène de radicalisation naît, selon l’auteur, de l’action concertée de quelques uns essayant d’entraîner les autres vers l’action, à l’image du Club breton véritable groupe de pression, et de l’intransigeance de la noblesse à refuser de se réunir au tiers pour la vérification des pouvoirs.
Les députés ont clairement conscience de leurs mots et de leurs actions. Mais c’est dans ce mélange d’audace et de peur que s’invente une nouvelle sacralité concurrençant celle de la monarchie : une sacralité fondée sur la mystique de l’unité, celle dont germe déjà la violence consubstantielle à toute révolution fruit de l’intransigeance vis-à-vis de toute opposition.
C’est ainsi que le 17 juin, les députés du tiers font serment d’être fidèles à l’Assemblée et par extension, à la nation. La révolution est faite, au moins dans les mots et la symbolique.
L’énigme Louis XVI, un roi écartelé entre la tradition et les idées nouvelles
Aux côtés des députés, ces journées de juin n’auraient jamais été celles qu’elles ont été sans les choix et atermoiements du roi Louis XVI.
Dans plusieurs chapitres, de Waresquiel tente de passer outre la légende noire du roi construite de son vivant pour percer au jour la mécanique psychologique et politique de Louis XVI, pièce-maîtresse de ces journées de juin. Il n’en ressort pas vraiment de nouveautés ici mais une analyse fine de l’état d’esprit d’un roi à la croisée des chemins, victime de son époque secouée par de profonds bouleversements. De Waresquiel dresse un portrait tout en contradictions, humain en somme : un roi renfermé peu à l’aise en société mais un roi curieux et studieux ayant le goût des sciences exactes et façonnant un caractère mesuré et prudent.
L’explication de l’auteur est toute là : Louis XVI n’avait pas les qualités requises pour son époque. Les journées de juin ne sont pas des moments propices à la réflexion et à la prudence. Les temps de crise nécessitent au contraire un sens aigu des évènements, du rythme et de l’action.
Le roi a illustré mieux que personne les contradictions de son époque : l’émergence des idées nouvelles de libertés en même temps que le maintient de structures socio-politiques inadaptées. Le jeune roi a porté au début de son règne les idées nouvelles par des réformes libérales ambitieuses sur le commerce et les impôts au travers de son ministre Turgot. Mais il n’a pas perçu, voulu ou pu percevoir l’incompatibilité qu’elles portaient en elles avec la société d’ordres et la monarchie absolue.
Hostile aux Etats-généraux car ne veut partager, de par son éducation, son autorité, le roi cède néanmoins en août 1788. Cette décision cruciale pour la suite, de Waresquiel l’explique par une conjonction de facteurs tels le découragement du roi devant l’opposition de la noblesse à ses réformes, son épuisement et peut-être une forme de dépression[5] liée à la mort du Dauphin.
Le roi n’aime pas Necker mais il cède à l’opinion et le rappelle pour rétablir la confiance des milieux financiers.
Quant à la reine, de Waresquiel balaie toutes les rumeurs concernant son ascendant sur le roi même si elle a été admise à certains Conseils depuis 1788[6], sa correspondance témoigne du contraire. Et si elle n’est peut-être pas en capacité de comprendre les ressorts profonds des évènements qui se jouent sous ses yeux, elle restera fidèle au roi même si elle déplore sa lenteur dans les prises de décision[7].
Les illusions de M. Necker
Après le roi, de Warequiel s’attache ensuite à dépeindre l’atmosphère qui règne au gouvernement et à la Cour et tente d’y démêler les luttes d’influence entre un Necker ambitieux et sûr de lui et un comte d’Artois conspirateur qui le déteste.
De Waresquiel nous peint un portrait peu flatteur de Necker, ambitieux et jaloux de sa popularité, sûr de pouvoir gouverner et réformer la France[8]. Le plan élaboré par Necker en 1788 est de faire confiance aux états généraux pour résoudre la crise, convaincus qu’il pourra les diriger à sa guise[9]. Trop sûr de ses capacités, Necker n’a pas vu le piège pourtant mentionné peu de temps avant dans un rapport de Malesherbes qui prédisait une bataille entre les trois ordres[10] et préconisait une assemblée unique élue sur la base de la propriété et non des ordres. Necker ne veut pas aller aussi loin et rester dans le cadre de la structure par ordres des états-généraux. Il pousse le roi à doubler le nombre de députés du tiers.
Le plan de Necker est de faire céder au roi une part de sa souveraineté législative en déléguant aux états-généraux le droit de lever les impôts. Il souhaite ensuite pérenniser ce système par la création de deux chambres, une haute (noblesse et clergé) et une basse (tiers état), dans un bicaméralisme à l’anglaise qui conserverait la structure par ordre. Et c’est ici que Necker s’est bercé d’illusions et n’a pas pris la mesure de ce qui était devenu la source des tensions et frustrations de la société française en cette fin de siècle, les ordres.
Deuxième illusion et non la moindre, Necker pense pouvoir naïvement manipuler les députés du tiers[11] et ne ménage pas ses efforts pour les séduire en tenant table ouvert à l’hôtel du Contrôle général. Mais il n’a pas perçu et compris les intentions du tiers qui l’a pris de vitesse en se déclarant représentant du peuple le 17 juin.
Dès lors Necker est pris en étau entre d’un côté le tiers dont il a perdu la confiance et la Cour qui l’accuse de complicité avec celui-ci.
Le 20 juin, un serment contre le roi
L’audace du 20 juin ne tient pas qu’à une salle opportunément et maladroitement fermée par la monarchie en vue de préparer une séance royale le 22 juin. Elle s’inscrit dans un processus durant lesquels les députés prennent confiance en eux tout en se sachant menacés. Ici, le ralliement progressif de quelques curés à partir du 12 juin joue un rôle décisif.
C’est donc dans un climat mêlé de peur et d’exaltation voire de tumulte, c’est la motion de l’avocat Target, par acclamation, qui est retenue. Elle prévoit la rédaction d’une constitution et le maintien des « vrais principes de la monarchie[12] », texte vague mais dont Talleyrand a tout de suite saisit la portée : l’Assemblée s’est investie elle-même du droit de « détruire tout ce qui existe et d’y substituer tout ce qui lui plaira[13] ».
Le serment a été largement mythifié à l’image du tableau de David et l’évènement en tant que tel n’a pas eu la portée de celui du 17 juin comme en témoignent les correspondances des députés qui n’en font guère état sur le moment.
Certains comme Mirabeau, Malouet ou le « dissident » Martin-Dauch ont eu conscience de l’importance de l’évènement.
Et en effet, de Waresquiel comme Mona Ozouf avant lui, reconnaît que ce serment est avant tout mu par la peur. Peur d’eux-mêmes[14] mais surtout peur du roi. C’est véritablement ce 20 juin que la confiance entre le roi et la nation se rompt : les députés décident alors de réorganiser la nation, sans le roi, sur le nouveau principe de souveraineté incarné par l’Assemblée.
La monarchie entre indécisions et divisions
En ce 20 juin, le roi chasse à Marly et Necker est à Paris. Séparation géographique, séparation symbolique. Prévenu, Necker rassure Bailly sur les intentions du roi de ne pas dissoudre les états-généraux et dans le même temps intime au roi de déprogrammer la séance royale du 22 juin et lui fait porter des projets de discours.
A Marly, on tient un Conseil du roi sans Necker, et à l’unanimité on dénonce la séance du 20 juin. Mais le roi ne prend aucune décision[15].
De retour à Versailles, le roi consulte une députation de la noblesse[16] sur laquelle il décide de s’appuyer alors même que c’est elle qui l’a poussé à réunir les états-généraux. Mais Louis XVI a compris que le tiers tente de s’interposer entre lui et son peuple et qu’il doit réagir.
Un nouveau Conseil est ensuite réuni et pour la première fois les frères Artois et Provence sont présents. Le projet de discours de Necker est critiqué, le roi se refuse à imposer à la noblesse la perte de ses privilèges en matière fiscale et d’emplois militaires[17]. Le conseil s’éternise, on ne tranche pas et on le reporte au 22 juin, décalant la séance royale au 23. L’indécision du roi à trancher s’explique selon de Waresquiel par la réticence de Louis XVI à user de la force et de la contrainte pour réaffirmer son autorité sur le tiers mais aussi sa peur obsédante de la banqueroute qui l’oblige à ne pas désavouer totalement Necker. La division de son Conseil n’arrange rien, Louis XVI n’aime pas les avis contradictoires qui le paralyse dans sa prise de décison[18]
Cette indécision politique ne convient guère aux crises comme le fait remarquer l’auteur et laisse du temps au tiers pour s’organiser et se renforcer dans son action et sa légitimité[19].
De l’émeute populaire à l’insurrection, la mécanique révolutionnaire
Dans ce va-et-vient entre acteurs du 20 au 23 juin 1789, de Waresquiel s’attarde tout naturellement sur le peuple de Paris plus que sur celui des campagnes.
Dans quelques chapitres, l’auteur tente de traquer ce basculement de l’émeute populaire, presque banale sous l’Ancien Régime, à l’insurrection. Si, selon lui, ce passage conservera toujours une part de mystère[20] pour les historiens, il met en lumières quelques rouages qui s’auto-entraînent : La saturation de nouvelles provenant de Versailles suscitent une méfiance qui se généralise et se transforme petit à petit en peur mais aussi haine de tout ce qui ne ressemble pas au Tiers état. Cette insécurité grandissante nourrit l’idée d’un complot contre le peuple, surtout dans le contexte d’attente de la séance royale du 23 juin. Cette insécurité se transforme alors peu à peu en violence qui devient ici révolutionnaire car elle se politise en participant de la construction d’un nouvel ordre social esquissé quelques jours plus tôt à Versailles par le Tiers[21].
La violence est révolutionnaire car elle n’est plus simple réflexe d’auto-défense ou volonté de punir mais moyen d’exercer une souveraineté et un pouvoir nouveau révélé au peuple par l’action du tiers. Cette violence se nourrit de grandes idées et de grands projets mais aussi d’un riche imaginaire au centre duquel trône le complot qui masque à peine la nature intolérante de la Révolution. Chaque opposant arbore son complot : complot royaliste ou autrichien pour les révolutionnaires, complot franc-maçon ou philosophe ou protestants pour les opposants[22].
La séance royale du 23 juin, occasion manquée, affront et incompréhension
C’est dans ce climat de tensions que se déroule la séance royale et décisive du 23 juin. Même décorum qu’à l’ouverture du 5 mai mais certains signes montrent que les temps ont changé : le déploiement de forces aux abords des Menus-Plaisirs est impressionnant alors même que certains soldats sont peu sûrs, pas de cris « Vive le roi ! » au passage du cortège, on porte l’épée du côté de la noblesse et des pistolets pour certains membres du tiers…. Et surtout, Necker est absent…
Lors de cette séance royale, Louis XVI présente un véritable programme politique et ligne directrice dont il ne s’écartera pas jusqu’au 10 août 1792. S’il n’annonce pas une véritable monarchie constitutionnelle, les concessions, pour un roi absolu, sont colossales[23] : mise en place d’une représentation élue à laquelle il abandonne ses prérogatives fiscales, décentralisation avec des provinces recevant de larges compétences comme les hôpitaux, les forêts… Le roi se réserve néanmoins tout ce qui touche à l’ordre public. Il programme également un vaste train de réformes repris de Necker : égalité fiscale, réforme des anciens impôts, suppression des douanes intérieures, de l’octroi, des corvées, allègement des taxes indirectes, sans compter l’élargissement des libertés … Bref autant de demandes que l’on trouve dans les cahiers de doléances[24].
Cependant, politiquement novateur, Louis XVI se montre néanmoins socialement conservateur[25] et refuse l’égalité civile et l’accès de la bourgeoisie aux emplois militaires.
La décision de maintenir les ordres au sein des Etats-généraux efface toutes les velléités modernistes proposées par Louis XVI. Le drame ici qui se joue est que le roi n’a pas pris la mesure des changements opérés dans les mentalités lors de ces derniers jours depuis le 17 juin. Le roi n’a pas perçu le renversement politique colossal qui s’est alors opéré : la nation, incarnée par les députés, préexiste au souverain[26], la légitimité s’est peu à peu déplacée lors de ces journées.
Après le départ du roi et des ordres privilégiés se déroule la fameuse scène entre de Dreux-Brézé, grand maître des cérémonies, Bailly et Mirabeau. Ici histoire et mémoire se confondent pour réécrire les dialogues et les faits. Mais les premiers comptes-rendus n’évoquent point de « baïonnettes ». C’est donc Mirabeau lui-même qui réécrit ses propres paroles du 23 juin[27] dans son journal, le 26 juin[28].
L’essentiel est cependant ailleurs comme le rappelle de Waresquiel. Le refus du tiers de quitter la salle des Menus-Plaisirs finit de parachever le transfert de souveraineté du roi vers l’Assemblée et la nation qui s’est opéré depuis le 17 juin[29]. Ce sont donc les heures qui suivent cette scène qui scellent la Révolution : mus par la peur qui se transforme en colère, les députés décident de confirmer leurs arrêtés des jours précédents. De Waresquiel souligne ici dans ce basculement des députés le rôle de grands orateurs et meneurs au premier rang desquels Mirabeau et Barnave : l’Assemblée est souveraine et ne peut recevoir d’ordre ou de sanction du roi. Mais si elle se déclare souveraine, elle souhaite aussi se protéger d’éventuelles attaques du gouvernement en se déclarant inviolables sur proposition de Mirabeau.
Par cette proposition, l’Assemblée se place au même niveau que le roi, inviolable lui aussi de par le sacre le faisant l’oint de dieu. Découle de cette décision de lourdes conséquences : l’Assemblée devient donc source de la justice, c’est la naissance de l’immunité parlementaire et, selon la formule inventée par Mirabeau, du « crime de lèse-nation[30] ». Les députés sont protégés mais souhaitent aussi se défendre. On attribue alors à l’Assemblé le droit de réprimer tous ceux qui chercheront à la menacer. C’est cette logique qui conduit trois an s plus tard au procès de Louis XVI…
A la Cour, les apparences de la victoire
Dans le même temps, en cette après-midi du 23 juin, on se félicite au château de l’attitude du roi qui a enfin pris la mesure des évènements en faisant preuve de fermeté et en réaffirmant son rôle de chef de la nation. Mais dans les appartements du roi on est surpris puis furieux lorsqu’on apprend la réaction du tiers, « Eh bien, foutre, qu’ils restent ![31] » aurait réagit Louis XVI selon la formule restée célèbre. Le roi aurait même souhaité y retourner mais le temps de se préparer, le tiers avait quitté la salle.
A la surprise et à la colère succède ensuite l’inquiétude lorsque les esprits s’agitent à la rumeur de la démission de Necker et qu’on se rassemble dans les rues puis devant le château aux cris de « Rendez-nous M. Necker ! »[32]. Des députés du tiers se rendent même en cortège sous els fenêtres du domicile du ministre à Versailles.
Le roi a-t-il décidé à ce moment-là de se séparer de Necker qui a manifesté, par son absence, sa désapprobation ? On ne sait[33]. Le roi est vraisemblablement pris de court et souhaite avant tout assurer la protection de la Cour en détachant des frontières près de 15 000 fantassins et 3 600 cavaliers. Deux ans plus tard, Louis XVI regrettera de ne pas avoir rejoint Compiègne ou Metz…. Que serait-il passé, se demande de Waresquiel, si le roi n’avait pas attendu les régiments pour renvoyer Necker et imposer ses réformes ? Paris était calme les 23 et 24 juin[34] ? Mais Necker était un garant pour le Trésor vide et l’approvisionnement de Paris dont il s’occupait…
Ce n’est qu’avec les rumeurs de la venue de régiments étrangers que Paris s’agite, fin juin.
Le 23 juin vers 5 heures, le roi reçoit Necker avec la reine. Personne n’a rapporté ce qui s’est dit à l’ombre du cabinet, mais le roi aurait parlé avec « émotion », selon le valet de chambre. De Waresquiel suppose que Necker a argumenté en faveur de la réunion des trois ordres, ce qui est chose faite le 27 juin, mais trop tard peut-être[35].
La journée du 23 juin a des allures d’abdication pour Louis XVI note l’auteur qui pour lui, à ce moment-là, ne peut plus espérer faire machine arrière.
Du côté des proches du roi, comte d’Artois en tête, on parle de trahison lorsqu’on apprend l’entrevue.
Dans le même temps, fait incroyable à l’époque mais signe des temps, le château est envahi par la foule pour la première fois de son histoire et pas la dernière. On se répand dans les corridors, antichambres et jusque dans la cour de marbre en réclamant Necker….
A sa sortie du cabinet, le ministre hésite mais, comme un ultime affront au roi, décide d’aller à la rencontre de la foule qui le porte en triomphe jusqu’à son hôtel.
Conclusion : les débuts de la Révolution, une question de tempo
A quoi tient donc la Révolution ? Après l’examen minutieux de ces journées du 17 au 23 juin 1789, la réponse n’apparaît pas simple tant la multiplicité de facteurs, d’évènements et d’acteurs vient dessiner un chemin sinueux et incertain.
Ce qui ressort du récit de ces journées et du propos d’Emmanuel de Waresquiel, c’est avant tout le jeu des acteurs façonné par leur culture, leur imaginaire et leur vision des évènements, leur sens de l’action et surtout du rythme. Et c’est l’écart entre un roi et son gouvernement enfermés dans des traditions et un héritage indépassables d’un côté et des députés opportunistes à l’écoute de leur temps de l’autre qui constitue le véritable moteur de la Révolution au milieu de tous les autres facteurs comme le déficit, les mauvaises récoltes…
La clé de la Révolution est sûrement tapie là, dans le rythme emballé du temps court et les capacités différentes des acteurs à le percevoir, à l’imposer ou le maîtriser.
La Révolution et la politique en général, surtout en période de crise, est donc avant tout une question de tempo. On laissera le mot de la fin à un des personnages centraux de ces journées, Mirabeau qui, en parlant de Necker comme il aurait pu parler du roi, nous livre peut-être la clé de ces évènements : « Une horloge qui retarde. »
Emmanuel de Waresquiel signe ici un ouvrage dense mais rythmé par des chapitres courts et un style libre et léger, tranchant avec l’austérité du ton académique[36]. Cette forme permet alors à l’auteur d’entraîner à sa suite le lecteur au cœur de ces journées de juin et de lui faire ressentir, presque toucher, les tensions, l’incertitude, la peur et la gravité qui les animent. Ce récit est bâti sur d’innombrables sources, notamment celles des acteurs eux-mêmes, dont les nombreuses citations viennent donner corps au propos.
Ce choix a les défauts de ses qualités. En privilégiant le récit découpé en de multiples petits chapitres et en séparant de manière peut-être trop stricte les différents acteurs, l’auteur peine parfois à mettre en valeur le sens et le lien entre les différents évènements. On attend souvent, en fin de chapitre, l’analyse de l’historien remettant en relief l’évènement relaté.
Si le style libre de de Waresquiel fait de digressions et de petits commentaires dispensables pourrait gêner certains, ils ne gâtent en rien le fond et la rigueur du propos : la Révolution s’est essentiellement jouée dans ces jours de juin 1789. Cet ouvrage change-t-il radicalement notre lecture de la Révolution comme l’annonce le quatrième de couverture ? Non, mais il a le mérite de remettre au centre ce qui doit constituer toute étude de la Révolution à savoir les faits et les acteurs plutôt que les interprétations socio-politiques.
[1] « Rendre les évènements à eux-mêmes, le but de l’historien » in Emmanuel de WARESQUIEL, Sept jours, 17-23 juin 1789, La France entre en révolution, Tallandier, 2020, p. 22.
[2] Ibid., p.79.
[3] Ibid., p. 144.
[4] Ibid., p. 148.
[5] Ibid., p. 199.
[6] Ibid., p. 245.
[7] Ibid., p. 246.
[8] Ibid., p. 205.
[9] Ibid., p. 207.
[10] Ibid., p. 207-208.
[11] Ibid., p. 212.
[12] Ibid., p. 267.
[13] Ibid., p. 267. Tiré des mémoires de Talleyrand.
[14] Ibid., p. 269.
[15] Ibid., p. 291-292.
[16] Fragilisée en son sein par une minorité libérale emmenée par les ducs d’Aiguillon, La Rochefoucauld, Liancourt… Ibid., p.297-300.
[17] Ibid., p. 305.
[18] Ibid., p. 233.
[19] Ibid., p. 305-306.
[20] Ibid., p. 330
[21] Ibid., p. 330.
[22] Ibid., p .333-334.
[23] Ibid., p. 342.
[24] Ibid., p. 344.
[25] Ibid.
[26] Ibid., p. 349-350.
[27] Ibid., p. 358.
[28] Son journal s’intitule alors jusqu’en juillet 1789, Lettres du comte Mirabeau à ses commettants.
[29] Ibid., p.378.
[30] La formule apparaît par la suite le 23 juillet 1789. Op. Cit., p.377.
[31] Ibid., selon les différents témoins mais sans assurance, p. 384.
[32] Ibid., p. 385.
[33] Ibid., p. 385.
[34] Ibid., p. 386.
[35] Ibid., p. 388-389.
[36] Le titre des courts chapitres témoignent de cette liberté de style et de ton propre aux ouvrages de l’auteur.