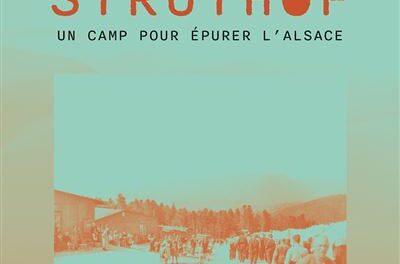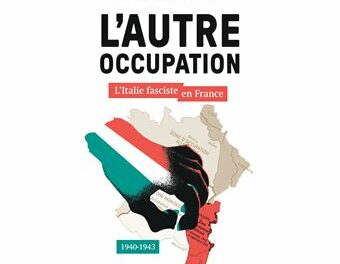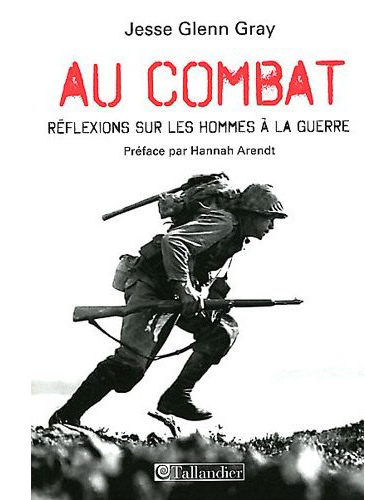
« L’une des grandes qualités de ce livre est de rendre l’opposition à la guerre plus forte et plus convaincante en ne niant pas la réalité et en ne se contentant pas de nous mettre en garde mais en faisant comprendre pourquoi bien des gens craignent autant aujourd’hui une vie vide et morne qu’une grande guerre.»
Hannah Arendt
«Alors que tant de témoignages ont été publiés, depuis plus de soixante ans, sur la Seconde Guerre mondiale, pourquoi ce livre est-il un grand livre ? Pourquoi faut-il absolument le lire ? Sans doute justement, parce qu’il ne s’agit pas d’un simple livre de témoignage, mais d’une tentative de penser la guerre, de penser en temps de guerre, malgré la pression des événements, malgré la mort qui rôde, malgré la peur.»
Bruno Cabanes
- Après de tels préfaciers, il peut sembler présomptueux de présenter cet ouvrage, et sans doute aurait-il été plus raisonnable, comme sur d’autres sites ou sur certaine revue de presse quotidienne, de se contenter de citer le point de vue d’autres chroniqueurs, avec lesquels, si possible on est en accord, ou de reprendre la quatrième de couverture aimablement fournie en fichier numérique par le service de presse.
Mais j’ai la prétention, sur un tel sujet de dire mon mot et de parler de cette expérience que l’auteur relate. Sans doute cela est lié à mon intérêt ancien pour la «chose militaire», renforcé aujourd’hui pour des raisons familiales et professionnelles, mais aussi parce que cette ivresse du combat, sel de la vie j’adore cette expression qui m’a été beaucoup reprochée , est bien celle que j’ai pu ressentir à certains moments de mon existence… Et le combat ne se mène pas seulement pendant une guerre.
Mais la guerre est sans doute une expérience unique, lorsque l’on est en situation de donner la mort à son semblable, et n’a rien à voir avec celle d’un animal Les anti-taurins développent hélas un argumentaire de ce type, ce qui pour moi en fait des êtres inhumains, même ritualisée comme dans la tauromachie de tradition espagnole.
Si l’on accepte de s’armer pour donner la mort, on accepte aussi de la recevoir, et ce code du soldat que l’on découvre lorsque l’on devient militaire professionnel, dans toutes les armées du monde, stipule bien cette éventualité.
Mais l’expérience de l’auteur, pendant la seconde guerre mondiale, n’est pas celle d’un professionnel qui fait le choix de l’engagement pour en faire un métier. Glenn Gray en 1943 reçoit une lettre à en-tête de l’université américaine de Columbia. Elle lui apprend que sa thèse de doctorat de philosophie vient d’être acceptée. Mais il trouve aussi dans son courrier un ordre de l’armée américaine l’informant de son incorporation imminente. Présent en Afrique du Nord, en Italie et en France, termine en tant qu’officier dans les services de renseignements en octobre 1945. Durant ces quatre années de guerre, il n’a pas cessé de consigner ses impressions dans des carnets : les combats, la libération de l’Europe, la dénazification.
La réflexion de l’auteur ne tourne pas sur les scènes de bataille et sur les descriptions de carnage, il sait le faire et on entend lorsqu’il pénètre dans ces villes Italiennes près de Monte Cassino les mouches bourdonner sur les cadavres. Dans le combat, il est comme détaché et observe tout en étant lui même acteur, ces hommes, ses frères humains, devenus des guerriers. ils n’y parviennent pas tous, et la peur fait parfois lâcher prise… Le bruit, la vue du sang, l’incertitude du moment qui s’écoule et qui peut s’arrêter brutalement, Glenn Gray l’évoque, tous comme il décrit l’amour en guerre et ce lien terrible qui se noue parfois entre Éros et Thanatos. Il y aussi la haine, carburant parfois utile qui fait avancer ces hommes revêtus d’un uniforme , ce qui les passer du statut de tueurs à celui de soldats.
Parmi les chapitres qui nous ont le plus interpellé, il y a celui qui est consacré aux figures de l’ennemi, et la distance que l’on prend nécessairement avec celui qui, de l’autre côté de la ligne de front ou dans le trou de combat d’en face, apparaît comme ne faisant pas partie du genre humain. Lorsque la mort frappe ses camarades les plus proches le soldat développe une haine personnelle à l’encontre de ses ennemis. Le changement qui s’opère en lui n’est pas tant le résultat d’un nouveau rapport à l’ennemi qu’une réaction à l’émotion causée par le deuil et l’exposition le danger. L’auteur s’interroge d’ailleurs sur les conditions qui conduisent un soldat, ou un civil, à faire preuve d’une certaine cruauté, parfois raffinée dans la pratique personnelle de la torture qui prospère généralement dans les guerres civiles. Le paradoxe est que le soldat est également conscient que son adversaire qui cherche à le tuer est lui aussi dans son bon droit. C’est une façon de reconnaître à l’ennemi une humanité commune.
L’auteur s’intéresse tout particulièrement à ces militaires de carrière qui sont minoritaires pendant la seconde guerre mondiale à laquelle il a participé. Dans les années 50, au moment où l’auteur rédige son ouvrage, les États-Unis ne sont plus véritablement engagés dans une guerre. Cela viendra à partir de 1963, pendant la guerre du Vietnam. Et bien entendu, le soldat professionnel apparaît comme un individu particulier. L’attitude d’un tel homme est régie par l’idée que le professionnel se fait de sa mission à la guerre. Il est un technicien de la guerre et d’après l’auteur ne se sent pas très différent du capitaine d’une équipe de football américain lorsqu’il se mesure à son adversaire.
Le soldat professionnel s’enorgueillit volontiers d’être apolitique, cela le libère, pense-t-il, lui permet d’agir à la guerre sans se soucier des conséquences autres que militaires de ses actions.
Évidemment, cette vision d’un Américain est bien différente de celle que les soldats français engagés, en tant que professionnels, dans la guerre d’Indochine, on pu développer. Cette fois-ci, le combat est politique, la population est un enjeu, et il s’agit de «gagner les cœurs et les esprits». Ne pas réussir à s’acquitter de cette mission, signifie perdre la guerre. Il est évident que cet ouvrage serait écrit bien différemment aujourd’hui, à la lumière des guerres qui ont été conduites en Algérie comme en Afghanistan actuellement.
Dans ces deux cas, c’est bien la doctrine de la contre insurrection qui s’applique, opposant des guerriers «professionnels» dans les deux camps, motivés par l’idéologie et par la nécessité absolue de remplir une mission, que ce soit vaincre le terrorisme ou chasser les infidèles.
En conclusion, l’auteur évoque le sentiment de culpabilité est bien entendu ce qu’il appelle l’avenir de la guerre. Dans les deux cas, il s’agit de blessures qui ne cicatrisent jamais. Le tourment de la culpabilité n’est pas seulement celui que l’on éprouve pour les souffrances que l’on a causées, mais peut-être aussi le reproche que l’on peut se faire, soit d’y avoir survécu, soit d’y avoir pris du plaisir.
C’est donc à ce titre que cet ouvrage est indispensable, car il nous amène à nous interroger, au-delà de nos sentiments, sur notre être. Il nous amène aussi, dans le confort de nos existences, dans des pays développés, à nous questionner profondément sur ce que nous ferions, pour défendre nos valeurs et nos idéaux. Ceux-ci peuvent parfois dépasser nos existences mêmes, et nous conduire au sacrifice. Et quand bien même celui-ci serait collectif, aux côtés de ses frères d’armes, il serait quand même au moment suprême, celui de l’homme seul.