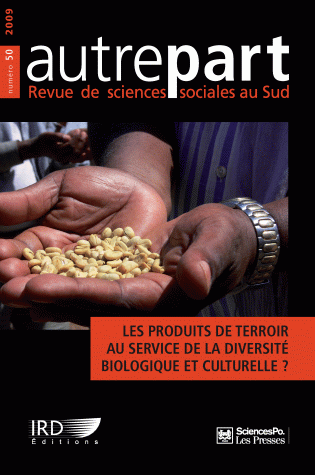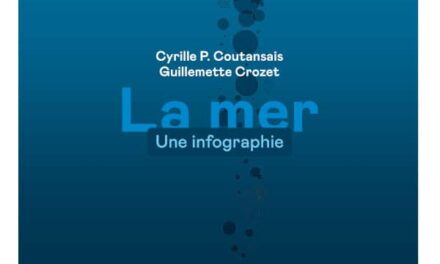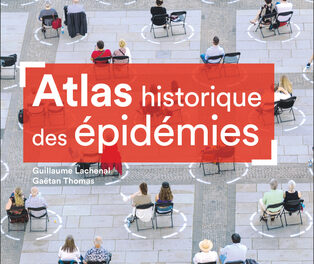Biodiversité ou diversité biologique voire culturelle, développement durable, écodéveloppement… constituent autant d’expressions et de mots nouveaux qui sont entrés dans notre quotidien pour, parfois, nous bousculer un peu. On en parle et on débat mais rarement le fond est abordé tant il est « intellectuellement et politiquement corrects » d’épouser les thèses officielles de cette nouvelle forme de développement qui entend sauver la planète et les hommes.
C’est pourquoi, le numéro 50 de la Revue de sciences sociales au Sud « Autrepart » vient à point nommé pour nous apporter des éléments tangibles à une réflexion nourrie.
En effet, construits autour de onze articles, la revue nous dresse tout d’abord l’état de la question sous son angle scientifique avant de nous livrer neuf études de cas couvrant trois continents.
Qu’est-ce qu’un produit de terroir ?
Les auteurs nous apprennent que « localiser et valoriser les spécialités locales [est devenue] une dynamique générale et foisonnante ».
Tous les pays du Sud, en développement, sont touchés par cette fièvre. Du politique aux grandes instances internationales comme la Banque mondiale, le FMI ou la FAO, chacun contribue à la valorisation d’un ou plusieurs produits du terroir. Une valorisation qui engendre, normalement, un développement durable dans un cadre presque idyllique des communautés rurales, autochtones ou simplement locale « pour reprendre la terminologie chère à la Convention sur la Diversité Biologique » nous précisent les auteurs.
Si les initiatives sont nombreuses, leurs stratégies et le champ de leurs objectifs le sont tout autant. D’après les auteurs, trois grandes tendances se dégagent :
a) La promotion des productions et spécialités locales au service du développement économique local ;
b) La prise en compte dans des politiques de conservation et de valorisation de la diversité biologique et culturelle ;
c) L’instrumentalisation dans des processus plus larges de revendications territoriales et identitaires.
Mais avant tout, il faut dégager ce qu’est un terroir pour savoir si tel ou tel produit est ou non de terroir. Si la question peut paraître incongrue, elle est pourtant essentielle car, comme le soulignent les auteurs, ce mot est essentiellement français et que son équivalent dans les autres régions du monde n’est pas aussi évident. C’est pourquoi, ils s’appuient sur trois axes pour cerner sa « réalité ».
a) Le premier axe concerne le territoire : ses ressources biophysiques et ses ressources humaines (les savoir-produire, savoir-transformer et savoir-évoluer de ses habitants), sa localisation, sa superficie et les productions qui s’y rencontrent ;
b) Le deuxième axe concerne le terroir dans son sens social et historique s’opposant aux autres niveaux (régional, nationale, global…)
c) Enfin, le troisième axe se réfère au nom du terroir-territoire lequel est souvent identifié par un nom géographique puis par un label officiel protégé par une dénomination d’origine.
Produit d’un terroir pour assurer un développement plutôt durable avec des outils de mesure souvent imprécis c’est ce qu’on essayé de nous présenter les auteurs à travers leurs études de cas.
Des études de cas qui ne relèvent pas d’une typologie à priori mais, à la lecture, on peut toutefois remarquer que deux aspects se dégagent. Nous avons d’un côté les exemples qui nous retracent le « parcours » d’un produit de terroir devenu grande marque et de l’autre, des initiatives locales ou gouvernementales qui tendent à « tirer » avant tout un profit des nouvelles donnes de l’économie mondiale.
Des produits de terroirs devenus « stars »
Quatre cas peuvent entrer dans cette catégorie mais avec des « parcours » et parfois des « débouchés » différents.
Le premier, le plus typique concerne l’entreprise Natura et les vendeuses d’herbes de Belém. Au Brésil, des femmes cueillaient et vendaient depuis toujours des herbes aux vertus bénéfiques disaient-elles. Une société spécialisée dans la production de produits cosmétiques a exploité ce « filon » pour la fabrication de nouveaux produits. Et, le 22 avril 2005, à Saint –Germain des Prés, le premier magasin de l’enseigne Natura proposait ses produits à la vente à une riche clientèle. Réunies en association, les vendeuses d’herbes traditionnelles ont intenté une procédure pour…. partager les bénéfices. Un contrat a été signé, assorti bien évidemment de clauses de préservation de la biodiversité. Mais probablement plus dans l’intérêt commercial de l’entreprise Natura qui peut ainsi surfer sur la vague de la demande de produits respectueux de la biodiversité.
Le deuxième cas, plus proche de nos côtes, concerne l’huile d’argan du Maroc. Véritable miracle de la nature, l’huile d’argan se trouve « entre l’élixir de beauté et la denrée alimentaire ». En réalité, au Maroc, les produits dits purs recouvrent des utilisations différentes. Ainsi, par exemple, l’huile d’olive peut servir à la préparation des plats cuisinés, elle peut se goûter le matin en y trempant du pain, elle peut également servir à adoucir la peau ou même à lisser les cheveux. Et bien pour l’huile d’argan il en va de même. Et, dans ces régions quasi désertiques, toute l’organisation sociétale s’est faite autour de ce produit depuis longtemps déjà.
Mais, avec les nouvelles priorités qui sont le maintien des populations rurales sur place, l’émancipation de la femme par le travail et les intérêts commerciaux d’entreprises des pays industrialisés, une véritable révolution dans ce sud marocain s’est faite jour. En effet, l’huile d’argan dont les vertus ont été reconnu sinon par la science, du moins par la publicité des médias permet en plus, au niveau de l’image véhiculée, à de nombreuses femmes de s’affirmer dans une société que l’on présente trop souvent encore comme une société d’hommes pour les hommes. Pourtant, d’après les auteurs, la réalité est différente. Ils nous présentent une « dé-domestication » de la filière et nous précisent que si « le monde entier a adopté l’huile d’argan comme un produit de terroir, elle conserve de moins en moins de liens avec les lieux, les savoir-faire et les acteurs qui font sa typicité ».
Le troisième exemple illustre « l’ascension » du rooibos d’Afrique du Sud. Le rooibos (ou thé rouge) a été découvert par les populations locales vers le XVIII ou XIXe siècle. Là encore, on prétend que le rooibos a des vertus médicinales et surtout qu’il aurait la propriété de retarder le vieillissement. Tout un programme donc pour conforter son exploitation « authentique ». C’est pourquoi, exploitants et autorités se sont lancés dans une procédure d’IG (Indication Géographique) qui correspond globalement à la démarche mieux connue en France sous le vocable AOC (Appellation d’Origine Contrôlée). Le cahier des charges est évidemment strict mais surtout, peut être, pour en tirer des bénéfices substantiels grâce à la « divine » protection de l’environnement. Si la phase administrative est en bonne voie, la conservation de la biodiversité est-elle pour autant préservée ? Cet acharnement juridico-légal du label ne serait-il pas un moyen déguisé pour encourager une « agriculture commerciale » d’un nouveau genre ? C’est ce que pensent probablement les agriculteurs du Vanuatu dans l’exemple suivant.
Le quatrième exemple apparaît davantage comme le contre-pied des trois précédents. En effet, comme le soulignent les auteurs « compte tenu de la faible compétitivité du pays […] favoriser des produits qualifiés par leur origine ou des productions agricoles à haute valeur ajoutée, apparaît en effet comme la meilleure voie envisageable pour l’avenir ». Mais, pour l’heure, les Vanuatais réfléchissent à « la forme que pourrait prendre une intervention extérieure aussi nécessaire que délicate autour de la promotion des plantes à tubercules comme élément de stratégies économiques alternatives et comme projet de société ». En d’autres termes, se faire « manger » pour pouvoir manger demain…
Quand l’état soutient le « tournant » de l’agriculture
Tous les autres exemples présentés dans ce numéro 50 de la revue, retracent des expériences ayant amené les institutionnels à investir le domaine du développement des produits de terroirs.
Il en est ainsi du Cambodge qui, comme presque tous les pays en développement a rejoint l’Organisation Mondiale du Commerce. Le pays ne participe pas seulement à la mondialisation mais est soumis, pour ses exportations à une législation d’origine européenne qui vise à la valorisation du potentiel des spécialités locales pour le développement économique, la valorisation de la biodiversité, la préservation du patrimoine culturel et le développement rural. C’est ainsi que le Cambodge, après son adhésion à l’OMC, a mis en place un projet de loi sur les appellations d’origines contrôlées. Sont concernés notamment le fil de soie, le tissage, le sucre de palme, le riz de Battambang, le poivre de Kampot, la cardamone de Pursat, etc… Bien que la contre façon existe déjà, cette orientation aura permis, sur le plan économique, une valorisation des produits agricoles ainsi qu’une conservation des activités traditionnelles et culturelles des régions d’une part et d’autre part, une synergie entre le tourisme et les activités traditionnelles.
Un autre exemple pris en Inde, pays de la « Révolution verte » tant adulée puis décriée pour son atteinte à l’environnement, concerne le café. Là aussi, des normes, des cahiers de charges tentent de limiter les dégâts. Mais, dans ce pays il semble que les freins soient plus nombreux à cause notamment du passé productiviste de l’agriculture. C’est pourquoi les auteurs signalent qu’aujourd’hui, malgré les efforts, les résultats ne sont à la hauteur ni des investissements, ni des espoirs.
En revanche, la Mongolie, pays traditionnellement tourné vers l’élevage, ne connaît pas les mêmes obstacles. Faut-il en déduire que le passé agricole de ce pays est encore « vierge » ? Peut-être.
Dans tous les cas, le fait d’avoir été à l’écart de la modernisation et donc du productivisme agricole aura permis à la Mongolie de préserver un savoir faire non « entaché » de manipulations chimiques et/ou biologiques. De ce fait, il est plus aisé de se pencher sur quelques règlementations de certifications avant de lancer sur le marché mondial « les produits purs et authentiques » du Mongole. Mais, comme le constatent les auteurs, « il sera intéressant de voir quelles stratégies écologiques, économiques et culturelles concrètes le gouvernement, les laboratoires scientifiques et les éleveurs développeront dans un futur proche pour parvenir à concilier l’exportation de produits biologiques, la revalorisation des produits du terroir et la préservation de la diversité biologique et culturelle du pays ».
La réponse se trouve peut-être dans cet autre exemple brésilien. En effet, au Brésil, la viande de la Pampa Gaucho de la campagne méridionale et les Vins des Vales da Uva Goethe, même s’ils sont été façonnés par l’homme sont devenus des produits typiques par la « volonté médiatique ». C’est pourquoi, les instances brésiliennes se sont lancées dans une procédure d’IG (indication géographique) pour soutenir ces deux activités. Mais, comme l’affirme les auteurs, « l’indication géographique au Brésil ne semble pas, à priori, un instrument pour établir une passerelle entre valorisation économique et préservation de la biodiversité ». Les auteurs pensent cependant que « la démarche oblige les acteurs locaux à repenser leurs interrelations avec le milieu ». En somme, à défaut de pouvoir atteler le bœuf à la charrue, on mettra la charrue devant le bœuf, pourvu que le tout avance…
Mais, toutes ces nouveautés liées au développement durable et à la préservation de la biodiversité, ne vont pas de pair avec les pratiques ancestrales que les politiques et les médias cherchent à vendre. C’est ce que souligne ce dernier exemple du cas du queso Cotija (Mexique). Il s’agit de la certification d’un produit laitier qui a été élaboré en marge des grandes routes commerciales depuis très longtemps déjà et donc en marge des sacro-saintes normes. Le problème réside donc dans « l’entêtement » des producteurs à vouloir défendre un produit « original » et les impératifs d’un marché mondial qui placent haut la barre des normes. Et c’est à travers ce dernier exemple que le lecteur pourra peut-être se rendre compte des véritables enjeux liés à la préservation de la diversité biologique et culturelle.
Le lecteur pourra alors se pencher sur les effets de l’exode rural qui a permis à de nombreuses populations d’investir les villes et devenir des « consommateurs » tout en livrant les campagnes au productivisme. Il pourra par ailleurs mesurer les efforts déployés par les gouvernants pour inverser la tendance en cherchant à maintenir les populations dans les campagnes ; des campagnes qui sont, dans l’intervalle, aussi devenues des lieux de consommation grâce aux nouveaux médias. Il pourra enfin s’interroger sur la véritable volonté de préservation de l’environnement.
En conclusion, ce numéro apporte sans nul doute des éléments indispensables à une bonne réflexion sur cette nouvelle vague qui déferle sur notre monde et qui cherche par tous les moyens à rétablir une équité entre les populations et à préserver nos richesses pour les populations futures.
A l’heure où l’inspection nous « pousse » à aborder les notions de développement durable, à l’heure où nos manuels scolaires regorgent d’exemples de commerces équitables, il est bon de mettre entre de nombreuses mains cette revue simplement pour permettre une réflexion « honnête ».