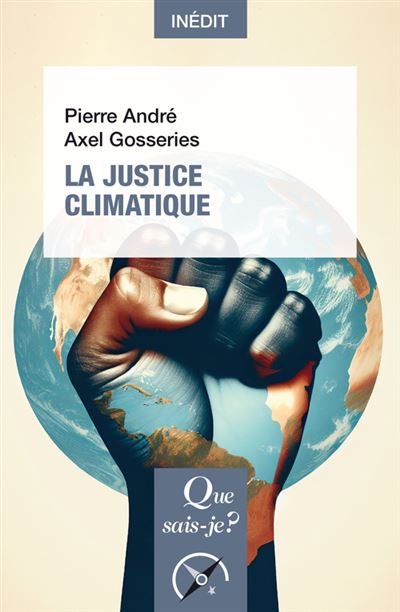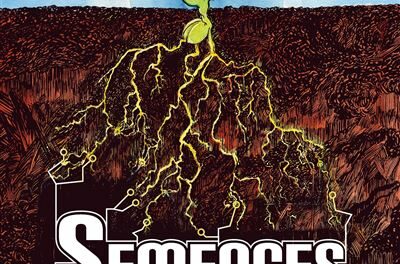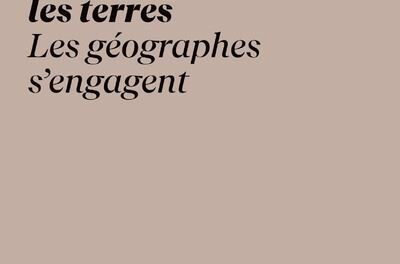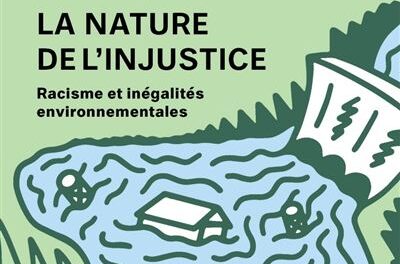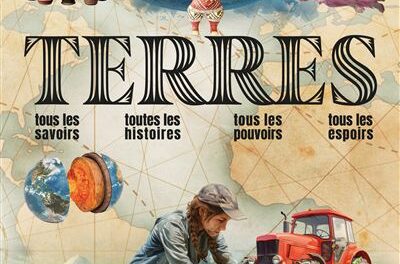La justice climatique fait de plus en plus parler d’elle par trois canaux majeurs : les procès (la voie judiciaire mobilisée par les activistes climatiques), les associations et ONG (avec des actions comme les marches, les grèves, la désobéissance civile), les COP (où les pays les plus vulnérables tentent de demander des comptes). C’est une démarche de philosophie appliquée en dialogue avec les autres disciplines qu’empruntent Pierre André et Axel Gosseries, tous deux chercheurs à l’université de Louvain.
Le premier chapitre s’intéresse à « comment justifier l’objectif climatique » ? Il traite du réchauffement optimal, si l’on peut s’exprimer ainsi, au travers de l’analyse coût/bénéfice de différentes trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre. Cela interroge l’utilitarisme et le bien-être mais aussi l’agrégation (la somme du bien-être pour tout le monde). Se pose aussi la question du « taux d’actualisation », à savoir que ces analyses concernent une multiplicité de générations. La limite, c’est la distribution entre les individus : quid des plus vulnérables (îles Pacifique) ? Une autre limite concerne la pris en compte des « valeurs non économiques », non substituables.
Ce chapitre évoque aussi la protection des droits humaines fondamentaux, davantage centrée sur les « besoins de base » et « l’égalité ». On rejette ici l’agrégation des intérêts de l’approche coût/bénéfice. Quel peut être le seuil ? 2° ou alors « autant que possible » ? Le « juste objectif » est difficile à chiffrer. Se pose aussi la question du partage des coûts pour qu’ils ne pèsent pas sur les mêmes.
Il est aussi question de ne détériorer la situation de personne. La coopération actuelle n’est pas viable au niveau international : les efforts ne sont pas souhaités par les nations puissantes. Il faut aller vers « l’avantage mutuel », le principe de la compensation des perdants et de maximisation du « surplus coopératif » pour le redistribuer ensuite.
Le second chapitre se demande comment partager le budget carbone. Il y a effort financier à fournir a posteriori. Mais quid du droit fondamental à se développer quand même ? En 1997, à Kyoto, seul les pays développés étaient contraints. Aujourd’hui, on est sur de l’engagement volontaire.
Les droits sont-ils acquis ? Il faut parler de la capacité d’absorption sans danger des GES. En émettant des GES, on réduit d’autant la possibilité pour autrui d’utiliser cette capacité : c’est la rivalité de consommation. Nous ne pouvons pas empêcher les autres d’utiliser la capacité de la Terre d’absorber les GES sans danger : non excluabilité du bien. On pourrait attendre des pays ayant émis le plus tôt qu’ils payent le plus…pour justifier de leur développement initial ? Mais cela peut être vu comme injuste par les autres. Et quid des émissions passées ici ? Faudrait-il amender en fonction de cela ?
Le chapitre évoque aussi le droit à des émissions de subsistance. Là, c’est la différence entre « émissions de base » et « émissions de luxe ». Il y a un plafond et un plancher : pas trop haut pour ne pas emballer le climat davantage mais pas trop bas pour permettre le développement quand même. Mais là encore, quid des générations actuelles et surtout futures qui paieraient l’addition des actes du passé ?
Le dépassement de la justice carbonique évoque ensuite l’idée que la justice climatique ne s’y limite pas. Un pays développé ayant atteint la neutralité carbone n’en a pas forcément fini avec ce combat : il a encore une « dette passée ».
Le chapitre trois se demande comment répartir les efforts climatiques. La répartition doit-elle se faire par un aspect « causal » (« en fonction de la responsabilité ») et un aspect « solidarité » (en fonction des « capacités respectives » de chacun) ? Cela reste volontairement ambigu pour l’ONU (stratégiquement pour faire adopter un texte plus facilement).
L’angle d’attaque du « pollueur payeur » est le plus intuitif : le « paiement » n’est pas que financier, il est aussi du transfert de technologie ou de la baisse d’émissions. De même, la pollution n’est pas que des émissions : c’est aussi de la déforestation, de l’acidification d’océans…On devrait d’ailleurs dire « contributeur payeur ». La temporalité est questionnée ici : avec une « ignorance excusable » (« on ne savait pas »), les principaux responsables sont déjà morts (« pollueurs disparus »).
Il y a aussi l’idée du « bénéficiaire payeur » : les bénéficiaires du développement résultant d’émissions passées (nous) devraient payer leur tribut. Il n’y a pas de faute initiale mais il n’y a plus d’ignorance (depuis les années 1990).
On parle aussi de solidarité climatique et de principe de capacité à payer. Ici, ce serait indépendamment du passé mais surtout en fonction de ce qu’on peut apporter. Mais où serait le seuil ? Et l’échelle ? L’échelle nationale serait improductive, il y a nécessité de coopération.
Ces approches sont-elles antinomiques ou complémentaires ? Selon l’approche retenue, les pays en haut du classement peuvent changer d’où l’intérêt d’approches hybrides.
Le chapitre quatre se demandent si les individus ont des obligations climatiques. Les actions efficaces sont connues (réduire l’usage de la voiture, de l’avion, manger moins de viande…) mais est-ce que tous ont l’obligation de s’y atteler ? Que faut-il entendre par « responsabilité individuelle » ?
Les individus sont-ils impuissants ? Il peut y avoir une responsabilité causale et un aspect unilatéral avec le risque d’une « inefficacité causale ». Encore ici, on trouve des problèmes d’effets de seuil : celui qui apporte la goutte d’eau qui a fait déborder le vase ou alors tous ceux qui l’ont rempli avant lui ? Le problème des effets de substitution peut se lire ainsi : mes efforts en faveur d’une réduction de mon chauffage feront baisser le prix de celui-ci et ainsi relancer sa demander. L’effort est anéanti. C’est typique d’une économie de marché où les émissions de GES ne sont pas régulées. Parfois même, il y a des effets rebonds. De ce fait, les actes individuels ont toujours une cause qui n’est pas « nécessaire ».
La responsabilité individuelle est indispensable. Le progrès ne pouvant pas tout, il faut tout de même miser sur les comportements individuels. Il faut aussi supporter les coûts de transition. Il faut aussi miser sur une masse critique pour que cela fonctionne.
Qu’en est-il de la responsabilité inéquitable des individus ? Les moins fortunés doivent-ils contribuer de la même façon ? Les minorités exposées aux violences policières doivent-elles contribuer à la désobéissance civile ? Il faut étudier les (in)capacités de chacun. Il faut aller vers des « responsabilités communes mais différenciées ».
Le chapitre cinq se nomme « prévenir ou guérir ». Il se demande d’emblée comment compenser les préjudices climatiques. Des mesures compensatoires sont des traductions possibles de la justice rectificative (en nature ou financièrement, cela laisse de la liberté aux victimes). Compenser des dommages peut parfois être plus intéressant que de les éviter pour éviter de gaspiller des ressources. Mais parfois, on a des « pertes non économiques » (des vies, des écosystèmes, une souveraineté…).
Sur le captage du carbone dans l’atmosphère, les techniques sont variées (foresterie, fertilisation des océans…pour rester dans le domaine de la photosynthèse même si celui-ci n’est pas le seul. On a également la bioénergie avec captage et stockage du carbone. Mais cela est couteux et incertain sur ses résultats sans compter les possibles effets secondaires. Y-a-t-il un « aléa moral » (entretien de la hausse qui est censée précéder la redescente) ou, au contraire, un réel espoir ?
Sur la réflexion des rayons du soleil, nous avons le cas de l’injection d’aérosols soufrés. Cette technique serait peu couteuse et rapide à mettre en œuvre mais il y a de sérieux risques sur la biodiversité.
Il y a toujours un risque de diversion des objectifs initiaux, des impacts distributifs injustes (baisse des précipitations dans des zones qui en dépendent fortement au niveau agricole), un risque de « choc climatique » en cas d’arrêt brutal pour les générations suivantes.
D’où une conclusion générale qui réaffirme que la stricte priorité doit être donnée à la réduction des émissions de GES dans un monde libre, ouvert, aux institutions stables et démocratiques.