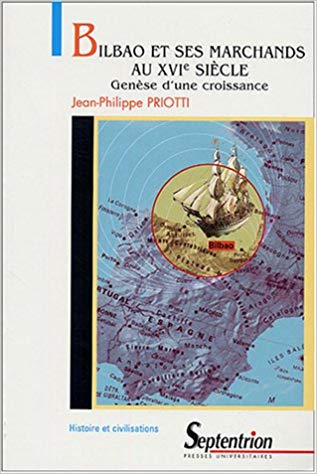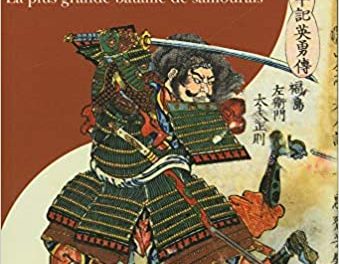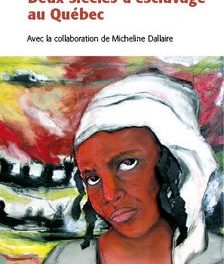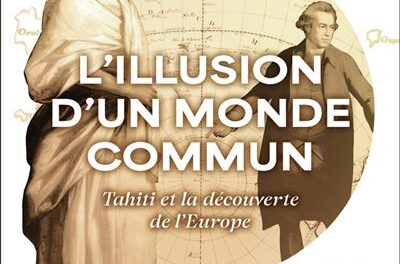A l’heure où les bilans d’histoire culturelle élaborent une pesée critique de ce domaine des études historiques, dominant depuis une bonne vingtaine d’années pour les périodes moderne et contemporaine, l’ouvrage de Jean-Philippe Priotti se présente résolument à contre-courant, en tant qu’étude d’histoire économique.
Dans son introduction, il expose ses références et sa problématique et s’interroge sur l’héritage des maîtres éminents de cette spécialité : Fernand Braudel et Immanuel Wallerstein. Et à son tour, il pose le problème de la notion d’économie-monde, pour décrire l’essor qui apparaît au XVIe siècle dans le sillage des grandes découvertes. Il y évoque la question du poids de la péninsule Ibérique dans cette nouvelle économie. Bien entendu, la place de Séville est connue depuis longtemps par les travaux de P. Chaunu et celle de la Carrera de Indias, la « route des Indes », a été étudiée, entre autres, par A. García Baquero : ces analyses ont été largement diffusées. Pour autant, l’auteur remet en cause une première évidence, à savoir la considération de la péninsule Ibérique comme « une courroie de transmission passive » entre le pôle dynamique de l’économie-monde, l’Europe septentrionale, et l’Outre-mer, surtout américain. Cette contestation de la partition traditionnelle effectuée entre centre et périphéries se double d’une seconde thèse allant à l’encontre d’une autre idée couramment admise : l’Espagne, des Rois Catholiques jusqu’à Philippe II, ne dispose pas que d’un port méridional – Séville – mais aussi d’une façade commerciale active sur le littoral septentrional – et basque en particulier-, non moins importante que la porte sévillane. Enfin, le privilège des Basques de l’Hidalguía, la noblesse universelle, renforce l’intérêt pour l’étude des activités économiques de cette région car il désamorce les questions de dérogeance comme facteur explicatif de la décadence économique espagnole.
Pour ce faire, l’auteur a dépouillé de nombreux fonds d’archives – parmi lesquels ceux des archives notariales de Bilbao et des milliers d’obligations commerciales qui y sont contenues ; en outre, il a procédé à une (re)lecture des 3200 lettres des correspondants bilbanais de Simon Ruiz, marchand dont l’activité avait fait l’objet de l’étude pionnière d’Henri Lapeyre (Une famille de marchands, les Ruiz : contribution à l’étude du commerce entre la France et l’Espagne au temps de Philippe II, Paris, 1955). La période couverte par cette enquête sur le commerce basque et ses négociants couvre un siècle, 1520-1620, même si de nombreuses allusions à l’époque antérieure sont nécessairement présentes. Pour étayer ces propositions sur le poids des échanges commerciaux du Pays Basque, l’auteur expose leurs principaux fondements au cours des trois parties de son analyse.
Dans un premier temps, les prémices d’une réussite sont surtout consacrées à la présentation et à la description des potentialités de Bilbao. Il s’agit moins d’une ville que d’un complexe centré autour de la ria du Nervión, profonde de quelque 22 km, qui regroupe, en plus de Bilbao, un chapelet de petites cités portuaires (Portugalete, Deusto…). Cet ensemble bénéficie de privilèges économiques, tel que l’absence de taxes sur les exportations vers la Castille (alors en plein essor) ou la création d’un consulat de commerce à Bilbao en 1511. D’un point de vue politique, l’autonomie basque s’épanouit à l’ombre des Fueros (les Fors), confirmés par les souverains successifs, de Charles Quint à Philippe III. Les conditions semblent propices au renouveau commercial.
Cependant, l’un des obstacles majeurs à une complète adhésion aux démonstrations de l’auteur réside dans le poids démographique de l’ensemble considéré : non seulement Bilbao, mais le complexe portuaire autour du Nervión, paraissent quantitativement faibles en comparaison des autres cités marchandes. En effet, Bilbao compterait environ 5700 âmes en 1514 et 5000 en moyenne pour le siècle (p.24) ; le complexe urbain autour de la ria concentrerait un peu plus de 17 000 habitants. Dès lors, il est difficile de penser que cet ensemble puisse rivaliser avec Séville et avec Londres, comme il est affirmé à plusieurs reprises. En dépit de cet élément, son argumentaire garde tout son intérêt car il souligne qu’on ne peut réduire le poids économique d’une région à la seule mesure démographique. En 1561, par exemple, le trafic du port de Bilbao représente plus des ¾ de celui du port de Séville (p.79) et, si 80 % des importations d’Amérique arrivent à Séville (120 000 habitants en 1588), l’essentiel est réexporté hors de la péninsule.
Par ailleurs, Bilbao et l’ensemble basque qui l’entoure, se fondent sur des activités diversifiées.
D’une part, la place des chantiers navals est considérable : Bilbao peut disposer de 300 à 500 unités au début du siècle, et près du double 50 ans plus tard. L’aide financière de la monarchie est indiscutable, comme en 1593, lorsqu’elle interdit aux arsenaux sévillans d’armer des navires pour les convois de la Carrera de Indias.
D’autre part, l’extraction et le travail du fer sont essentiels et les grands centres métallurgiques proches de la capitale de Biscaye sont dynamiques comme celui de Durango qui possède alors 200 forges. Cet ensemble jouit des nombreuses commandes d’armement provenant de la monarchie ; selon les estimations de J-P Priotti, le Pays Basque représenterait 15 à 37% de la production européenne de fer. Ces activités industrielles basques augmentent les besoins en bois, abondant dans la province, et stimulent l’économie.
La proximité de la mer se conjugue alors pour expliquer le puissant essor maritime du Pays Basque, ce qui fait dire à l’auteur que son apport « à la supériorité maritime de l’Europe sur le monde moderne a été déterminant » (p.47). La pêche constitue un autre point fort de l’économie basque, avec l’exploitation des bancs de Terre Neuve qui atteint son apogée dans les années 1560-70 : Madrid en est alors un des grands débouchés.
Par ailleurs, l’exportation des laines de la Mesta, cette organisation d’éleveurs de troupeaux de moutons, s’effectue à partir du port de Bilbao, avec en particulier les fameuses laines de qualité issues des moutons merinos. Cependant, à partir de 1566, la révolte des Pays-Bas espagnols contre l’autorité de Philippe II frappe de plein fouet ce secteur.
Enfin, les Basques jouent un rôle de « rouliers des mers » non négligeable, effectuant des transports maritimes avec d’autres ports européens.
La seconde partie insiste sur cette fonction de redistribution occupée par les Basques : l’auteur l’intitule le carrefour commercial européen. Les échanges sont considérables avec Nantes, et plus généralement avec les autres ports français, tel que Rouen, même s’ils sont déficitaires. Pastel, vins et toiles sont largement importés dans la péninsule, alors que les draps de Ségovie se rencontrent sur les marchés de France. Pour l’Atlantique, Séville et Lisbonne sont des partenaires importants de Bilbao, quand les liens entretenus avec Bruges (où l’on construit un Hôtel des Biscayens), puis avec Anvers, ne cessent de s’accroître. Pourtant, là encore, le déficit commercial reste manifeste, ainsi que l’avait démontré Henri Lapeyre par le calcul des dîmes de mer. Enfin, la découverte et l’exploitation des mondes extra-européens ne ruinent pas immédiatement, ni totalement, le commerce basque en Méditerranée ; il faut presque un siècle pour que les navires de Biscaye, présents au début de la période dans les principaux ports méditerranéens (dont Gènes), disparaissent de cette mer.
La tentative de reconstitution de la conjoncture permet de nuancer les rythmes économiques admis jusqu’à présent. En effet, le déclin commercial de Bilbao n’interviendrait pas autour de 1557 (la banqueroute de la monarchie), mais serait plus tardif, pour n’atteindre le Pays Basque qu’autour des années 1570-1580 (parallèlement au sac d’Anvers de 1576). Enfin, la guerre avec l’Angleterre (1588 : Invincible Armada) et les interventions dans les guerres de Religion en France, renforcent les difficultés que les Basques affrontent dans les principaux circuits commerciaux fréquentés ; les marques de ce déclin sont nettes au début du XVIIe siècle.
La troisième partie de l’ouvrage constitue l’élément le plus original de ce travail. L’auteur s’intéresse aux acteurs du commerce de Bilbao, les négociants et hommes d’affaires, et aux réseaux qu’ils ont tissés. Il distingue les commettants des grands marchands, qui ordonnent les achats ; les premiers, qualifiés d’hôtes (húespedes), entreposent les marchandises pour le compte des seconds et sont rémunérés à la commission (l’ostelaje). Cependant, cette distinction s’efface progressivement à la lecture des biographies et des itinéraires que l’auteur reconstitue. Il le montre pour la famille Del Barco, des dépendants des Ruiz qui s’affranchissent peu à peu de leur patron, jusqu’à en devenir les concurrents. On le voit aussi avec la belle carrière de Diego de Echevarri, qualifié en 1599, d’homme le plus riche de la ville (quelque 160 000 ducats de patrimoine !). La reconstitution de la structure de 23 patrimoines marchands (p.273) permet de souligner leur moindre importance en comparaison de ceux de Medina del Campo, la grande ville de foire du royaume de Castille. Partant de ces itinéraires marchands, l’auteur dessine les contours des « figures de l’entrepreneur » et il s’attache à restituer les stratégies familiales. Parmi celles-ci, les alliances matrimoniales sont capitales, et le niveau des dots souligne leur place dans les structures patrimoniales ; leur montant moyen d’environ 2 500 ducats constitue un palier non négligeable (B. Bennassar qualifiait de royale une dot de 6 500 ducats et de confortable une dot de 1000 ducats). Par le moyen de ces alliances, on découvre d’étroites relations entre négociants et milieux militaires, relations qui sont à leur tour étroitement liées à la légitimation religieuse de la guerre… Peut-on pour autant qualifier ces personnages « d’hommes de Dieu » (p.195) ?
L’auteur passe aussi en revue les principales formes de commerce et d’investissement (prêt maritime, dit ”à la grosse aventure”, assurances, présence de trocs qui s’accroît à mesure du déclin des grandes foires de Castille sous le règne de Philippe II) ; ces formes soulignent l’intérêt que portent les négociants de Bilbao pour le milieu de la finance : les deux banques sévillanes se trouvent entre des mains basques (p.241-242). Pourtant, la reconstitution des carrières de Pedro de Nobia (p.258) et de son cousin indique clairement le choix d’un retrait (même progressif) des Basques du monde des affaires, préférant l’élaboration d’un majorat (patrimoine héréditaire dont la transmission et la cession sont soumis à des règles strictes) à l’aventure commerciale. Ainsi, la possession de juros et censos (emprunts d’Etat et rentes auprès de particuliers) en quantité transforme nos marchands en investisseurs qui s’intéressent bien plus aux placements financiers et aux revenus issus de la rente qu’à l’activité économique et à la production de biens.
En cela, les nombreux arguments avancés par l’auteur permettent de nuancer le poids traditionnellement affecté à Séville et de modifier la chronologie des pulsations économiques de la péninsule Ibérique. Mais ils confirment aussi le déclin du commerce ibérique, même dans ses aspects les plus dynamiques, là où la noblesse est universelle, dans le Pays Basque, alors que cette universalité aurait pu permettre d’enrayer la course à la rente.
CR d’Alain Hugon