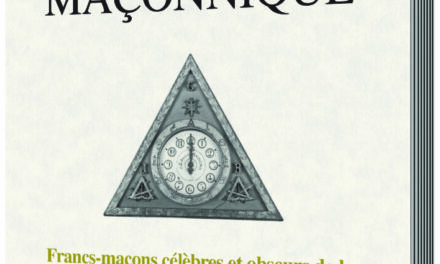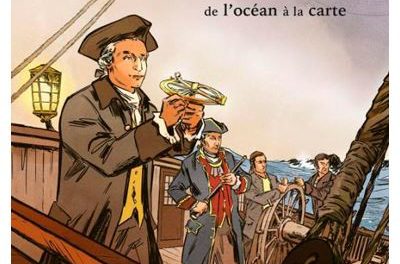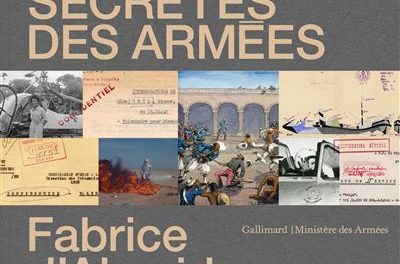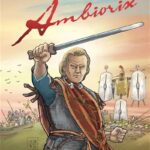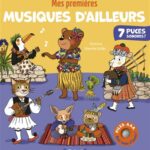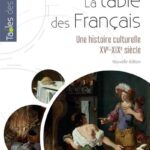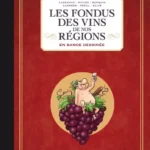Les éditions Tallandier ont publié en janvier 2024 un nouvel ouvrage de Jean-Robert Pitte sur la gastronomie, une biographie de l’un de nos plus brillants écrivains de la bonne chère, Brillat Savarin. J’ai eu l’occasion de découvrir ce livre et son auteur lors d’une conférence aux Rendez-vous de l’Histoire de Blois (cf. compte-rendu des Clionautes). Ce fut une excellente mise en bouche au cours sur le repas gastronomique des Français que je devais préparer pour mes élèves de Terminale. On retrouve dans le livre le style alerte et agréable de l’orateur, avec un surcroît de rigueur dans la présentation de son sujet, comme il convient. Quoique le format de 300 pages soit volumineux, le livre n’est pas intimidant. Son chapitrage est équilibré, ni trop détaillé, ni trop elliptique, et on se promène sans difficulté d’un point à un autre, sans surcharge de notes en bas de page ni digressions interminables. J’apprécie une lecture dont on sent le questionnement préalable et conducteur de l’auteur. C’est souvent la faiblesse des biographies d’être une somme de tout ce que l’on sait d’un individu mais sans autre axe que la linéarité de l’existence. Ici, l’auteur plante dès le début sont décor pour ensuite créer une analyse sur la contribution de Brillat-Savarin à la gastronomie française.
L’auteur : Jean-Robert Pitte
Professeur émérite de Géographie et d’Aménagement à l’Université Paris-Sorbonne dont il a été Président de 2003 à 2008. Il a enseigné la géographie historique et culturelle, en particulier de l’alimentation et du vin, ainsi que l’histoire de l’aménagement et du paysage. Il est membre de l’Académie des Sciences morales et politiques. Il est président de la mission française du patrimoine et des cultures de l’alimentation qui accompagne les cités de la gastronomie.
Le livre
Je ne vais pas reprendre le détail de sa biographie sur son parcours de magistrat, son Bugey natal, les péripéties de son parcours politique comme maire de Bellay, député du Tiers embarqué dans la Révolution française jusqu’à son exil de 1792. Tout cela est plus exposé dans le compte-rendu de la conférence de Blois citée plus haut. Je vais me consacrer à la dernière partie du livre, la plus intéressante à mon sens parce qu’elle évoque le chef d’œuvre de Brillat-Savarin, sa Physiologie du goût, décriée par Baudelaire, encensée par Balzac. J’invite également le lecteur à se reporter à la très utile « table des recettes » que Jean-Robert Pitte a placée juste avant la table des matières : ce pourrait être l’occasion de quelques séances de travaux pratiques après lecture.
Recette des truites frites
« Cependant n’oubliez pas, quand il vous arrivera quelques unes de ces truites, qui dépassent à peine un quart de livre, et qui proviennent des ruisseaux d’eau vive qui murmurent loin de la capitale ; n’oubliez pas, dis-je, de les frire avec ce que vous aurez de plus fin en huile d’olives1 : ce mets si simple, dûment saupoudré et rehaussé de tranches de citron, est digne d’être offert à une éminence. »
Servez en compagnie d’un vin blanc sec guilleret du Mâconnais ou du Bugey.
J’en reviens donc à la Physiologie du goût. Rédigé peu avant sa mort, l’ouvrage a été immédiatement salué par le public. Brillat-Savarin y condense, de façon très confuse il faut le dire, toute une vie de remarques de fin de repas et d’expériences culinaires.
Bien manger s’apparente à un plaisir total, en parfait équilibre entre le corps, l’esprit, l’autre. Le titre d’ailleurs est évocateur : Physiologie du goût, ou Méditations de gastronomie transcendante ; ouvrage théorique, historique et à l’ordre du jour, dédié aux gastronomes parisiens, par un professeur, membre de plusieurs sociétés littéraires et savantes. Le repas est un chemin vers le sublime et Brillat-Savarin prend soin d’ailleurs de ne pas en faire un moment où les moins fortunés seraient exclus du paradis, lui qui par ailleurs, n’est pas un grand régulier des messes et de la foi catholique.
Brillat-Savarin ayant quelques connaissances en médecine, il s’emploie à évoquer le corps de l’homme dans l’alimentation. Ces passages ne sont pas les plus fameux car de fait, il n’était pas réellement médecin et aujourd’hui, peu d’éléments résistent à nos connaissances du XXIème siècle. Il prend soin de ne pas mélanger la gourmandise avec la goinfrerie, il pourfend l’obésité quoi que lui-même n’ait sans doute pas évité cet état, il condamne cet empressement à manger sur le pouce.
La place de l’esprit se joue dans les constantes références littéraires qui émaillent le propos de Brillat-Savarin. Mais il ne s’agit pas de briller comme le ferait un élève soucieux d’impressionner en enfilant des citations. Le but n’est pas de créer une distance avec l’autre par l’étalage d’un savoir mais plutôt de partager des expériences positives, d’entamer une conversation plaisante et revigorante avec le lecteur. Il y a chez Brillat-Savarin, ce qui manque cruellement à notre époque : un sens de la légèreté, de l’autodérision, de la franchise sans méchanceté. L’esprit amène à l’autre car rien dans l’œuvre de l’auteur n’est le prétexte à un autoportrait satisfait. Brillat Savarin ne parle pas de ses malheurs, il en a eus, il ne met pas en avant ses différences comme une frontière face à ses interlocuteurs. Il est une illustration de ce sens de la conversation à la française. On sent d’ailleurs que dans l’écriture de cette biographie, Jean-Robert Pitte a voulu rendre hommage à son sujet en cultivant la même approche.
Avec une petite touche de tristesse toutefois, qui affleure dans quelques pages et qui était aussi présente durant la conférence à Blois. La nostalgie se fait même parfois inquiétude sur l’avenir. Témoin ce passage de la page 73 donné en guise d’avertissement et qui me servira de conclusion :
Pour que l’Aphorisme IV soit inscrit en épigraphe de l’imposant titrage de la Physiologie, il faut que ce soit l’un de ceux que préférait Brillat-Savarin : « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. » C’est aussi l’un de ceux qui ont connu le plus grand succès, bien qu’il s’agisse en réalité d’un poncif. On pourrait remplacer « ce que tu manges » par ce que tu lis, les peintres que tu aimes, les musiques que tu écoutes, les lieux où tu aimes séjourner, les hommes ou les femmes que tu fréquentes ou avec lesquels tu batifoles, le sport que tu pratiques, etc. […] Il aurait été plus subtil de placer en épigraphe l’Aphorisme III, qui, lui, ne va pas de soi : « La destinée des nations dépend de la manière dont elles se nourrissent. » Aujourd’hui, le contraste entre une nourriture quotidienne de plus en plus standardisée et une haute cuisine déjantée de chefs étoilés ayant perdu leur boussole ne laisse pas d’inquiéter quant au destin de la France, car cette perte du bon goût ne manquera pas de se répercuter dans les sphères de l’éducation, de l’économie, de la politique et, plus largement, de la créativité.
Une conférence de présentation du livre diffusée par l’Institut de France

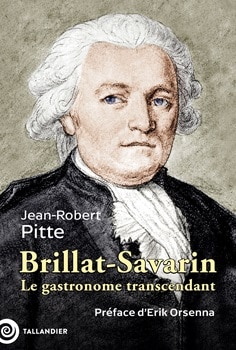
![couverture La revue Parlement[s], Revue d’histoire politique](https://clio-cr.clionautes.org/wp-content/uploads/cliotheque/2023/08/parl2-038-204x264.jpg)