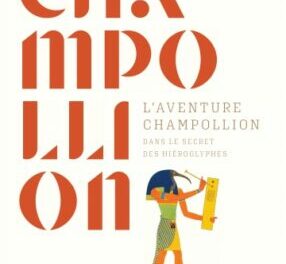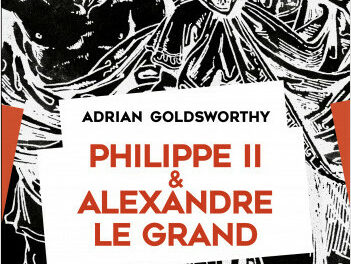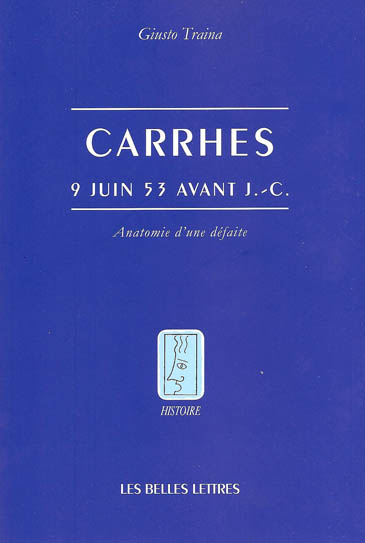
Le 9 juin de l’année 53 avant Jésus-Christ (correspondant au 6 mai de notre calendrier actuel, le calendrier traditionnel romain encore utilisé à l’époque accusant un décalage croissant avec les saisons qui allait conduire à son remplacement par César quelques années plus tard), une armée romaine d’au moins 40 000 hommes conduite par le proconsul Marcus Licinius Crassus, partie à la conquête de l’empire parthe, subit dans la région de Carrhes (aujourd’hui Harran, au sud-est de l’actuelle Turquie) une cuisante défaite devant une force inférieure en nombre de cavaliers iraniens et arabes, prélude à sa dissolution et à l’un des premiers grands coups d’arrêt donné à l’expansion de Rome. Ce désastre, qui devait marquer durablement la mémoire romaine, reste aujourd’hui relativement peu connu. Il n’est, comme l’ensemble du conflit qui devait suivre (de façon plus ou moins ouverte jusqu’à ce qu’Auguste y apporte une solution diplomatique en –20, puis par intermittence tout au long de l’histoire des deux empires) guère abordé par l’historiographie, particulièrement l’historiographie francophone (on se permettra néanmoins, au titre d’un clin d’oeil un peu facile, de renvoyer le lecteur intéressé à l’étude suivante qui, bien que menée avec un grand sérieux et ayant demandé beaucoup de recherches, ne peut évidemment avoir par la forme, les conditions de la publication et certaines modifications apportées au texte original la prétention de rivaliser avec un travail universitaire, mais peut constituer une première approche du conflit initial : http://www.net4war.com/champsdebataille/numeros-cdb-thema/thema11.htm). Aussi l’impute t-on généralement à quelques lieux communs : ambition démesurée de Crassus, corrélée à de grosses insuffisances militaires, omniprésence et insaisissabilité de l’archer monté parthe. On ne peut donc qu’accueillir avec un vif intérêt l’étude que l’historien G.Traina y consacre dans le présent ouvrage, initialement publié en Italie en 2010.
Passé par les universités de Pérouse et de Lecce, celles de Rouen, Paris VIII et Louvain, Giusto Traina enseigne aujourd’hui l’histoire romaine à l’université Paris Sorbonne-Paris IV. Il s’est spécialisé dans l’étude des paysages et des techniques antiques, avant d’accorder un intérêt croissant à l’Arménie ancienne, à différents aspects de laquelle il a consacré plusieurs travaux. Le vieux royaume constituait déjà le point de départ d’un précédent, et fort réussi, ouvrage de l’auteur déjà traduit aux Belles Lettres (428, une année ordinaire à la fin de l’empire romain). On comprendra mieux le cheminement qui mena l’historien jusqu’à la sanglante plaine de Carrhes en rappelant que, par sa situation géographique, l’Arménie antique allait se voir, du Ier s.av. au Vè ap.J.-C., soumise aux influences et aux ambitions de ses deux puissants voisins – et ainsi se trouver, entre autres, impliquée dans leur première grande confrontation.
Sagittiferos opposés au « pire général de tous les temps » ?
L’approche utilisée par l’auteur vis-à-vis de celle-ci est à la fois concise et profonde. Son premier chapitre est particulièrement pertinent, restituant à traits rapides mais précis le contexte de la bataille, évoquant en particulier cette Rome républicaine finissante en proie aux ambitions antagonistes des grands imperators. Il livre d’entrée de jeu une lecture nuancée des événements, éclairée par les dernières avancées de la recherche, et qui remet en cause quelques poncifs généralement accolés à Crassus. Bien avant l’arrivée du proconsul en Syrie, la guerre contre les Parthes était ainsi en gestation à Rome, et elle faillit être menée par son prédécesseur Gabinius. Crassus était certes affligé de quelques défauts ; mais, le caractère exceptionnel de sa richesse mis à part, il ne déteignait pas parmi les puissants de son temps, dans un climat politique marqué par le clientélisme, la radicalisation, l’absence de scrupules, une rationalité et une personnification croissantes. L’important corps expéditionnaire romain prend l’offensive en Mésopotamie en –54 ; pareillement, pour l’auteur, deux des reproches qui seront ensuite adressés à Crassus doivent alors être relativisés. La pause imprimée aux opérations à l’automne suivant peut aisément s’expliquer par la nature du terrain et la volonté de rassembler fonds et moyens ; son choix de reprendre ensuite la progression dans cette même région malgré les objurgations du roi Artavasdès d’Arménie, apparaît tout à fait défendable stratégiquement parlant.
En ce jour fatal du printemps 53, l’armée romaine se retrouve donc aux environs de Carrhes en présence d’une force essentiellement montée mais quelque peu composite menée par un grand personnage de l’empire parthe, le Suren. L’auteur consacre une quinzaine de pages du troisième chapitre de l’ouvrage au récit de la bataille qui s’ensuit, arguant que les carences des sources (Plutarque et Dion Cassius essentiellement) laissent de toute façon beaucoup de place à l’hypothétique, ce qui est indéniable. Sa reconstitution des événements pourra parfois faire naître un peu de scepticisme (qu’une dernière attaque « dévastatrice » des cataphractes parthes ait mis en « déroute » les légionnaires reste à mon sens douteux), mais permet de faire ressortir l’essentiel : loin de ne découler que des carences militaires des Crassus père et fils (bien réelles), la victoire parthe semble avant tout due au grand talent du Suren, qui avait bien pris, lui, la mesure de l’ennemi qui lui était opposé, et qui sut utiliser intelligemment l’outil militaire à sa disposition, jouant parfaitement de la complémentarité justement soulignée par l’auteur entre entre sa cavalerie de contact (les cataphractes lourdement cuirassés) et celle de harcèlement (les archers à cheval).
L’étude de la bataille se clôt sur une dernière partie consacrée à son destin historiographique dans l’Antiquité. Cette remise en perspective des écrits l’ayant abordée en fonction du contexte de l’époque de leur rédaction est fascinante, et permet de comprendre bien des choses quant aux interprétations qui en furent issues.
« Anatomie d’une défaite »
Avec cet ouvrage relativement court (le récit proprement dit s’étend sur 148 pages), G.Traina livre donc un texte qui réussit le tour de force d’allier un style prenant et accessible à une approche détaillée. On l’aura en effet compris, tous les arrière-plans de la bataille, historiques, politiques, militaires, culturels… sont abordés. Une impressionnante bibliographie (p.179-211), à laquelle renvoient quasi-systématiquement de riches notes (p.149-178), démontre le caractère poussé de la réflexion de l’auteur, et son impressionnante érudition. Toutes les mentions faites de l’événement dans les sources antiques sont prises en compte, et si on peut parfois s’interroger sur des points de traduction (ainsi cette interprétation étonnante donnée d’un passage de Dion Cassius à propos de ces « armes des Romains, qui, employées de manière trop intensive, finissaient par se rompre », p.79), on appréciera beaucoup, entre autres qualités, son utilisation de sources iraniennes et chinoises. Il fait preuve d’une ambition et souvent d’une maîtrise identiques en ce qui concerne les études critiques, se montrant particulièrement pertinent dans maints domaines. Sa prise en compte des mentalités de l’époque est réellement éclairante (on ne retiendra pour exemple que la discussion sur le sort réservé par les Parthes à la dépouille de Crassus). Le pinailleur pourra à l’occasion discuter ou relativiser tel ou tel point de l’analyse faite par G.Traina de l’aspect purement militaire des choses, mais celle-ci, qui intègre pareillement les intéressantes perspectives ouvertes par les travaux menés depuis une trentaine d’années sur le « visage de la bataille » et l’approche culturelle de la guerre, sonne globalement juste.
Procédant ainsi avec beaucoup de recul, replaçant les événements dans toute leur complexité, dépassant un occidentalo-centrisme dont il souligne par là même la prégnance tout en étant bien conscient des limites de l’exercice en l’état des sources, G.Traina va bien au delà des stéréotypes, et amène un regard neuf et bienvenu sur un épisode atypique. Par la même occasion, il met en évidence comment l’historiographie, et notre propre conception du monde, peuvent influer sur la vision conservée d’un fait historique.
Ce sain rappel n’est pas la moindre des qualités d’un ouvrage dont l’attrait est encore renforcé par la présence de quelques belles illustrations, de trois cartes et d’un index détaillé. Assurément, il devrait dorénavant trouver une place de choix dans les bibliothèques de tout amateur d’histoire militaire, et pourra plus généralement donner à réfléchir à tous ceux qui se passionnent pour la connaissance de l’Antiquité.