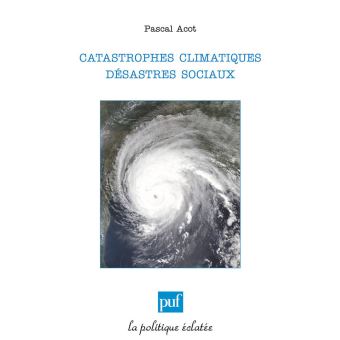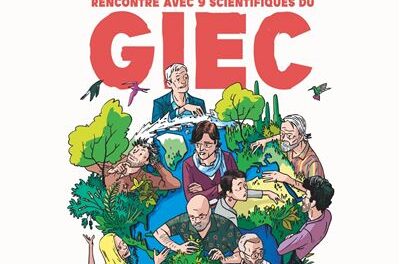Comme tout bon scientifique, Pascal Acot part de faits et multiplie les sources. La canicule de l’été 2003 a tué 14802 morts (officiels). Parmi ceux-là, son père. Interrogeant un employé des pompes funèbres à la fin juillet de cette année sinistre, il s’entend répondre « en ce moment il y a plus de morts que d’habitude à Mont-de-Marsan ». Ce constat est le prélude à une mise à plat de la chronologie de la gestion de cet épisode, et la construction d’une argumentation imparable : incurie des administrations, incompréhension des experts en place, incompétence du politique. Partant de cet état, Acot remet en perspective cet événement climatique et ses conséquences sociales par rapport aux acquis de la science, aux capacités de nos sociétés à les comprendre, les accepter et y réagir. Pour lui, « il n’y a pas de catastrophes climatiques », il n’y a que des conditions sociales qui deviennent catastrophiques par incapacité à les gérer. El Niño, les taches solaires, les cratères de météorites sont ensuite autant d’exemples, expliqués avec clarté et passion, pour démontrer l’incapacité à prévoir les catastrophes malgré notre capacité à comprendre ces phénomènes. Que peut le scientifique sinon alerter d’un phénomène potentiel ? Que peuvent les populations si les moyens ne leur sont pas accordés de comprendre ce que disent les scientifiques ?
Quelle est la catastrophe en cours la plus évidente et la moins bien gérée ? L’accentuation de l’effet de serre. Dans une dizaine de pages serrées, claires comme une argumentation juridique, Acot raconte l’histoire des sciences atmosphériques, les moyens et méthodes de ceux qui mesurent le climat, leurs oppositions, leurs clivages, leurs coopérations dans la compréhension du climat des temps passés (de belles pages émues sur les forages internationaux dans l’Antarctique, qui ont permis de comprendre les variations anciennes des températures). Mais que sont les scientifiques si les politiques ne les relaient pas ? Les réactions du G7, de l’OCDE, de groupes d’experts, reprises et parfois caricaturées par les médias, quand elles ne sont pas, pour Pascal Acot, caricaturées dès l’origine pour des raisons économiques. L’auteur n’aime pas les institutions internationales chargées de faciliter la libéralisation des échanges, n’aime pas la toute-puissance des lobbys qui selon lui noyautent les Agences internationales, n’aime pas que les grandes puissances se désintéressent des petites mais s’en prévalent pour faire reculer les décisions de lutte contre l’effet de serre, et là on aurait aimé une argumentation plus solide sur la place nouvelle de la Chine, sur la volonté des pays émergents de ne pas respecter les protocoles internationaux, et pas seulement une charge – classique et orientée – contre le grand consommateur nord-américain et les « organisations puissantes et discrètes » qui propagent ses intérêts néo-libéraux. Ca fait un peu théorie du complot, au milieu d’explications scientifiques crédibles et claires de mécanismes scientifiques complexes.
Pascal Acot est en revanche bien plus intéressant lorsqu’il énonce des faits. Reprenant l’exemple du cyclone Katrina et de ses effets, multipliant les sources scientifiques, il en explique le phénomène, et s’interroge sur les capacités de nos sociétés occidentales à répondre à de tels phénomènes. Et l’essayiste reprend le dessus : « ils mondialisent l’économie alors qu’il faudrait la déglobaliser et ils délocalisent les activités agro-industrielles, alors qu’il faudrait les relocaliser » (p.141). La mise en question es énergies renouvelables est plus intéressante pour le lecteur : qu’est-ce qu’une énergie renouvelable ? Quelle est l’efficacité des techniques qui s’en prévalent ? Où installer des parcs off-shores d’éoliennes ? L’énergie solaire semble idéale mais son recours massif est « illusoire » sans hauts rendements ; et les moteurs à eau ? La biomasse ? Toutes ces solutions sont viables dans les pays développés qui ont les moyens d’une énergie multidirectionnelle. Mais les pays dits du Sud ont un besoin massif, peu cher en infrastructures, et prolongé, de ces énergies : « la seule solution énergétique réaliste immédiatement est celle de l’électronucléaire civil » (p.150).
Et le développement durable ? « Expression galvaudée » que chacun met en scène, politique inutile si elle ne s’accompagne pas de choix énergétiques et politiques clairs comme la remise de la dette des pays pauvres, l’abandon du surarmement, le contrôle par les pays de leurs ressources indigènes, la mise en place d’une « rationalité économique aux antipodes du libéralisme actuellement dans l’air du temps » (p.156). Pascal Acot prend un certain plaisir à détruire « l’illusion scientiste » qui accable les opposants à ces choix, lorsqu’ils développent l’idée des constructions HQE (Haute qualité environnementale), d’alliances industrielles pour le recyclage systématique ou l’emploi de nouvelles technologies renouvelables. Si ces idées sont intéressantes – et à la mode – elles ne sont pas une solution de long terme, relevant plus d’une nostalgie de l’état de nature que de solutions applicables à grande échelle. Alors que peut faire le politique qui se soucie d’écologie ? Surtout pas de « l’écologisme » comme il définit les intégristes d’une « idéologie écologiste » qui considère l’être humain comme destructeur et corrupteur de l’harmonie naturelle du monde, et s’attaque plus aux petites gens qu’aux entreprises et aux Etats les plus riches. Acot dans un long passage s’attaque alors aux liens qui « unissent l’oligarchie politico-financière et certaines grandes organisations écologistes » (p.164), n’épargnant ni les ONG ni les partis politiques ni les médias.
Partant de faits précis, historiquement et scientifiquement bien expliqués – y compris pour le lecteur néophyte – Pascal Acot dresse ici pourtant un brûlot anti-libéral, un discours de combat parfois empreint d’une certaine naïveté. Mais que propose-t-il ? Une « écologie de la libération », comme une nouvelle théologie de nos relations à la nature. Dressant un bilan des dernières réunions internationales qui visent moins à réduire l’effet de serre qu’à se préparer à un réchauffement climatique impossible à maîtriser, il reprend en les approuvant les propositions de l’ONU : mise en place d’un programme international sur les énergies renouvelables, plan mondial pour l’eau potable, plan de protection des forêts, système juridique international pour pénaliser les entreprises polluantes, augmentation de l’aide aux pays en voie de développement à la hauteur de 0.7% du PIB (un doublement) ; annulation des dettes publiques et privées des pays pauvres.
Pascal Acot ne traite que trop rapidement des questions essentielles annoncées dans le titre de son ouvrage: quels sont les objectifs des sociétés dans leur utilisation de la nature ? Le bonheur est-il compatible avec la durabilité des ressources ? Quelle est l’essence des relations qui existent entre l’homme et la nature ? Citant Marx et Feuerbach, Acot plaide pour une inversion de notre idée de l’écologie : ce n’est pas en améliorant l’état de notre environnement que les rapports sociaux seront plus justes mais parce que nos rapports sociaux sont plus justes que notre environnement s’améliore. Là encore, le lecteur reste circonspect et frustré de banalités qu’on aurait voulues plus argumentées, surtout s’il connaît les travaux anciens de René Dumont et la littérature écologique de ces vingt dernières années. Il pourra toujours compléter sa lecture par certains passages du très intéressant Philippe Descola, Par-delà nature et culture (Gallimard 2006), qui repose une partie de ces questionnements sous un angle historique et philosophique.
Un ouvrage à lire, mais seulement si l’on cherche des explications aux mécanismes historiques et techniques du climat, et qui peuvent ainsi être très utiles pour la géographie des risques comme celle de l’atmosphère.
Pascal ACOT, Catastrophes climatiques, désastres sociaux, Paris, Puf, coll° « la politique éclatée », avril 2006, 205 p.
© Clionautes, 2006