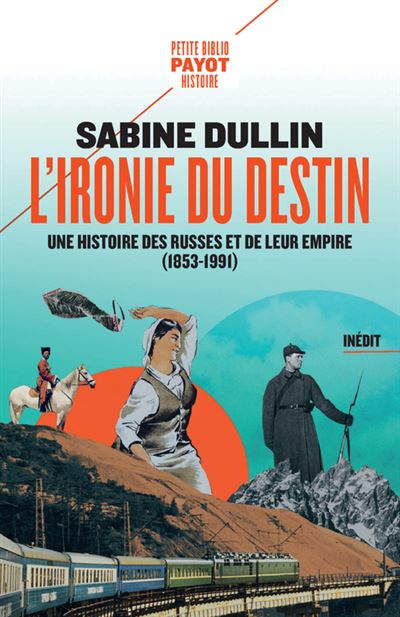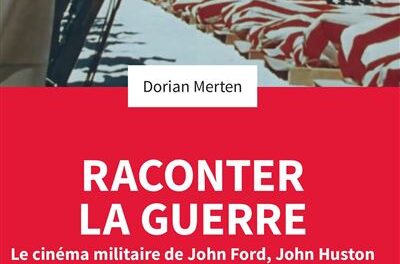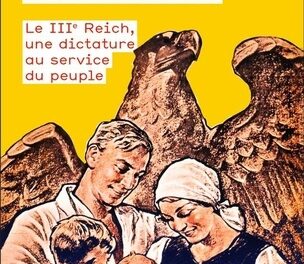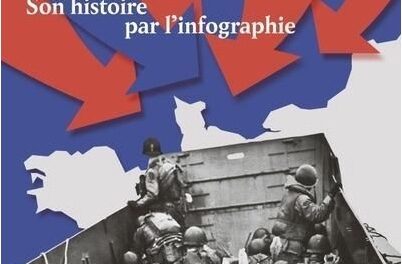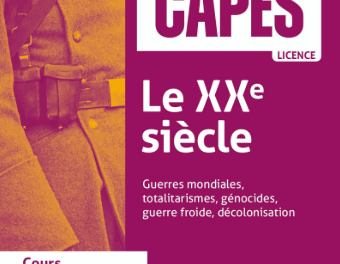Compte rendu réalisé par Daphné Leloup, étudiante en hypokhâgne (2024-2025) au lycée Claude Monet de Paris, dans le cadre d’une initiation à la réflexion et à la recherche en histoire.
Présentation
Sabine Dullin est une historienne française spécialisée dans l’histoire de la Russie et de l’Europe orientale, de la Guerre froide, du communisme et des relations internationales au XXe siècle. Ancienne élève de l’École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, agrégée d’histoire, elle partit vivre en Russie deux ans pour travailler dans de nombreux centres d’archives de l’ex-Union soviétique, dont ceux de Moscou et Kiev. Cela lui permit de rédiger son premier ouvrage, l’Histoire de l’URSS, 1917-1991 (La Découverte, 1994), ainsi que sa thèse, soutenue en 1998, Diplomates et diplomatie soviétiques en Europe (1930-1939) : structures et méthodes d’une politique extérieure sous Staline, dirigée par René Girault. Elle approfondit, dans les années 2000, la question des élites soviétiques et de la politique internationale de l’URSS, puis consacra une part essentielle de ses recherches à la question des frontières, qu’elle aborde comme des objets politiques autant que symboliques. Bilan d’une série de cours sur la question des nations, empires et frontières, elle publia en 2021, six mois avant le début du conflit entre la Russie et l’Ukraine, son ouvrage intitulé L’Ironie du destin. Une histoire des Russes et de leur empire (1853-1991). L’ouvrage se compose de sept grands chapitres, chacun structuré autour d’une date clé. Ceux-ci sont précédés d’une note aux lectrices et lecteurs et d’une introduction et suivis d’une conclusion. Dans cette note liminaire, l’historienne clarifie des références culturelles russes, souvent peu familières au lectorat francophone. Dans son introduction, elle s’attache à mettre en lumière les paradoxes et les surprises de l’histoire russe. Elle interroge ce qui fonde, détruit puis reconstruit l’État en insistant sur l’importance de l’idéologie et de la culture politiques pour comprendre les réactions aux différents évènements dont certains ont fini par apparaître comme des ironies du destin. Dans sa conclusion, elle évoque comment, trente ans après la chute de l’URSS, l’autocratie, le rêve d’empire et la nation restent au cœur des dynamiques russes. Elle justifie son choix de commencer le récit, non pas au début du siècle soviétique, mais avec la guerre de Crimée, point de bascule décisif, pour en venir au présent où Vladimir Poutine puise dans le passé pour façonner son action politique, même si la « tradition » dont il se réclame est souvent en décalage avec les réalités des sociétés post-soviétiques.
Résumé
Le premier chapitre s’ouvre sur la défaite de la Russie lors de la guerre de Crimée, révélatrice des failles profondes de l’Empire tsariste. Sabine Dullin y explore les fondements idéologiques d’un pouvoir fondé sur l’autocratie, l’orthodoxie et la nationalité (narodnost’), où la centralisation extrême et la sacralisation du tsar justifient aussi bien l’expansion que l’exclusion. Les réformes d’Alexandre II semblent modernisatrices mais, en réalité, elles n’ébranlent jamais l’autocratie. L’autrice met en lumière une logique récurrente dans l’histoire russe : l’État réforme pour survivre et non pour s’ouvrir. Animée par une obsession territoriale, la Russie avance par grignotage, tiraillée entre fantasmes de grandeur et insécurité permanente. À l’ouest, l’idéologie panslave nourrit un désir de revanche et de grandeur face aux défaites subies.
À la veille du XXe siècle, l’Empire russe affronte une contradiction majeure : comment un empire multinational, fondé sur l’autocratie et l’expansion, peut-il devenir un État moderne fondé sur la représentation, la réforme et l’intégration ? Face à l’hétérogénéité, le pouvoir choisit la russification plutôt que l’intégration, renforçant la domination dans les marges et marginalisant les minorités, notamment les Juifs exposés à des pogroms tolérés, voire encouragés. La révolution de 1905 mène à la création d’une Douma sans réelle démocratisation, révélant l’incapacité du régime à trancher entre réforme et autoritarisme. Prisonnière d’un modèle autoritaire, la Russie entre dans la Première Guerre mondiale sans avoir surmonté ses tensions internes, précipitant la chute du régime.
1917 marque une rupture radicale en Russie, une triple « table rase » politique, sociale et territoriale, mais Sabine Dullin montre que, derrière la chute du tsarisme et l’arrivée des bolcheviks se rejouent les logiques impériales. Après la révolution de Février, une brève parenthèse démocratique s’ouvre avec le gouvernement provisoire, vite discrédité par son refus de quitter la guerre. Lénine, de retour en avril, impose une ligne radicale. La révolution accouche d’un nouvel autoritarisme, les soviets sont détournés et les périphéries brièvement indépendantes sont rapidement reconquises. Le projet révolutionnaire, fondé sur l’égalité sociale, s’impose par la violence politique et la guerre civile. Dullin souligne que l’empire change de forme mais pas de logique de puissance et d’unité.
À la mort de Lénine en 1924, l’URSS naissante hésite entre fédéralisme multinational et centralisation autoritaire. Sabine Dullin revient sur cette tension fondatrice, marquée par une brève ouverture culturelle et nationale dans les années 1920, qu’elle qualifie de « printemps des peuples soviétiques ». Mais l’arrivée de Staline au pouvoir transforme radicalement le régime. Sous une façade d’unité idéologique, l’URSS devient un empire centralisé et répressif dans lequel les anciens héros de la révolution deviennent des ennemis, les koulaks des saboteurs, les nationalistes des déviationnistes et les étrangers des traitres potentiels. Les élites locales sont éliminées et les républiques sont placées sous surveillance. Les innovations soviétiques en matière de culture, d’éducation et de genre restent marginales, freinées par une société encore profondément patriarcale. La promesse révolutionnaire s’efface au profit d’un autoritarisme sacralisé.
Dans les années 1930, Sabine Dullin retrace le virage autoritaire et brutal de l’URSS stalinienne, marquée par l’industrialisation forcée, les famines catastrophiques, la répression de masse et le contrôle total de la société. Tandis que les purges déciment les élites, la politique impériale se poursuit à l’extérieur, culminant avec le pacte de non-agression avec l’Allemagne nazie en 1939. L’autrice souligne l’ironie historique « le régime soviétique qui avait dénoncé les traités secrets du tsarisme en octobre 1917 signe l’accord le plus impérialiste qui soit et avec un nazi ! ». Après l’invasion nazie en 1941, la victoire de 1945 consacre l’URSS comme grande puissance militaire et géopolitique mais au prix d’une violence contre certains peuples accusés de collaboration, punis collectivement par des déportations massives.
Entre 1945 et 1979, Sabine Dullin explore le paradoxe d’un empire soviétique à son apogée géopolitique mais rongé par ses failles internes. Après la mort de Staline, la déstalinisation partielle ne suffit pas à réformer un système figé. Tandis que Moscou impose son modèle aux républiques soviétiques et aux démocraties populaires, les cultures locales sont étouffées, les oppositions réprimées et le fossé entre le discours de modernité et la réalité quotidienne ne cesse de grandir. Le rêve internationaliste se heurte aux murs de la frontière, les républiques soviétiques renforcent leur autonomie, posant les bases d’une désagrégation future.
Dans son dernier chapitre, Sabine Dullin retrace l’effondrement de l’URSS, précipité par les réformes de Gorbatchev à partir de 1985. La perestroïka (restructuration économique), la glasnost (libération de la parole), et la novoe myshlenie (nouvelle pensée), loin de sauver l’URSS, accélèrent l’effondrement. Alors que la parole se libère, que les Républiques réclament leur autonomie et que la Russie d’Eltsine défie le pouvoir fédéral, l’Union soviétique s’effondre sur elle-même. Le putsch raté de 1991 scelle la fin du régime, le drapeau rouge est abaissé au Kremlin et Gorbatchev lit son discours d’adieu. L’URSS disparaît, et une nouvelle Russie naît, persuadée d’avoir enfin rompu avec l’Empire.
Appréciations
Sabine Dullin s’inscrit dans une historiographie qui cherche à renouveler l’étude de l’URSS en dépassant les oppositions classiques entre lecture totalitaire et lecture révisionnistes du régime. Elle adopte une approche de comparaison intéressante entre l’Empire tsariste et l’URSS soulignant les continuités profondes avec le tsarisme, notamment dans les logiques de centralisation, de contrôle et d’expansion. Cette approche historique nous permet d’approfondir notre compréhension de l’histoire russe et d’en saisir les prolongements contemporains, principalement en ce qui concerne les actions et les intentions de la Russie tant dans ses relations avec ses voisins que sur la scène internationale.
Sabine Dullin parvient à allier une connaissance approfondie et méthodique et une narration accessible, notamment grâce à l’explication des notions spécifiques et à la mise en contexte au début de l’ouvrage, le rendant pertinent tant pour les spécialistes que les amateurs d’histoire. Bien que le livre soit riche en informations et en analyses, la lecture de l’œuvre se révèle aisée de par sa structure en chapitres à la fois chronologique et thématique, dotés chacun d’une introduction et d’une conclusion, qui nous permet de suivre le raisonnement de l’historienne.
Ce qui enrichit particulièrement la lecture, c’est la diversité des sources mobilisées, archives, travaux historiographiques, mais aussi œuvres littéraires et artistiques. Sabine Dullin n’hésite pas à faire appel à la culture pour illustrer son propos de manière plus concrète. Ces références, bien que secondaires par rapport à l’analyse historique centrale, offrent un éclairage précieux sur les perceptions et les sensibilités propres aux époques étudiées, invitant aussi le lecteur à approfondir sa réflexion. Le récit reste cependant très centré sur les structures étatiques, les choix idéologiques et les dirigeants, ce qui laisse de côté la diversité des expériences sociales, le quotidien des populations, ou encore les formes de résistance « par le bas » sont moins explorées. On pourrait attendre davantage d’éléments sur la société civile, les femmes, les minorités hors du prisme étatique.