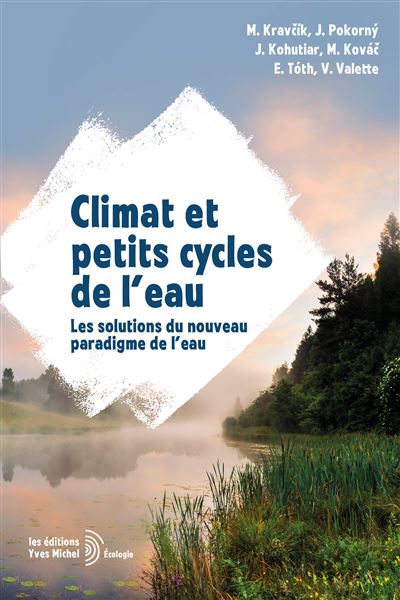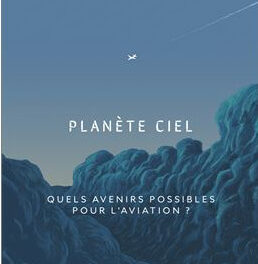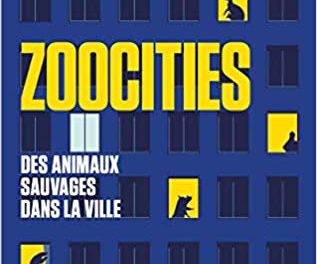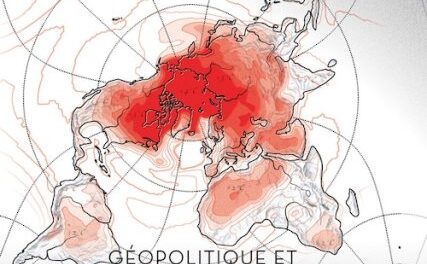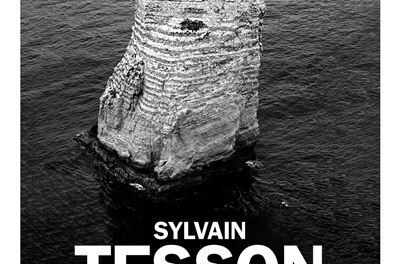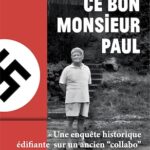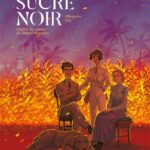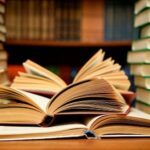Un groupe d’hydrologues et de chercheurs slovaques et tchèques dirigés par Michal Kravčík, propose une nouvelle approche du changement climatique en partant du cycle de l’eau. Cette vision nouvelle permet non seulement de comprendre de nombreux phénomènes, mais aussi de proposer des solutions.
L’ouvrage est paru en 2007 The New Water paradigmeen accès libre sur le site web de waterparadigm.org. Les cycles de l’eau sont pour les auteurs un angle mort de la compréhension du changement climatique. L’artificialisation des sols met en panne la « pompe biologique », car le trop-plein d’énergie solaire n’est plus assez évacué sous forme de vapeur d’eau. Cet ouvrage plaide pour une renaissance des écosystèmes de « végétation sauvage ».
En de courts paragraphes : chacun une idée, ce petit livre est facile à lire, c’est un bon ouvrage de vulgarisation.
La genèse d’un nouveau paradigme de l’eau
Ce premier chapitre introductif rappelle les différentes conceptions de l’eau depuis l’antiquité et leurs implications en termes de gestion de l’eau.
L’eau et son cycle dans la nature
Voilà un rappel utile des environnements de l’eau : océans, terre, atmosphère, mais aussi l’eau interne aux êtres vivants. La description porte sur les relations eau/énergie et le rôle de l’eau dans l’équilibre des températures et dans les processus d’épuration. On retrouve une description du grand et du petit cycle de l’eau.
À noter un paragraphe sur l’équilibre hydrique dans un bassin-versant.
Le rôle des plantes dans la circulation de l’eau et la transformation de l’énergie solaire
Une vulgarisation nécessaire et clairement exprimée. On trouve, dans ce chapitre, les définitions de l’albedo, de la chaleur ressentie, la description de l’évapotranspiration diversifiée des végétaux et le rôle de la végétation comme moyen de tempérer le climat.
L’impact de l’exploitation des terres sur le cycle de l’eau
La déforestation a commencé dès la Préhistoire. Les auteurs en rappellent les grandes étapes. Ils abordent ensuite le développement de l’agriculture et ses effets : érosion, perte de capacité de rétention de l’eau.
Les hommes ont aussi, depuis l’Antiquité, modifier plus ou moins fortement les réseaux hydrographiques (exemple slovaque) pour l’agriculture ou l’approvisionnement des villes. Enfin l’artificialisation, l’imperméabilisation des sols à l’époque contemporaine accélèrent l’écoulement des eaux de surface et affectent le petit cycle de l’eau.
Les répercussions d’une diminution du volume d’eau dans le petit cycle
L’intensification du ruissellement entraîne une spirale de dessèchement des terres par saturation de la couche arable. Le drainage favorise des îlots de chaleur. L’ensemble modifie le volume d’eau dans le cycle hydrologique local, déplace les précipitations (schéma p. 119) et favorise les conditions météorologiques extrêmes. Une autre conséquence de l’augmentation du ruissellement est l’élévation du niveau des océans. Les auteurs appuient leur raisonnement sur l’exemple slovaque. L’aggravation du climat va entraîner une augmentation de la consommation de l’eau et des tensions accrues.
Intéressant tableau : les raisons et les conséquences d’une diminution de l’eau du petit cycle hydrologique (p. 140).
L’ancien et le nouveau paradigme de l’eau
Dans l’ancien paradigme, les hommes avaient foi en la science et le progrès, une humanité capable de dominer la nature. Pourtant, des fissures apparurent avec la diminution des réserves en eau souterraine et en parallèle une augmentation des températures moyennes.
La science étudie le climat sans intégrer l’étude des mécanismes de la vapeur d’eau émettrice de chaleur dans la partie haute de la troposphère.
Les auteurs proposent un nouveau paradigme reposant sur l’équilibre hydrique permanent.
L’aridification des terres touche des espaces plus vastes : ces « plaques chaudes » déstabilisent le cycle de l’eau. Il semble nécessaire de revenir aux techniques anciennes de collecte et de conservation des eaux de pluie qui favorisent l’infiltration dans les sols. Ceci qui limiterait les inondations. Cela impose une nouvelle culture responsable de l’utilisation de l’eau.
Pour les auteurs, l’augmentation des épisodes météorologiques extrêmes est plus dommageable que la hausse des températures. La comparaison des effets des deux paradigmes est synthétisée dans un tableau (p.165-168).
Support institutionnel à l’utilisation des eaux de pluie
Partant d’une description des méthodes de récupération et de conservations des eaux de pluie à travers l’histoire, en Slovaquie, ce chapitre décrit les solutions techniques et biologiques fondées sur la nature ainsi que les mesures de prévention.
Sont aussi abordées les actions possibles pour les citoyens, les associations, les propriétaires terriens, les partenaires socio-économiquesC’est un secteur porteur d’emplois, les assurances et l’État et les collectivités locales. Les auteurs proposent un chiffrage des coûts des différents scénarios.
Synthèse
Un court chapitre qui reprend les principales démonstrations de l’ouvrage.
Restauration des petits cycles de l’eau à l’échelle mondiale
Les solutions envisagées aux précédents chapitres imposent une modification en profondeur de l’agriculture industrielle. Les perspectives démographiques viennent poser la question cruciale : qui nourrit et comment ? Les auteurs voient une solution dans l’agroécologie et la restauration écologique des écosystèmes.
Si le pronostic est sévère, l’ouvrage est pourtant optimiste.