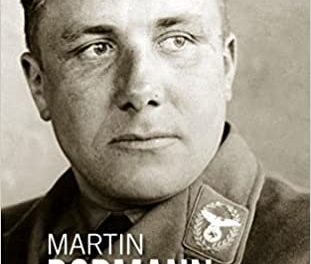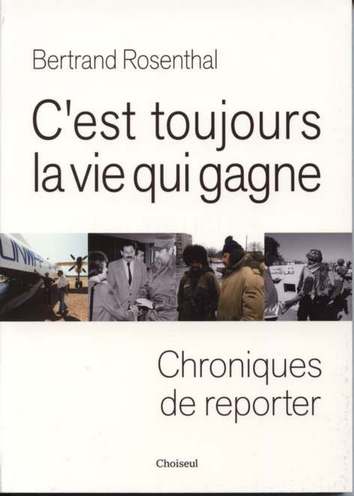
Bertrand Rosenthal fait partie de ces journalistes baroudeurs, de ceux que l’on voit au journal de 20 h, mal rasés, avec un gilet reporter, sur tous les terrains de conflit, où ils peuvent intervenir. Journaliste-reporter pour l’Agence France-Presse en Irak, en Afghanistan, au Soudan, en Haïti, Bertrand Rosenthal raconte quelques-unes de ses aventures, parce que c’est bien de cela qu’il s’agit.
Du Tchad au Mexique, de la Tchétchénie au Kenya, en Afghanistan comme en Irak, de 1981 à 2009, Bertrand Rosenthal a multiplié les reportages, comme journaliste d’agence, celui qui envoie des informations brutes, largement reprises par les journaux qui n’ont pas forcément les moyens d’envoyer un correspondant sur place. L’état de la presse écrite en France, comme ailleurs, rend d’ailleurs ce type de situation de plus en plus fréquente. La dépêche d’agence obéit à un genre très particulier, celui d’une écriture concise, avec des textes rigoureusement informatifs, qui laisse peu de place aux commentaires.
Peut-être que ce livre qui relate près de 30 ans de pratique journalistique est de mettre en scène celui que était derrière les dépêches d’agence.
Il raconte d’ailleurs comment, dans la Roumanie de Ceaucescu, comment il a été aux prises avec une certaine V., mandatée par le régime pour influer jusque dans la couche du correspondant, sur la nature du reportage.
Ce que le journaliste raconte, au-delà de quelques anecdotes souvent drôles, mais parfois tragiques, c’est la fabrication de l’information. Comment son regard se pose sur les événements et les hommes dans des situations le plus souvent difficile. En Tchétchénie, on s’arrête avec l’auteur aux différents barrages de l’armée russe. Dans son texte qu’il titre : « une guerre de voyous», Bertrand Rosenthal se retrouve sous le feu lors des bombardements de Grozny en 1995.
On est très loin ici de cette image aseptisée du journalisme que l’on peut voir sur les écrans de télévision. En mai 1998 Bertrand Rosenthal accompagne le secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, dans une tournée en Afrique de l’Est. De Tanzanie au Burundi de Khartoum à l’Érythrée jusqu’au Kenya, Bertrand Rosenthal a été en contact direct avec le secrétaire général des Nations unies qui doit gérer à cette époque 14 conflit sur les 53 pays du continent. Réaliser ce périple en Afrique de l’Est, seulement quatre ans après le génocide de 1994, c’est aussi mesurer les cicatrices terribles qui ne se sont pas refermées. Images de misère, de barrages militaires ou de miliciens en armes, vision d’enfants soldats et d’orphelins, tel est le sentiment de honte qui anime l’auteur, car au final, il a bien conscience de l’impuissance de la sécurité collective à prévenir les pulsions meurtrières de ceux qui dirigent les groupes armés qui font peu de cas des règles démocratiques, même s’ils ont parfois l’outrecuidance de s’en réclamer.
Au Soudan, entre 1998 et 2000, au sud du pays dans la région frontalière avec l’Ouganda, le Kenya et l’Éthiopie, l’urgence permanente s’est installée. Il faudra attendre 2010 pour que le Sud Soudan après des négociations et plusieurs arbitrages internationaux puisse se prononcer en faveur de son autodétermination. Mais la situation est loin d’être stabilisée à l’heure où nous écrivons ces lignes, tant les enjeux pétroliers et les manœuvres des grandes puissances, sont encore présents. L’enfer pavé de bonnes actions, tel est le titre de l’article qui est consacré à cette région du monde. Parce que ce que Bertrand Rosenthal remet en cause ici c’est la manipulation des bons sentiments, quand ce n’est pas la manipulation médiatique, politique et militaire qui entoure ce que l’on appelle le Charity bizness. Les organisations non-gouvernementales à vocation humanitaire comme médecins sans frontières, se retrouvent bien malgré elles au centre de ces enjeux qui sont tout simplement le droit de vie et de mort sur les populations en raison des détournements des aides humanitaires opérés à une échelle de masse.
Encore une fois, la connivence, la complicité, l’avantage mutuel, entre les humanitaires et les journalistes sont ici évoqués. Ce n’est pas un hasard si Bertrand Rosenthal fait référence à l’article de Sylvie Brunel qui parle en 2000 de la famine manipulée. Cette famine manipulée c’est celle qui permet le détournement de l’aide, l’instrumentalisation des organisations humanitaires, ce qui s’est passé en Afghanistan, pendant la période de l’occupation soviétique.
Entre 1998 et 2000, Bertrand Rosenthal suit ce qu’il a appelé la «guerre de 14-18» dans la corne de l’Afrique, une véritable guerre de tranchées entre l’Éthiopie et l’Érythrée. L’auteur voit d’ailleurs dans ce conflit une opposition entre deux hommes, l’Éthiopien Meles Zenawi, qualifié d’ancien marxiste reconverti à l’économie de marché, et le président érythréen Issayas Afeworki. La dimension personnelle est certainement présente dans ce conflit.
En septembre 2002, Bertrand Rosenthal est en Afghanistan, il assiste au début de cette intervention provisoire des forces de l’OTAN, provisoire qui dure encore au moment où nous écrivons ces lignes. Bertrand Rosenthal circule moto avec une 125 cc. La capitale est martyrisée. Les carcasses de blindés rappellent de vieux combat, mais la présence occidentale n’a finalement rien changé. On le sait aujourd’hui la corruption, le contrôle du trafic de drogue, sont devenus les ressorts du gouvernement Kharzaï, soutenu à bout de bras par les Occidentaux, qui se sont littéralement piégés dans le bourbier afghan.
Le seul problème aujourd’hui c’est que le retrait serait tout aussi coûteux que le maintien de cette présence qui permet tout au plus de circonscrire les effets déstabilisants de l’intervention militaire occidentale.
Au détour de ces images dramatiques, de cette rage que donne le sentiment d’impuissance de l’observateur qui ne peut que raconter, Bertrand Rosenthal rappelle que c’est toujours la vie qui gagne. Au milieu des guerres, des catastrophes naturelles, dans les dictatures, on rit aussi, on s’aime, on parle d’avenir. Mais le bonheur quotidien n’intéresse pas beaucoup les gazettes. Pourtant les survivants ont un désir de vie extraordinaire et ils en savent mieux la valeur que tout autre. C’est peut-être là que se situe le message de cet auteur qui se libère de l’écriture de l’agencier, pour s’indigner, se révolter, porter un regard ravageur sur ses fonctionnaires des Nations unies qui au milieu de la misère émargent à 30 000 $ par mois.
Belle leçon de journalisme que celle de ce reporter qui a toujours avec lui son sac minimum: couteau suisse, aliments énergétiques, un livre à lire quand même, et filtre pour rendre l’eau potable. Il y a aussi et surtout dans ce qui a pu animer Bertrand Rosenthal pendant sa carrière, cette volonté de comprendre, ce démon du savoir et du dire, qui n’en finit pas, encore aujourd’hui, de le tourmenter.
Bruno Modica ©