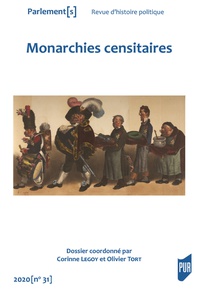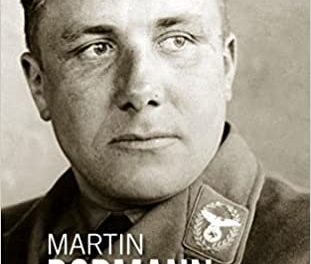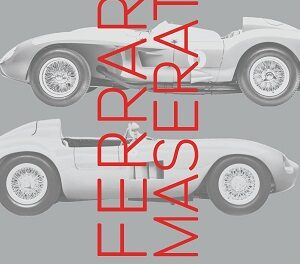La revue Parlement[s]
Créée en 2003 sous le titre Parlement[s], Histoire et politique, la revue du CHPP change de sous-titre en 2007 pour affirmer sa vocation à couvrir tous les domaines de l’histoire politique. Chaque volume est constitué pour l’essentiel d’un dossier thématique (partie Recherche), composé d’articles originaux soumis à un comité de lecture, qu’ils soient issus d’une journée d’études, commandés par la rédaction ou qu’ils proviennent de propositions spontanées. Quelques varia complètent régulièrement cette partie. La séquence (Sources) approfondit le thème du numéro en offrant au lecteur une sélection de sources écrites commentées et/ou les transcriptions d’entretiens réalisés pour l’occasion. Enfin, une rubrique (Lectures) regroupe les comptes rendus de lecture critiques d’ouvrages récents. Enfin, la revue se termine systématiquement par des résumés des contributions écrits en français et en anglais (suivis de mots-clés).
Cette revue a été publiée successivement par plusieurs éditeurs : Gallimard (n° 0) en 2003, Armand Colin (n° 1 à 6, H-S n° 1 et 2) de 2004 à 2006, Pepper / L’Harmattan (n° 7 à 20, H-S n° 3 à 9) de 2007 à 2013, Classiques Garnier (n° 21 et 22, H-S n° 10) en 2014 et, enfin, les PUR (depuis le n° 23 et le H-S n° 11) à partir de 2016.
La revue Parlement(s) n° 31 a pour thème : Monarchies censitaires. Ce trente-et-unième dossier a été coordonné par Corinne Legoy (Maître de conférences à l’université d’Orléans, POLEN) et Olivier Tort (Maître de conférences à l’université d’Artois, CREHS). Comme d’habitude, le dossier se compose de deux éléments distincts : une première partie consacrée à la « Recherche » (avec 7 contributions de 7 chercheurs ou chercheuses, jeunes ou confirmées : Emmanuel de Waresquiel, Sophie-Anne Leterrier, Rémy Hême de Lacotte, Pierre Karila-Cohen, Gilles Malandain, Andrew J. Counter et Vincent Chai) et la seconde à des « Sources » (au nombre également de 2 et, de l’ajout notable, de 2 entretiens de Corinne Legoy) commentées par deux enseignants-chercheurs : Emmanuel Fureix et Olivier Tort. De plus, dans ce numéro, nous trouvons des « Varia » (au nombre de 2, avec les contributions de Sylvain Nicolle et Pierre-Marie Delpu) à nouveau une partie consacrée à des « Lectures » (au nombre de 7) critiquées par 7 historiens (Cédric Maurin, Éric Anceau, Manon Pignot, Jean Vavasseur-Desperriers, Laurent Warlouzet, Rémi Lefebvre et, enfin, Jean-Marie Guislin) puis résumées par Jean-François Bérel, auteur des recensions de la revue Parlement[s]. Revue d’histoire politique. pour le compte de « La Cliothèque », rubrique du site de l’association « Les Clionautes ».
En introduction (p. 11-18), Corinne Legoy et Olivier Tort présente le dossier consacré aux « Monarchies censitaires ». Restauration et monarchie de Juillet apparaissent souvent comme une période d’éloignement maximal entre le peuple français et ses élites. Le mécanisme du suffrage censitaire, qui caractérise ces deux régimes et restreint à l’extrême le droit de vote, semble l’illustration même d’un processus de cloisonnement des notables, séparés de la nation : moins de 100 000 électeurs votent sous la Restauration ; ils ne sont toujours que 240 000 lors des élections législatives d’août 1846, dans une France d’environ 36 millions d’habitants. L’élitisme des âges censitaires ne saurait, au demeurant, se résumer à la figure singulière du riche électeur ou aux parlementaires des deux Chambres. Il trouve à s’incarner à la cour, auprès de la famille royale, parmi les évêques, ou encore chez les officiers supérieurs d’une armée profondément transformée par la chute de l’Empire napoléonien. Alors que les écrivains à succès s’agrègent aussi, peu ou prou, à ce monde d’en haut, quelques grandes crises donnent une traduction paroxystique à l’apparent divorce entre la France et ses notables, que n’atténue guère en 1830 le passage à la « monarchie bourgeoise » de Louis-Philippe. D’où l’intérêt de ce trente-et-unième numéro de Parlement[s]. Revue d’histoire politique.
[RECHERCHE]
R 1- Marie-Antoinette : mémoires croisées d’un procès et d’une exécution sous la Terreur (1793-XIXe siècle) : (p. 21-38)
Emmanuel de Waresquiel (Professeur à l’École pratique des Hautes Études)
Un événement comme le procès et la condamnation à mort de l’ancienne reine de France Marie-Antoinette les 14-16 octobre 1793, par le Tribunal révolutionnaire, ne prend tout son sens et n’atteint sa véritable profondeur historique que si l’on tente de le restituer dans le long terme de ses mémoires. Il apparaît alors combien une figure aussi clivante a pu contribuer à faire de la Révolution, et pendant longtemps, le lieu principal des divisions françaises, comme le champ d’une bataille qui n’aurait jamais fini de s’achever.
R 2- Le suffrage censitaire en chansons : (p. 39-57)
Sophie-Anne Leterrier (Professeur à l’Université d’Artois, laboratoire CREHS)
Les chansons sous la Restauration l’un des éléments de la propagande libérale (et de la contre-propagande légitimiste), un moyen à la fois de protester contre les entraves à l’exercice du droit de vote, de contourner la censure et de ridiculiser l’adversaire. Sous la monarchie de Juillet, le thème, repris par des chansonniers de cercles moins élitistes, devient un élément de la lutte politique contre le régime lui-même.
R 3- Échos censitaires au système concordataire : les combats en faveur du « clergé secondaire » dans les années 1840 : (p. 59-73)
Rémy Hême de Lacotte (Maître de conférences à Sorbonne-Université, Centre d’histoire du XIXe siècle)
La campagne d’opinion livrée en France en faveur des desservants des paroisses dans les années 1840 n’est pas sans faire écho aux combats menés, au même moment, afin d’élargir le corps électoral. Soutenus en particulier par la gauche, les ecclésiastiques animateurs du mouvement sont eux-mêmes sensibles aux idées de réforme politique et sociale. Sur fond de tensions renaissantes entre l’Église et l’État, l’épisode est révélateur d’une certaine crise d’identité du clergé concordataire, entre soumission aux autorités religieuses et politiques et affirmation de son rôle dans la société.
R 4- Un doctrinaire « homme du peuple » ? Eugène Janvier, sous-préfet de Dinan en 1847-1848 : (p. 75-94)
Pierre Karila-Cohen (Professeur à l’université Rennes 2, TEMPORA)
Peut-on être à la fois un jeune homme riche, nommé sous-préfet de Dinan à 22 ans grâce aux relations de son père et un « homme du peuple » adoré par une population d’ouvriers ? Le cas d’Eugène Janvier, en 1847-1848, semble le prouver puisqu’une pétition rassemblant la signature de 10 % des habitants de cette ville réclame et obtient le maintien de ce fonctionnaire de la monarchie de Juillet sous la seconde République. Cet article cherche à comprendre les raisons de cette popularité paradoxale, entre idéologie, clientélisme et réelle proximité.
R 5- L’héroïsme en héritage ? Trois ducs de Valmy sous la monarchie censitaire : (p. 95-109)
Gilles Malandain (Maître de conférences à l’université de Poitiers, CRIHAM)
Cet article propose une réflexion sur les biographies des trois porteurs successifs du titre de « duc de Valmy », créé en 1808 pour le maréchal Kellermann, et transmis en 1820 à son fils, général brillant mais « mal aimé » de l’Empire, puis en 1835 au fils de ce dernier, devenu ensuite député légitimiste. Que firent ces trois hommes, aux trajectoires très différentes, du « capital héroïque » (à connotation républicaine !) contenu dans un titre devenu progressivement un nom ? S’ils ne furent certes pas des révolutionnaires, tous les trois manifestèrent une certaine propension à braver les vents dominants de l’époque censitaire.
R 6- Vive la médiocrité ! L’antiélitisme de la littérature de mœurs sous la restauration : (p. 111-128)
Andrew J. Counter (Professeur associé, New College, Université d’Oxford)
Les « mœurs » de la société postrévolutionnaire font l’objet d’un discours politique sous la Restauration. Rendues hétérogènes par la Révolution, elles mettent en évidence la fragmentation de la nation en de nombreuses cultures incompatibles. Le roman de mœurs qui prend son essor à la même époque doit se lire comme un prolongement de ces grandes luttes politiques et comme l’expression précoce d’une solidarité symbolique des classes moyennes, ainsi que d’un antiélitisme qui vise prioritairement l’ancienne aristocratie. Cet article propose une lecture de deux romans, d’Étienne-Léon de Lamothe-Langon et d’Auguste Ricard, qui, face à l’élitisme du régime, font l’éloge de la médiocrité.
R 7- « …des passions aveugles ou ennemies » : l’entêtement fatal de la majorité Guizot (février 1848) : (p. 129-142)
Vincent Chai (Chercheur associé au Centre d’histoire du XIXe siècle – EA 3550)
On oublie souvent que la chute de Louis-Philippe présente une origine identique avec celle de Charles X. Une phrase insérée dans le discours du trône à l’attention des Chambres a, dans les deux cas, mis le feu aux poudres. En 1848, la majorité Guizot oppose un refus catégorique à toute tentative de conciliation venant de ses rangs même, pour atténuer une expression jugée offensante par l’opposition. Le drame parlementaire qui se joue au palais Bourbon trouve son épilogue sur les barricades parisiennes.
[SOURCES]
S 1- Un maréchal apothicaire, ou les dessous de l’extrême centre (Gravure de Daumier, La Caricature, 1er août 1833) : (p. 145-150)
Emmanuel Fureix (Professeur à l’université Paris-Est Créteil, CRHEC).
La satire graphique, singulièrement vivante sous les monarchies censitaires, a nourri une puissante critique sociale des pouvoirs, révolutionnaire à sa façon. La gravure de Daumier, publiée le 1er août 1833 dans le journal La Caricature, condense bien des traits de cette guerre iconique contre les dominants du jour. Son titre et son personnage central la rapprochent d’une charge ad hominem. De fait, elle vise clairement le comte de Lobau, Georges Mouton, général d’Empire et commandant de la garde nationale parisienne depuis décembre 1830. Surnommé « commandant général des apothicaires », il est aisément reconnaissable à son attribut, un gigantesque clystère. Rallié au régime de Juillet, devenu maréchal de France (en juin 1831), il a été élevé à la Pairie en juin 1833. Au sommet de sa gloire, il est devenu la risée des caricaturistes, après qu’il a fait réprimer avec des pompes à eau un attroupement de nostalgiques de Napoléon autour de la colonne Vendôme, venus célébrer le 5 mai 1831 le dixième anniversaire de sa mort.
S 2- Un ministre en fuite face au peuple en révolution : le choc des cultures (Mémoires du baron d’Haussez, 1897) : (p. 151-155)
Olivier Tort (Maître de conférences à l’université d’Artois, CREHS)
C’est avec sa causticité habituelle que le baron Charles d’Haussez (1778-1854) narre sa rencontre mi-dramatique mi-vaudevillesque avec les émeutiers des Trois Glorieuses, en chasse contre les ministres du roi déchu Charles X. La scène se déroule au petit matin du 2 août 1830, juste après l’échec du coup de force autoritaire du monarque, et le triomphe, en « Trois Glorieuses » journées, d’une révolution balayant la dynastie des Bourbons (27-29 juillet). Dans un sauve-qui-peut général, après une dernière réunion du gouvernement au château du Trianon, les ministres s’enfuient, chacun de son côté, et tentent de gagner clandestinement les frontières, tandis que les émeutiers chauffés à blanc par les combats récents avec les troupes royales les menacent ouvertement de mort.
S 3- Choisir l’histoire du premier XIXe siècle. Entretiens avec Anne-Emmanuelle Demartini et Judith Lyon-Caen : (p. 157-175)
Corinne Legoy (Maître de conférences à l’université d’Orléans, POLEN)
Anne-Emmanuelle Demartini (L’Affaire Lacenaire, Aubier, 2001) est professeure d’histoire contemporaine à l’université Paris-XIII et Judith Lyon-Caen (La lecture et la vie. Les usages du roman au temps de Balzac, Tallandier, 2005) est directrice d’études à l’EHESS. Elles ont toutes deux travaillé sur le premier XIXe siècle sous la direction d’Alain Corbin. Elles reviennent ici sur les raisons qui les ont conduites à explorer cette période, sur la définition de leurs objets et leurs choix historiographiques, mais aussi sur la singularité et la richesse de ces âges censitaires : complexité des rapports sociaux et du déclassement.
[VARIA]
V 1- Les débats sur la laïcisation du panthéon au début de la monarchie de Juillet (1830-1840) : (p. 179-197)
Sylvain Nicolle (Chercheur associé au CHCSC)
Alors que la monarchie de Juillet fait à nouveau du Panthéon un monument dédié au culte des grands hommes, Sylvain Nicolle souligne l’âpreté des débats parlementaires, tout au long des années 1830, pour choisir les panthéonisés et donner un cadre légal à la procédure. Pour le régime orléaniste, la priorité la plus urgente est de maintenir la logique sélective de la monarchie parlementaire, en résistant aux pressions de l’extrême-gauche, désireuse de son côté de faire avaliser des panthéonisations dictées par la rue et les émeutiers radicaux.
V 2- Des monarchies alternatives : souverains de village et « rois du bas-peuple » dans le royaume des Deux-Siciles (1848) : (p. 199-214)
Pierre-Marie Delpu (Chercheur associé à l’UMR 7303 TELEMMe, Aix-Marseille Université)
L’article de Pierre-Marie Delpu, quant à lui, met en lumière un phénomène original et méconnu : quand le printemps des peuples de 1848 fait s’effondrer les trônes européens, on assiste alors dans les campagnes napolitaines à l’éclosion de « souverains de village », qui se substituent localement à l’autorité défaillante. Cela pourrait passer pour une dérision carnavalesque du pouvoir déchu, s’il ne s’agissait avant tout de donner un vernis de légitimité et une structuration symbolique à l’émeute, reprenant à l’ennemi ses codes et ses usages, dans une frontière poreuse entre monarchie et république.
[LECTURES]
L 1- Victor Riglet, Paris du 22 février au 22 mai 1848. Journal d’un jeune révolutionnaire, manuscrit inédit publié par Denis Feignier, Wimereux, Éditions du Sagittaire, 2017, 317 p. par Cédric Maurin (p. 219-221)
Cet ouvrage est avant tout une trouvaille de brocante faite par Denis Feignier (ancien fonctionnaire au ministère de la Culture et actuellement inspecteur général de l’agriculture), qui a mené pendant de nombreuses années un travail de transcription de ce manuscrit et d’enquête historique pour retrouver les lieux précis ou les personnes évoquées dans l’ouvrage, formant ainsi un riche appareil critique. L’auteur, Victor Riglet est étudiant en architecture à l’École des Beaux-Arts, proche de Joseph Guinard. Le journal tenu au fil des événements permet d’en montrer toute la contingence et les enchaînements fragiles, c’est particulièrement vrai pour les journées révolutionnaires de février 1848. Républicain, il l’est à contrecœur et par opportunisme car il ne prend nullement une part active comme révolutionnaire, contrairement à ce que laisse croire le titre de l’ouvrage : « journal d’un jeune révolutionnaire ». Cependant, il va saisir l’opportunité ouverte par la révolution pour mener une carrière politico-militaire. Son récit permet aussi de montrer comment, pour lui, la révolution et ses suites, démocratisent pour un temps ses fréquentations sociales. À travers le récit de Riglet, c’est toute une époque qui est peinte : emportements romantiques, un goût prononcé pour les fêtes, les défilés et une foule de détails éminemment symboliques comme les ponts de Paris, rendus gratuits. Après les événements, Victor ne relit pas son carnet mais reste profondément marqué par les événements qui sont la grande époque de sa vie et espère pouvoir lire son récit et transmettre le souvenir de cette époque à ses enfants. En ce qui concerne sa vie privée, l’enquête de Denis Feignier montre que Victor épousera Hélène, la fille aînée de Guinard, avec qui il aura deux filles et qu’après s’être rallié à Louis-Napoléon Bonaparte, il participera aux premiers grands travaux parisiens avant de mourir, en 1854, à l’âge de 26 ans.
L 2- Pierre Cornut-Gentille, Le 4 septembre 1870. L’invention de la République, Paris, Perrin, 2017, 222 p. par Éric Anceau (p. 221-222)
Depuis 25 ans, le grand avocat pénaliste, Pierre Cornut-Gentille a publié plusieurs livres d’histoire couronnés par la critique et par le public (Un scandale d’État. L’affaire Prince en 2010, par exemple). Son ouvrage répond à un vide historiographique : le récit de la journée révolutionnaire du 4 septembre 1870 qui voit le renversement du Second Empire et l’instauration de la République. Dès son introduction, l’auteur nous donne les raisons de cette lacune. Le facteur déclencheur est la débâcle de Sedan face aux Allemands. Or, loin de redresser la situation périlleuse dont ils héritent, les républicains sont contraints quelques mois plus tard de conclure la paix désastreuse de Francfort et d’écraser la Commune de Paris, fille de la défaite. À la mauvaise conscience d’avoir pris le pouvoir en profitant d’une situation si périlleuse sans parvenir à la redresser, il faut ajouter que les nouveaux dirigeants républicains ont bafoué la représentation nationale et n’ont pas consulté le corps électoral avant février 1871, contrairement à ce qu’ils avaient initialement promis. Pour défendre cette thèse, Pierre Cornut-Gentille nous propose un récit bien conduit en douze chapitres nerveux, toujours clairs et fort justes qui, après avoir abordé l’enchaînement des causes (diplomatiques et militaires), retracent le déroulement de la révolution heure par heure, en nous promenant du Palais-Bourbon aux Tuileries, avant de conclure par deux tableaux qui nous montrent d’abord comment la province a réagi à l’événement, en le devançant même parfois comme à Lyon et à Marseille, puis comment le gouvernement de la Défense nationale républicain a exercé le pouvoir au lendemain du 4 septembre. L’auteur nous livre au passage les portraits des principaux protagonistes, qu’il introduit toujours à-propos (Palikao, Schneider, Thiers, Trochu, Gambetta). On déplorera simplement de menues et rares approximations (l’expédition de Chine donnée en 1859) et quelques excès d’appréciation tributaires de la bibliographie utilisée (l’impératrice Eugénie est particulièrement maltraitée). Il n’en demeure pas moins que l’ouvrage vient combler une lacune historiographique et donne désormais au grand public un récit juste, clair, indispensable, de ce grand moment d’histoire de France.
L 3- Dominique Kalifa, La véritable histoire de la « Belle Époque », Paris, Fayard, 2017, 296 p. par Manon Pignot (p. 223-225)
L’ouvrage de Dominique Kalifa (spécialiste incontesté de la période) s’ouvre sur un rappel bienvenu : si la Belle Époque est encore vue comme frivole, prospère et insouciant, elle a aussi sa part d’ombres. Pourtant, le livre n’est pas un énième ouvrage synthétique sur ce tournant du XIXe siècle ; c’est au contraire une invitation à voyager dans le temps long du XXe siècle, à la poursuite d’une expression devenue canonique et de son histoire. L’auteur nous invite donc à suivre l’histoire d’un chrononyme – peut-être même l’un des plus célèbres – et à travers lui celle d’un imaginaire historique, d’un passé recomposé. En un mot : la « réinvention permanente » de la « Belle Époque », manière de rappeler aux lecteurs que l’histoire est une matière vivante.
L’ouvrage s’articule, en effet, en trois temps qui correspondent aux trois périodes de la réinvention : « l’époque 1900 » d’abord, consacré à la « préhistoire » de l’expression, court jusqu’en 1939, où se cristallise la « mode 1900 » et où les principaux éléments qui la constituent s’historicisent. La deuxième partie du livre est donc consacrée à la période 1940-1959, véritable acte de naissance de l’expression, et intitulée « Ah la Belle Époque ! ». Ainsi, au sortir de la guerre, la « Belle Époque » est toujours d’actualité mais c’est une vision plus sombre et plus nuancée qui en est donnée, manière aussi d’inscrire la IVe République en rupture avec les choix culturels du régime de Vichy. La troisième et dernière partie s’intitule « L’épreuve de la “fin-de-siècle” » et s’intéresse à la postérité de l’expression depuis les années 1960 jusqu’à aujourd’hui où un autre imaginaire émerge, à contre-courants. Le livre montre ensuite la diffusion internationale de l’expression, en Europe mais aussi en Amérique latine par exemple, et la modernisation de l’imaginaire « Belle Époque » jusqu’aux années 2000 à travers le cinéma et la bande dessinée. Les trois parties sont entrecoupées de courts textes, qui sont autant des transitions qu’une réflexion personnelle de l’auteur, écrite à la première personne : évoquant le travail mené avec ses étudiants, ces passages constituent une véritable mise en abîme de l’écriture historienne qui s’achève dans un épilogue, « les temps mêlés » où La “Belle Époque” est le rêve de l’unité perdue. Le livre de Dominique Kalifa constitue aussi un essai historiographique sur la nostalgie et, par-là, une leçon d’histoire.
L 4- Jacques-Olivier Boudon (dir.), La Jeune République – 1912 à nos jours. Histoire et influence, Paris, Honoré Champion, 2017, 348 p. par Jean Vavasseur-Desperriers (p. 225-229)
Cet ouvrage, issu d’une journée d’études de l’Institut Marc Sangnier et du Centre d’histoire du XIXe siècle en 2012, se présente comme un excellent instrument de travail, en même temps qu’il pose des pistes de réflexion à propos d’un mouvement souvent cité mais, au fond, très mal connu. L’un des mérites de l’ouvrage est d’aborder la période postérieure à 1945, non étudiée par les rares travaux académiques des années 1960-1970. Il traite également de son effacement définitif, phénomène significatif trop souvent négligé.
L’instrument de travail est remarquable. Les huit études sont complétées par un dictionnaire consacré aux principales personnalités et militants de « La Jeune République » (près de 200 notices). Le dictionnaire permet le suivi des itinéraires politiques, dans un mouvement qui vit « passer » les personnalités les plus diverses, parfois pour une brève période – citons seulement quelques noms : Jacques Delors, Francisque Gay, l’abbé Pierre, Henri Guillemin, Léo Hamon, Maurice Schumann et l’historien Philippe Wolff. Il dévoile les liens relationnels ou familiaux (la famille Sangnier a droit à d’abondantes notices) ; et les noms des épouses (ou des époux, pour les 11 personnalités féminines) sont précisés. Il permet aussi un tableau sociologique sans doute un peu sommaire, mais utile, par les données fournies sur la formation, la profession, le territoire de chacun des personnages. À ce dictionnaire, s’ajoutent un inventaire des sources manuscrites ou imprimées disponibles, une ample bibliographie et un recueil de vingt documents échelonnés de 1912 à 1975, tout à fait significatifs.
Les huit textes de contributeurs suivent chronologiquement l’histoire de « La Jeune République ». Plusieurs réflexions émergent de ces contributions. Les premières portent sur la nature de la formation : La JR, créée en 1912 en tant que ligue pour devenir un parti en 1936, a évolué en une sorte de « club », après le congrès socialiste d’Épinay de 1971, totalement marginalisée, pour n’être plus guère représentée que par un journal sans grande diffusion, avant sa disparition au milieu des années 1980. Le positionnement fait l’objet de développements riches et nuancés : Globalement, la JR s’est située à gauche et à la gauche du Parti socialiste, tout en gardant ses distances avec le Parti communiste, en faveur de l’union de la gauche, tout en refusant l’absorption, ce qui entraîna sa disparition en 1975, faute d’un espace politique suffisant. Enfin, la question, délicate, de l’influence de la JR, est également abordée à deux niveaux : sur le monde catholique et sur la gauche en général, qui est passée de minoritaire à marginal, pour disparaître en 1975.
L’ouvrage, incontestablement, représente un important apport, dans ses développements et ses analyses solides et nuancées. Avec son appareil scientifique, il constitue une base sûre à toute étude sur la JR. Et ce n’est pas l’un des moindres mérites de l’ouvrage que de suggérer quelques pistes de recherches ultérieures.
L 5- Mathieu Fulla, Les socialistes français et l’économie (1944-1981). Une histoire économique du politique, Paris, Presses de Sciences Po, 2016, 468 p. par Laurent Warlouzet (p. 229-231)
Issu d’une thèse de doctorat, l’ouvrage de Mathieu Fulla manifeste la volonté de son auteur de réaliser une véritable « histoire économique du politique » du parti socialiste de la Libération à 1981. Il s’inscrit dans le renouvellement des travaux historiques consacrés à l’histoire du parti socialiste après 1945, marqué par des thèses récentes (Judith Bonnin, Mathieu Tracol, etc.). Couvrant une large période, l’ouvrage réussit son pari. Les rapports de force internes au parti, les relations avec les syndicats et les autres forces politiques sont bien décrits, et mis en relation avec les choix de politiques économiques et sociales. Pour aboutir à ce résultat, l’auteur a consulté des sources primaires variées, comme l’abondante littérature grise et les fonds privés répartis entre différentes archives (archives nationales, archives départementales – notamment celles de l’Aveyron pour le précieux fonds Ramadier –, fondation Jean Jaurès, OURS, Sciences Po, etc.). Il a également eu le mérite de constituer un ensemble de sources inédites à travers des entretiens, oraux et écrits, avec une cinquantaine de témoins. Sur l’ensemble de la période, quelques constantes apparaissent comme le poids obsédant du parti communiste, principale contrainte lorsque le parti socialiste est dans l’opposition, selon l’auteur. Au pouvoir, c’est la menace du déséquilibre des finances extérieures qui s’impose comme principale limite. De fait, les difficultés de financement ont obéré l’action socialiste tant de Mollet, en 1957, que de Mitterrand, en 1983. En somme, Mathieu Fulla nous livre un travail dense et stimulant, à la croisée des histoires politiques et économiques, qui témoigne du renouvellement de ces deux domaines dans l’historiographie française.
L 6- Ismaël Ferhat, Socialistes et enseignants. Le parti socialiste et la fédération de l’Éducation nationale de 1971 à 1992, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 2018, 382 p. par Rémi Lefebvre (p. 231-234)
La double spécificité du socialisme français, sur le plan organisationnel et sociologique, tient sans doute à deux particularités historiques. Son ancrage institutionnel dans les mairies et ses réseaux d’élus ont permis de compenser la faiblesse de ses ressources organisationnelles et militantes. Son implantation dans le monde enseignant, marquée jusque dans les années 1980, a largement contribué à son rayonnement dans la société, alors que son faible ancrage dans le monde ouvrier le distingue nettement de ses homologues sociaux-démocrates allemands et anglais. La FEN a été le pivot majeur des relations entre socialistes et enseignants. La thèse d’Ismaël Ferhat, apporte une contribution précieuse à la compréhension des rapports entre ces deux organisations et donc à l’analyse d’une galaxie laïque qui a été une configuration sociopolitique essentielle dans le paysage politique Français. La période revêt une forte cohérence : de la reconstruction du PS à Épinay à la scission de la FEN en 1992 qui cesse alors d’être l’organisation dominante du monde enseignant. Ces relations complexes et évolutives, cycliques, faites de proximité mais aussi de beaucoup de malentendus et d’instrumentalisations réciproques, sont analysées avec beaucoup de subtilité, de finesse et de clarté comme des interactions entre des organisations elles-mêmes traversées de conflits et marquées par des évolutions qui tiennent à leur environnement plus global. C’est l’un des intérêts majeurs de l’ouvrage : penser les relations entre des organisations soumises elles-mêmes à des mutations (le passage à une culture de gouvernement pour le PS et ses vicissitudes électorales sur la période, les transformations sociétales multiformes de l’école, l’expansion de l’école, la montée des consommateurs d’écoles, le déclin du syndicalisme… pour la FEN). C’est la question des relations privilégiées que les partis politiques nouent avec certains groupes sociaux et leurs représentants (formes de néo-corporatisme sectoriel dans le cas étudié) qui est ici éclairée. Comme le style est fluide, la lecture des seize chapitres à l’ordonnancement clair n’en est que plus agréable.
L 7- Claire Andrieu et Michel Margairaz (dir.), Pierre Sudreau. 1912-2012. Engagé, technocrate, homme d’influence, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2017, 222 p. par Jean-Marc Guislin (p. 234-237)
Ce volume consacré à Pierre Sudreau (PS), résistant, haut fonctionnaire, élu, va bien au-delà du genre biographique. En effet, l’étude de ce « grand expert-commis, à la frontière de la société civile et de la société politique, véritable passerelle active entre différents milieux », permet d’aborder des sujets variés comme « la richesse et la complexité des liens noués » (p. 41) pendant la Deuxième Guerre mondiale, l’urbanisme, l’européisme, l’entreprise ou encore le lobbying… à partir des grands thèmes qui structurent l’ouvrage : la Résistance et la déportation (p. 13-61) qui furent « la grande école politique de sa vie » (p. 203), le politique (p. 65-147), l’homme d’influence (p. 151-200). Ses différentes fonctions après la guerre révèlent un itinéraire diversifié, étudié par une douzaine de chercheurs qui éclairent ainsi de nombreux aspects de la vie politique et économique française du second XXe siècle. À la lecture des différentes contributions, Pierre Sudreau apparaît bien comme une remarquable incarnation de l’élite modernisatrice au temps de la Grande Croissance dont le parcours toutefois, en raison de ses multiples appartenances, s’avère éclectique.
© Les Clionautes (Jean-François Bérel pour La Cliothèque)