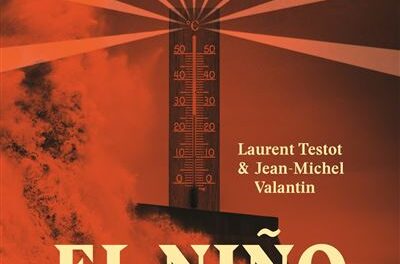Jacques CAPLAT, Changeons d’agriculture. Réussir la transition, coll. « Domaines du possible », Actes Sud, 2014.
Jacques CAPLAT, L’agriculture biologique pour nourrir l’humanité, coll. « Domaines du possible », Actes Sud, 2012.

Jacques Caplat est présenté comme « agronome et ethnologue », « fils de paysan », ancien « conseiller agricole en Chambre d’agriculture, puis animateur à la Fédération nationale d’agriculture biologique. Il a notamment participé à la création du réseau Semences paysannes et s’est impliqué dans des actions de développement dans des pays du Sud ». De ce fait, il intervient dans la sphère publique, par le biais d’ouvrages comme ceux-là, de conférences, d’articles dans la presse spécialisée ou générale. De ses deux ouvrages dont il est rendu compte ici, « Changeons d’agriculture » s’adresse plutôt au grand public alors que « L’agriculture biologique » entre beaucoup plus dans le détail, notamment techniques. Sans que cela soit indiqué expressément, on peut considérer que le premier est une synthèse du second.

Une problématique est proposée, liée à la question « de l’existence, ou non, d’une alternative agricole. À hypothèse démographique constante […], l’agriculture biologique est-elle une meilleure solution alimentaire, environnementale, sociale et économique que l’agriculture conventionnelle ? ». Compte tenu du titre du livre et du statut professionnel de son auteur, le suspense est mince. L’intérêt se trouve plutôt dans la qualité de l’argumentation.
Jacques Caplat dresse d’abord un bilan du modèle agricole dominant (l’agriculture dite « conventionnelle »), l’auteur excelle à en montrer les limites, tout en expliquant pourquoi on en est venu au système intensif. Selon lui, on a surtout abouti à une perversion du travail de la terre, de plus en plus déconnecté du milieu dans lequel il s’exerce : l’objectif est de produire en fonction de la demande, donc des marchés ; les moyens industriels (mécaniques, chimiques, biotechnologiques…) sont là pour compenser les déficiences de la nature. Il y a là une perte de sens, puisque cette façon de faire détruit sa propre base. Jacques Caplat utilise l’image très évocatrice d’un « géant aux pieds d’argile » pour qualifier l’agriculture conventionnelle.
De là, il en profite pour rappeler aux bases de l’agronomie, et renverse les a priori que l’on pourrait avoir. Ainsi, sur une surface donnée, l’agriculture biologique a une production deux fois plus importante (rapportée en matières sèches pour faciliter la comparaison). Pour l’élevage bovin, J. Caplat prend en compte l’ensemble des parcelles nécessaires à l’alimentaire du cheptel considéré : en biologique, un peu plus d’un hectare nourrira 1,2 à 1,4 vaches ; en conventionnel, il faut ajouter les surfaces semées en soja, en maïs ; dès lors, un hectare ne permet de vivre qu’à 1,1 vache. Les performances ne sont donc pas forcément là où l’on pense qu’elles sont, encore faut-il prendre en compte l’ensemble des éléments.
Mais il dépasse ce domaine pour montrer que ces questions ne sont pas seulement techniques : l’agriculture ne concerne pas les seuls agriculteurs : au-delà de la production, il faut aussi considérer la société. Jacques Caplat rappelle la situation des régions les plus riches, dans lesquelles cette consommation est excessive et compromet la santé : sa diminution est ici un impératif. Il montre aussi l’importance des gaspillages (le quart de la production européenne), et le coût que cela représente en eau, en énergie, en surfaces : là aussi, des efforts sont à faire.
L’auteur montre ensuite l’impact sociale de l’agriculture biologique. Elle nécessite beaucoup plus d’emplois que le secteur dominant, et permet donc le maintien d’une paysannerie. Elle contribue à réduire la circulation des produits. Elle permet une offre plus diversifiée, par la pratique des cultures associées, lesquelles renforcent par ailleurs les capacités de résistance des plantes contre les parasites, les maladies phytosanitaires. Ce faisant, l’agriculteur renforce son autonomie, en étant davantage maître de ses choix. Il l’est d’autant plus que l’agriculture biologique permet de réduire les transports., par le renforcement de la valorisation des produits à l’échelle du territoire. Cela ne signifie pas forcément qu’ils sont transformés dans la ferme elle-même, et que chaque agriculteur biologique se transforme en boulanger ou en traiteur. Il y a lieu d’articuler les filières entre elles, pour lutter contre les excès de la spécialisation. On peut ainsi obliger au versement d’une contribution au coût de l’entretien des routes : au lieu de se faire en Allemagne, l’abattage des porcs bretons pourrait alors se faire localement. La proposition de Jacques Caplat a toutefois été faite avant les manifestations contre l’éco-taxe… La coopération entre les opérateurs économiques (fruits et légumes) peut toutefois être renforcée, pour obtenir une meilleure autonomie face à la distribution.
Il s’interroge sur la transition. Selon lui, elle peut être longue, pas forcément linéaire, car elle oblige à une rupture intellectuelle. Les étapes passent d’abord par la substitution des produits : diminuer les intrants chimiques, et finalement les remplacer par des produits moins nocifs. Cela amène ensuite à changer les pratiques, en implantant des haies et des bandes enherbées dans les champs céréaliers, par exemple : c’est déjà raisonner à l’échelle de ce qu’il appelle l’agrosystème, c’est-à-dire au moins considérer l’ensemble des plantes cultivées et des animaux élevés comme étant en relation les uns avec les autres. Enfin, le système est réorganiser en profondeur, ce qui conduit, par exemple, à réintégrer l’élevage dans les fermes céréalières, mais aussi tirer parti de la faune auxiliaire (oiseaux, insectes…) déjà présente, et aller jusqu’à se réapproprier la sélection végétale, voire même animale. Jacques Caplat appelle à un renforcement de la coopération entre les fermes, ce qui peut être une manière de faciliter la conversion. On peut imaginer des formules d’échange entre fermes céréalières (fourniture de paille et de céréales pour le bétail, de matières carbonées à composter…) et ferme d’élevage (fourniture de déjections animales compostées…), comme étape préalable au transfert d’un petit cheptel dans les fermes de grande culture.
Cela suppose un important effort de formation initiale et continue. Il voit dans les rencontres entre agriculteurs un atout essentiel : les pratiques changeront par l’exemple, mais aussi par un accompagnement personnel (avec le parrainage, par exemple), ce qui contribuera à banaliser les techniques biologiques auprès des agriculteurs conventionnels, tout en combattant l’esprit individualiste. À ce titre, il est capital, à ses yeux, de décloisonner les deux secteurs, biologique et conventionnel.
Cela suppose une plus grande implication des pouvoirs publics en matière de recherche agronomique biologique. Si l’ITAB (Institut technique de l’agriculture biologique, association reconnue d’utilité publique) est de mieux en mieux soutenu, la part des activités de l’INRA dans le domaine du biologique reste très faible.
L’auteur se pose la question de la taille des fermes. Il reconnaît qu’il est difficile de la réduire, même quand il est prouvé que cela peut déboucher sur une augmentation de la valeur ajoutée et une amélioration de la qualité de vie. Mais il convient auparavant de mettre fin au laxisme en matière d’agrandissement, en obligeant les instances qui attribuent les « autorisations d’exploiter » à privilégier l’installation de jeunes agriculteurs et non l’agrandissement des fermes déjà développées.
La fiscalité et le système des aides sont aussi à revoir. Actuellement : un euro de cotisations sociales doit être versé pour un euro de salaire ; mais on peut obtenir 0,50 € de subventions pour un euro de dépense en matériel, ce qui encourage la mécanisation au détriment de l’emploi. Plus que la réduction de la taille de la structure, c’est celle des parcelles et des ateliers d’élevage qui doit être réduite, par l’augmentation de la main-d’œuvre et la mutualisation des compétences.
On peut aussi profiter de l’image positive que l’opinion publique accorde à la qualité des produits de l’agriculture biologique, pour rétablir la réalité sur les prix. Ceux-ci sont faussés à cause des subventions et du refus d’intégrer les coûts indirects : la dépollution de l’eau est estimée à plus 800 €/ha, à quoi il faut ajouter le coût sanitaire induit par la pollution de l’air, de l’eau, des aliments… La distorsion se fait nettement au détriment des prix des produits biologiques, dont le coût est pourtant moins lourd pour la collectivité.
Les consommateurs peuvent aussi faciliter et accélérer la transition vers l’agriculture biologique. Cela nécessité de changer les habitudes : consommer « bio » est un premier pas, mais il faut aussi respecter la saisonnalité des produits, limiter la consommation des protéines animales, et privilégier les produits locaux dans la mesure du possible.
Ils peuvent aussi soutenir les changements préalables à la transition chez les agriculteurs en adhérant aux AMAP, ce qui permet de renouer le lien avec le producteur et de retrouver un certain sens des choses (la saisonnalité des produits qui vient d’être évoquée, par exemple). Cela permet également de rapprocher les citadins de l’acte agricole, et de retrouver le lien avec le territoire et le vivant. Les expériences d’agriculture urbaine vont également dans ce sens, en oubliant qu’elles s’appuient en réalité sur des faits anciens : les jardins de la victoire qui ont été développés aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale ont pu fournir 40 % de la production végétale en 1945.
On parle volontiers de « consommateur-acteur », ou, par contraction, de « consomm’acteurs ». On peut aller plus loin encore, et s’impliquer dans des associations de protection de l’environnement, dans celles qui soutiennent l’évolution vers l’agriculture biologique ou le commerce équitable. On peut mobiliser autrement son épargne en l’investissant dans des structures d’aide à l’installation des jeunes agriculteurs comme Terre de liens, qui pratique l’achat collectif de terres. L’électeur peut aussi faire le tri dans les candidats qui réclament son suffrage, et écarter les candidats résolument productivistes.
Au-delà de ces démarches individuelles, mais importantes, Jacques Caplat rappelle que les municipalités peuvent aussi s’impliquer dans la transition. Elles peuvent ainsi acheter des terres dans le périmètre de protection du captage d’eau potable (avec des aides de la part des Agences de l’eau) avant de les remettre à des agriculteurs biologiques. Elles peuvent définir des « projets de territoire » (comme les communautés de communes). Munich, par exemple, a converti l’ensemble de son bassin versant en biologique pour protéger l’approvisionnement en eau contre les nitrates, tout en favorisant les produits de cette agriculture dans la restauration collective (les écoles, mais pas seulement…).
En guise de conclusion et de synthèse, Jacques Caplat écrit que « l’agriculture la plus performante est celle qui se base sur les cultures associées, sur des variétés végétales et des races animales qui coévoluent en permanence avec les milieux naturels et les humains sur l’utilisation de ressources renouvelables, sur le respect des cycles naturels et de la physiologie animale, et sur la valorisation de la main-d’œuvre. Il s’agit dès lors de reconstruire un organisme agricole complexe, mettant en relation l’écosystème, l’agrosystème et les humains. Ce projet a été énoncé […] sous le nom d’agriculture biologique ».
Cela suppose de travailler avec les paysans, sans laisser les organisations agroalimentaires et syndicales décider seules : la transition vers l’agriculture biologique est donc l’affaire de toute la société. Mais elle permettra de conduire à un changement de notre relation au territoire, et une refondation de nos relations sociales à une échelle plus large.