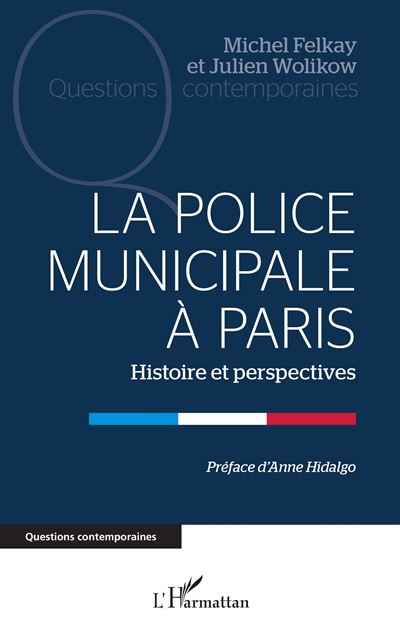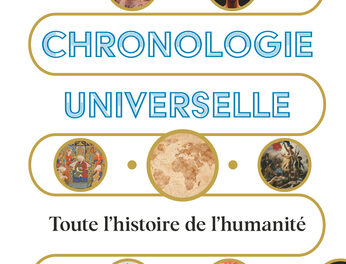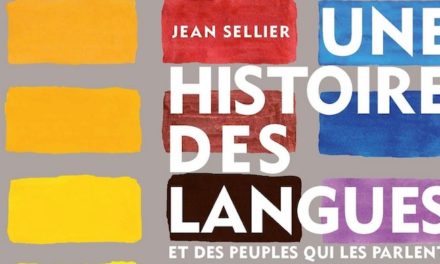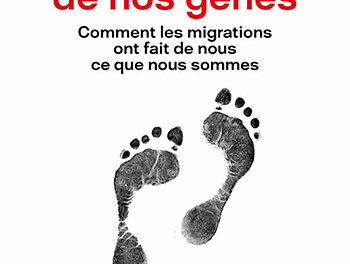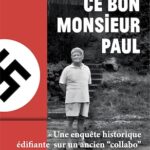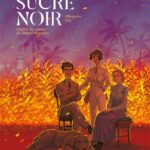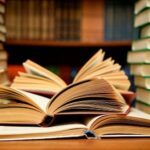Les auteurs retracent l’histoire de la police parisienne, étape par étape, depuis le Moyen Âge jusqu’à aujourd’hui — en tenant compte des évolutions sociétales et des nouvelles menaces sécuritaires —, avec l’instauration d’une véritable police municipale dans Paris intra muros.
En guise d’introduction liminaire, Michel FelkayCommissaire général de la Police nationale, il est l’auteur d’études pour l’Institut des hautes études du ministère de l’Intérieur (IHESI), notamment sur le groupe de Traitement Local de la Délinquance (GTLD) ou le traitement des nuisances. Il a publié : Les interventions de la police dans les zones de cités urbaines (L’Harmattan, 2000), Donner sa vie au quotidien (L’Harmattan, 2003), Pour plus de tranquillité dans un espace urbain renouvelé (L’Harmattan, 2020), Le commissaire de tranquillité publique (L’Harmattan, 2000), Itinéraire d’un policier (L’Harmattan, 2011). Son expertise lui a conduit à son recrutement, en 2019, par la Ville de Paris pour créer et diriger cette nouvelle force de sécurité. et Julien WollikowJuriste territorial et chargé d’enseignement en droit public et droit pénal, il est encore chef du pôle doctrine, partenariat, verbalisation à la Direction de la police municipale et de la prévention de la Ville de Paris. Il publie des articles juridiques relatifs à l’action publique dans les revues spécialisées. retracent, avec rigueur, la genèse des polices municipales et plus particulièrement celle de Paris. Leur sujet d’étude mêle à la fois histoire, droit, sociologie et enjeux politiques de la sécurité publique, dans l’espace public. Les deux auteurs nous offrent, tout d’abord, une analyse approfondie de l’histoire de la police parisienne, avant de nous dresser les perspectives de la police municipale, dans la capitale française.
Un bref historique de la police à Paris depuis le Moyen Âge jusqu’à 1975
Les deux auteurs nous donnent, tout d’abord, une approche historique de la police municipale à Paris. Ainsi nous apprennent-ils que cette dernière remonte au Moyen Âge, où, dès 1254, les riches bourgeois de la ville — sous le nom de « guet de Paris » — patrouillaient la nuit, pour assurer la sécurité des habitants. La lecture des premières pages de cet ouvrage nous permet de constater comment cette forme primitive de police municipale a pu évoluer au fil des siècles.
Les auteurs analysent les conséquences de la centralisation croissante du pouvoir sous l’Ancien Régime, et encore avec la création par Napoléon Bonaparte, de la Préfecture de police de Paris — en lieu et place de la lieutenance de police, œuvre de Louis XIV. Le nouvel homme fort de la France entend limiter les pouvoirs du corps municipal parisien dont sa population est jugée rebelle, voire violente. Pour ce faire, celui-ci entend concentrer entre les seules mains du préfet de police, l’organisation de la sécurité dans la cité, ce qui aura pour conséquence de freiner durablement toute velléité de création d’une véritable police municipale autonome à Paris. Cette centralisation particulière distingue la capitale des autres grandes villes françaises, qui ont conservé leurs polices municipales après la Révolution. Ainsi, le pouvoir jacobino-bonapartiste fait de Paris un enjeu essentiel pour la stabilité des institutions nationales et de la Préfecture de police, la seule institution en mesure d’étouffer toute velléité de révolte contre le pouvoir central.
Michel Felkay et Julien Wolikow expliquent que la police municipale a toujours été un sujet de débat, en raison de la centralisation du pouvoir et de la crainte de voir se multiplier les forces de sécurité locales. Ainsi la Préfecture de Police voit-elle ses compétences s’élargir aux nouvelles limites territoriales de la ville, après la mise en application de la loi du 16 juin 1859 sur l’extension des limites de Paris. Cependant, la capitale ne bénéficie pas des avancées permises par la loi du 5 avril 1884 relative à l’organisation municipale, qui permet aux communes de s’administrer librement.
Le pouvoir gaullien, soucieux d’éviter l’émergence d’un contre-pouvoir à la Ve République naissante, supprime et démembre, par la loi du 10 juillet 1964, le département de la Seine — qui rassemblait jusqu’alors 81 communes, dont Paris — et consacre les pouvoirs du préfet de police. Jusqu’à la promulgation de la loi du 9 juillet 1966 portant organisation de la Police nationale, la Préfecture de police n’aura eu de cesse de se présenter comme une « police municipale », ce qui explique la présence du préfet de police au sein du conseil municipal de Paris. Cette loi du 9 juillet 1966 intègre des agents de la Préfecture de police au sein de la Police nationale, tout en conservant l’autonomie de la Préfecture de police, qui relève directement du ministre de l’Intérieur. Ainsi, depuis la chute de la Commune jusqu’à 1975, la Préfecture de police s’occupe seule de la sécurité des Parisiens.
Une lente maturation depuis 1975 jusqu’en 2021
Les auteurs nous rappellent que ce n’est que sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing, en application d’une loi du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris, qu’est rétablie en mars 1977 l’élection du maire de Paris. Depuis l’Hôtel de Ville, le nouvel édile s’intéresse aux questions de sécurité, « domaine réservé » du préfet de police.
Nonobstant, l’idée d’une police municipale moderne commence à émerger à partir des années 1980 dans la capitale. La montée de l’insécurité et de la délinquance urbaine, un État perçu comme affaibli et la demande croissante des Parisiens de sécurité montrent la nécessité d’instaurer une police de proximité, capable de répondre rapidement aux besoins des citoyens, tout en complétant l’action de la police nationale. Les auteurs soulignent que la création de la police municipale à Paris s’inscrit dans un contexte plus large de réforme de la sécurité en France, marqué par une volonté de renforcer le continuum de sécurité entre les différentes forces de l’ordre.
Alors que les politiques de décentralisation ont progressivement renforcé les compétences des maires en matière de sécurité, alors que la loi du 29 décembre 1986 lui confère ses premiers pouvoirs de police, le maire de Paris ne peut toutefois revendiquer aucune compétence de police pour lui-même. Considérée comme inutile, pour répondre aux attentes de la population en matière de sécurité, devant le risque de « bavures » liées à l’armement létal dont les agents de la police municipale pourraient être dotés, enfin devant la primauté de l’État régalien pour assurer la sécurité des biens et des personnes, l’idée de créer une police municipale parisienne est sinon abandonnée, à tout le moins reportée sine die.
Les besoins croissants des Parisiens en matière de tranquillité publique et de proximité avec les forces de l’ordre, encore plus exacerbés par la montée de la délinquance, avec les vagues d’attentats terroristes et les nombreuses manifestations qui ont ébranlé la capitale depuis 1995, ont rebattu les cartes et remis en question le monopole de l’État, et donc de la Préfecture de police, sur le maintien de l’ordre à Paris. Tous ces phénomènes ont, in fine, contribué à porter sur les fonts baptismaux, la police municipale, en 2021.
2021, l’aboutissement de la création d’une police municipale parisienne
Ses partisans voient dans cette police municipale, un substitut à la Préfecture de police face aux attentes des Parisiens dans les domaines du logement, de la salubrité des rues, ou bien encore de l’entretien des espaces vers, là où celle-ci n’est plus en mesure de les prendre en charge seule. Soucieuse de créer une police municipale dans la capitale, la Ville de Paris charge le commissaire général Michel Felkay de cette mission. Fort de sa longue expérience au sein de la Police municipale, celui-ci parvient à concrétiser cette volonté municipale durant l’année 2021.
Une fois installée, cette police municipale pourrait avoir vocation à remplacer la police de proximité disparue en 2002. Aussi, pourrait-elle mener à bien la lutte contre les incivilités, même si cette notation, mal définie, oscille entre contraventions et délits. Nonobstant, une ambiguïté demeure quant à cette qualification pénale des incivilités, concernant le contenu des missions, mais aussi le cadre juridique dans lequel devront intervenir les policiers municipaux.
Cela étant, deux questions se posent quant à la volumétrie exacte des effectifs de police municipale et la gestion de leur armement. La question se posait dès 2018. L’idée de « transformer » 3200 agents de la Direction de la prévention, de la sécurité et de la protection (DPSP) de la mairie, en policiers municipaux, fut avancée en 2018 et réalisée deux ans plus tard.
Moins police d’intervention d’urgence, que police de proximité, la police municipale de la capitale voit le gouvernement et la majorité municipale tenter d’accroître ses pouvoirs à l’occasion du vote de la loi du 25 mai 2021 sur la sécurité globale préservant les libertés. Conçue pour être une force de proximité, capable de répondre rapidement aux besoins des Parisiens, et de renforcer leur lien de confiance entre les citoyens et les forces de l’ordre, la police municipale parisienne intervient dans divers domaines tels que la sécurité, les incivilités, l’environnement, et la gestion des espaces publics. Par exemple, elle joue un rôle clé dans la lutte contre les nuisances sonores et la pollution atmosphérique, des problématiques urbaines majeures.
2024 : JOP et post-JOP
La crise du COVID, et l’organisation des Jeux olympiques de 2024 furent pour la police municipale parisienne l’occasion de tester, in vivo, ses capacités à répondre aux nouveaux défis sécuritaires, ainsi qu’aux attentes nouvelles des citoyens. Au-delà de capacités de la police municipale parisienne de s’adapter aux évolutions de la société et aux nouvelles formes de criminalité, les auteurs insistent sur la nécessité de renforcer la coopération, entre la police municipale et les autres forces de sécurité, afin de garantir une réponse coordonnée et efficace aux menaces.
Michel Felkay et Julien Wolikow insistent sur la nécessité d’une police municipale plus proactive, capable de s’adapter rapidement et durablement aux évolutions de la société et aux nouvelles formes de criminalité. En outre, les deux auteurs proposent des pistes de réflexion à étudier, pour rendre plus efficiente la police municipale, notamment par la mise en place de partenariats avec d’autres acteurs de la sécurité.
Mobilisés conjointement avec les fonctionnaires de la Police nationale et les militaires de la Gendarmerie nationale à l’occasion des Jeux olympiques, les agents de la Police municipale parisienne ont connu une réelle évolution de leur doctrine d’emploi. La loi du 15 avril 1999, relative aux polices municipales, avait permis de déterminer et de coordonner les missions des polices nationale et municipale. Cette loi, qui prévoyait des opérations conjointes, régulièrement, dans le même temps, attribuait certaines charges dites « indues », de la Police nationale à destination de la Police municipale.
En conclusion
Dans cet ouvrage dense et fortement documenté, les auteurs nous offrent une vision complète de différentes étapes ayant permis la résurgence d’une police municipale à Paris. Devenues des acteurs à part entière du continuum de sécurité dans notre pays, les polices municipales — et celle de la capitale ne fait bien évidemment pas exception — sont devenues un véritable enjeu sécuritaire face aux nouvelles formes de violences. In fine, les pouvoirs publics sont parvenus à transférer certaines compétences régaliennes aux maires, soucieux de combler le « vide » laissé par l’insuffisance numérique de policiers ou gendarmes dans les territoires.
Pour conclure avec la police municipale parisienne, après plus de quarante-cinq années d’âpres discussions, cette dernière a pu enfin ressurgir d’un lointain passer, successeur indirect de la police de proximité à laquelle elle a succédé vingt ans plus tard pour devenir une véritable police municipale, au service des Parisiens.