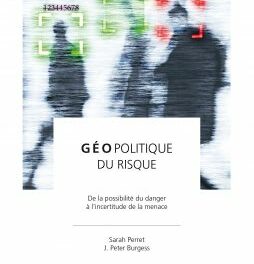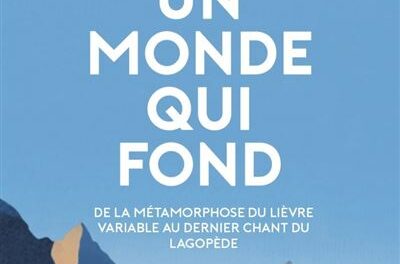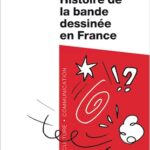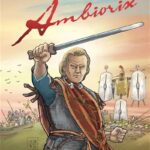À l’origine de ce livre : un dialogue sur la question de l’imaginaire des mobilités et l’apport de son étude pour comprendre le fait urbain. L’ouvrage est composé de deux parties. Dans une première, Anne JarrigeonAnne Jarrigeon est anthropologue, vidéaste et maîtresse de conférences à l’École d’Urbanisme de Paris. Chercheuse au laboratoire Ville Mobilité Transport, elle travaille sur les pratiques et les imaginaires de la mobilité. Nathalie Roseau est architecte, polytechnicienne et docteure en urbanisme. Professeure à l’École Nationale des Ponts et Chaussées, elle est directrice de recherche au sein du laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés. Ses travaux portent sur les dynamiques de transformation métropolitaine et la place qu’y occupent les infrastructures, leurs temporalités et leurs représentations. questionne les imaginaires de la mobilité. Pour l’anthropologue, l’imaginaire est le lieu privilégié de « l’entre-savoirs », un « tissu conjonctif entre les disciplines ». Interroger les imaginaires revient à interroger les significations sociales des mouvements.
Le propos d’Anne Jarrigeon est lors développé en quatre points : les pouvoirs de l’imaginaire, les circulations, les dissonances et les effacements. Le premier point pose les questions méthodologiques quant au recueil des représentations sociales. L’auteure se réfère aux travaux pionniers de Roland Barthes, Roger Caillois ou Alain Corbin en la matière. La solution semble être la « méthodologie diagonale » ou croisée, alliant mythocritique et mythanalyse. Ainsi aux corpus de textes ou d’images fixes ou animées s’ajoutent des matériaux plus hétérogènes tels que les observations situées, les discussions informelles, les scénographies muséales, les vêtements, les aménagements architecturaux, les plateformes interactives et les collections d’objets.
Le deuxième point installe le sujet d’étude. Anne Jarrigeon fait le choix d’interroger les imaginaires de la mobilité par des situations d’exposition et notamment celles organisées en 2022 à la Cité des Arts à Paris, Ces vies qu’on mène ; celle de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, en 2012, Circuler. Quand nos mouvements façonnent les villes ou encore celle de la Cité des Sciences et de l’Industrie, Des transports et des hommes. La multiplication de ces expositions semble faire prendre conscience d’un « mobility turn » conceptualisé par John Urry en 2000. La mobilité devient ainsi un autre moyen de dire le monde contemporain, pris entre un passé, dont le présent porte des traces ambivalentes et un avenir plus incertain.
Le troisième point analyse « l’enchantement » (Winkin, 2002) ressenti par le visiteur de ces expositions devant le spectacle d’une mobilité esthétisée et euphorisée. Parfois, des scènes anxiogènes comme les embouteillages automobiles deviennent de véritables objets esthétiques lorsqu’ils sont inscrits dans des séries d’images ou des montages construits par les rapprochements de motifs photographiques. Les expositions sont révélatrices, selon l’auteure, de la place prise par les tensions entre la fascination pour les promesses technologiques et la perception des crises écologiques, sociales et politiques qui s’annoncent.
Le quatrième point, enfin, la mobilité exposée semble tenir à distance ou dans l’ombre des sujets sociaux à l’instar des femmes. Les expositions donnent de puissants indices du fonctionnement très sélectif des imaginaires et des enjeux de représentation qu’il soulève. L’inégalité de traitement des personnes est bien au centre, par exemple, de certaines propositions de l’exposition Mobile/Immobile, avec notamment l’exploitation du fonds des archives nationales correspondant à l’invention puis à l’institutionnalisation des cartes d’identité et autres documents d’identification.
Dans une seconde partie, Nathalie Roseau passe en revue ce qu’elle nomme les « réalités de l’imaginaire ». « Que fait la mobilité à la Terre ? » : c’est la question à laquelle entend apporter des éléments de réponses l’architecte. Vue depuis l’architecture et l’urbanisme, les mobilités s’expliquent par l’histoire dont les récits rendent visibles les traces du mouvement.
À la notion d’anthropocène conceptualisée par le prix Nobel de chimie Paul Crutzen dans un article paru en 2002, Nathalie Roseau entend préférer la notion de « kinécène » qui consacrerait l’ère du mouvement et des mobilités. Du chemin de fer à l’avion, du télégraphe à l’internet, les innovations technologiques ont été le résultat d’un faisceau de découvertes, d’opportunités et de contextes. L’exemple de l’aviation permet de constater que l’invention des frères Wright n’aurait pu se réaliser sans l’intérêt des sociétés savantes, sans supports politiques, sans attentes sociales, sans demandes industrielles ou militaires. De balbutiante, l’aviation s’est développée à travers un « macro-système technique » (Thomas Parkes Hughes, 1970).
Si Anne Jarrigeon s’était tenue à l’étude d’expositions multiples sur le thème des mobilités, Nathalie Roseau multiplie les références à la littérature et au cinéma, à la philosophie et aux urbanistes. « Technique, temps, espace », écrit-elle, « ces trois termes permettent de déplier la matrice des causalités qui nourrissent les dimensions politiques, phénoménologique, sociale de la mobilité contemporaine. Pour cette urbaniste, les villes sont parmi les premières exposées aux conséquences dramatiques des risques de submersions et d’ouragans, de canicules et de sécheresses, de zoonoses et d’épidémies, du fait de leur forte densité de population et de l’importance des infrastructures de toutes natures. La ville constitue un sujet et une perspective pour se saisir du kinécène comme fait total.
L’ouvrage de Jarrigeon et Roseau amène le lecteur à réfléchir sur la construction de l’agir. Les imaginaires deviennent une source inépuisable de marqueurs qui peuvent aider les décideurs à saisir les alertes, à imaginer des scénarios possibles à imaginer de nouvelles infrastructures.