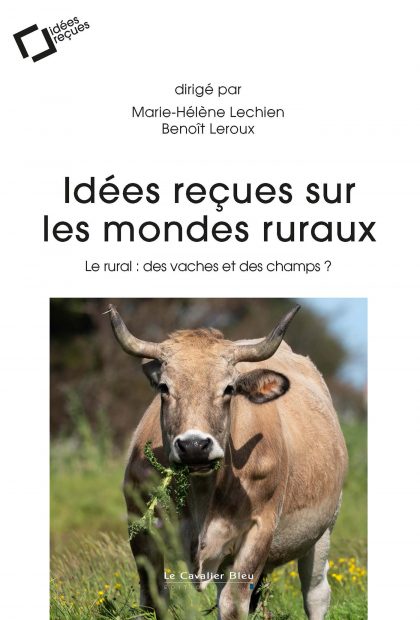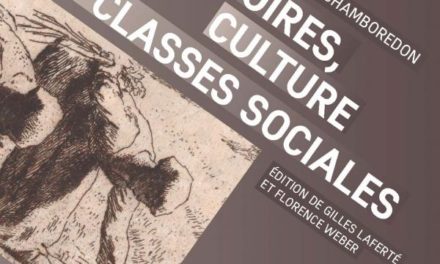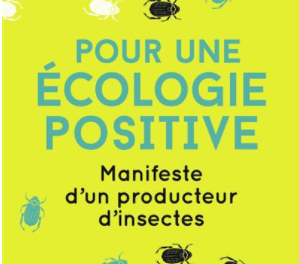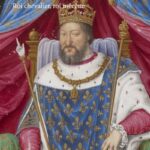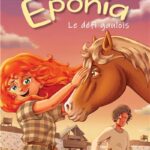La ruralité est souvent appréhendée comme une survivance du passé, un monde qui n’en finit plus de décliner, réduit à une seule réalité socioprofessionnelle : les agriculteurs « en crise ».
À cette première image vient s’ajouter, depuis le début des années 2000, celle d’un « refuge » pour les familles modestes exclues des territoires urbains. Ces nouveaux laissés-pour-compte viendraient, comme les agriculteurs, se rappeler au mauvais souvenir des élites en votant pour l’extrême droite. Paradoxalement, cet ensemble de représentations négatives va de pair avec une vision cette fois-ci positive, réactivée par les confinements sanitaires, celle d’une campagne verte et paisible où l’on peut se ressourcer et télétravailler.
Marie-Hélène Lechien est sociologue, maîtresse de conférences à l’Université de Limoges. Benoît Leroux est sociologue, maître de conférences à l’Université de Poitiers. Tous deux sont membres du Groupe de recherches sociologiques sur les sociétés contemporaines (GRESCO). À partir d’idées reçues tour à tour misérabilistes et enchantées, cet ouvrage propose de restituer les mondes ruraux dans leur hétérogénéité et leurs transformations passées et présentes.
L’ouvrage passe en revue une vingtaine d’idées reçues sur la ruralité, réparties en trois grandes parties : l’univers socioprofessionel des espaces ruraux, l’opposition ville/campagne et le climat social des campagnes. Une trentaine de chercheurs (sociologues, économistes, politistes, historiens, géographes, ingénieurs agronomes) ont été sollicités pour répondre à chacune des idées reçues listées.
Les espaces ruraux, des univers socio-professionnels d’abord populaires
Cette première partie revient sur la composition socioprofessionnelle des espaces ruraux et sur leur dynamisme économique. Les auteurs en font des territoires qui ne sont pas systématiquement en crise même si le secteur agricole, dans sa très grande diversité, peut faire penser que certains domaines sont en crise. Le recensement de 2020 montre que les territoires ruraux comptent, par exemple, 29% d’ouvriers, contredisant l’idée reçue que espaces ruraux sont synonymes d’espaces agricoles. Les auteurs étudient également la part de plus en plus importante prises par les femmes dans la population active rurale, que ce soit parmi les ouvrières mais également l’agriculture. La désertification des campagnes est également abordée sous l’angle de la disparition des commerces de proximité. En cela, les espaces ruraux suivent un mouvement qui est assez général et qui touche aussi bien les espaces urbains et périurbains.
Un monde arriéré, sans avenir ni État ?
Le travail des politistes et des sociologues montrent que les espaces ruraux ne sont pas espaces entièrement coupés de la ville et des interrogations urbaines. Dans les zones rurales et périurbaines, les ménages sont un peu plus motorisés qu’ailleurs (96% contre 79% en ville). Cette forte motorisation est le fait des populations les plus aisées, accentuant le fossé aves les populations modestes. Pour aller vite, les ménages ruraux roulent plus, avec des véhicules plus anciens et plus polluants. L’offre de soins en campagne se dégrade. Alors que de façon générale, la demande de soin augmente partout, l’offre tend plutôt à stagner, créant des disparités territoriales alors même que se décentralisent les politiques de santé publique en France. Désertification, raréfaction des services publics : ces deux sentiments sont-ils à l’origine d’un fort vote extrême droite dans le rural ? Aux législatives de 2022, le RN réalise des scores deux fois plus élevés dans les villages et les bourgs que dans les métropoles et leurs périphéries. Le discours du RN ne s’y trompe pas et évoque régulièrement la figure de l’agriculteur, archétype du travailleur-rural méritant qui ne parvient plus à vivre correctement de son labeur. Ce discours fait mouche. D’autant qu’il est repris par des « médias complaisants » qui reprennent en cœur les idées reçues analysées dans l’ouvrage.
Un monde convivial, gouverné par l’interconnaissance, laboratoire du futur ?
« À la campagne, tout le monde se connaît. » Voilà une idée reçue qui perdure dans l’imaginaire collectif et qui participe de l’archétype du monde rural. Pourtant les auteurs montrent que le développement des mobilités a élargi et diversifié les réseaux de connaissances en même temps qu’il a contribué à accentuer une spécialisation de certains espaces ruraux. Les campagnes résidentielles ou touristiques voient ainsi parfois des habitants coexister, sans pour autant se fréquenter. Le renouveau des mouvements sociaux (AMAP par exemple) ne sont pas des mouvements qui se développent qu’à la campagne. Le plus souvent d’ailleurs ce sont des mouvements qui viennent des espaces urbains, portés vers le monde rural par des néoruraux.
L’ouvrage est clair et rend bien compte des mutations récentes et plus anciennes que le monde rural a dû subir. Si certaines idées reçues sont tout de même datée, force est de constater qu’elles restent parfois encore dans la mémoire collective à la manière d’une « infrapensée » – terme emprunté à l’anthropologue Michel Agier – qui ne serait même plus conscientisée.