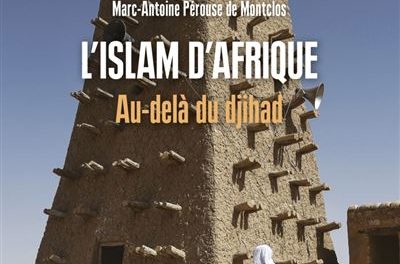Cet ouvrage, très dense, a été voulu par Anne Cornet et Patricia Van Schuylenbergh. Il s’agit avant tout d’un recueil d’articles et d’études désormais inaccessibles pour la plupart mais repris et remaniés consacrés à l’histoire du Congo belge. Matériellement, l’ouvrage est divisé en cinq parties comprenant chacune à chaque fois 3 chapitres thématiques complémentaires les uns des autres. Ceux-ci abordent de manière chronologique l’histoire du Congo belge, colonie emblématique des dérives et de la violence coloniale extrême depuis sa conquête par Léopold II en 1885 à l’issue de la conférence de Berlin jusqu’à son indépendance le 30 juin 1960. Cette somme retrace donc son histoire dans sa globalité en abordant des thèmes très divers liés à l’économie, la géopolitique, la religion ou encore les arts. Les articles, très référencés, n’oublient pas la méthode utilisée en n’hésitant pas à mettre en avant les sources utilisées et leurs éventuelles lacunes.
Cet ouvrage, très dense, a été voulu par Anne Cornet et Patricia Van Schuylenbergh. Il s’agit avant tout d’un recueil d’articles et d’études désormais inaccessibles pour la plupart mais repris et remaniés consacrés à l’histoire du Congo belge. Matériellement, l’ouvrage est divisé en cinq parties comprenant chacune à chaque fois 3 chapitres thématiques complémentaires les uns des autres. Ceux-ci abordent de manière chronologique l’histoire du Congo belge, colonie emblématique des dérives et de la violence coloniale extrême depuis sa conquête par Léopold II en 1885 à l’issue de la conférence de Berlin jusqu’à son indépendance le 30 juin 1960. Cette somme retrace donc son histoire dans sa globalité en abordant des thèmes très divers liés à l’économie, la géopolitique, la religion ou encore les arts. Les articles, très référencés, n’oublient pas la méthode utilisée en n’hésitant pas à mettre en avant les sources utilisées et leurs éventuelles lacunes.
ÉTAT DU CONGO. ÉTAT CONQUÉRANT, ÉTAT DE TRANSITION
La première partie revient sur la création et la gestion de cette colonie.
Dans un premier chapitre, l’auteur revient sur le projet de conquête du Roi Léopold II formulé dès les années 1870. L’auteur explique comment la place et rôle tenus par l’approche géographique du continent et comment les notions de bassin et d’Afrique centrale sont devenues des concepts géopolitiques incontournables dans le cadre de la conquête coloniale, où les rivalités religieuses s’invitent. 
Le rôle de l’explorateur Henry Morton Stanley Photo 1: Henry Morton Stanley, photo prise en 1871, recruté en 1878 par Léopold II et la manière dont il s’appuie sur la notion géographique de « bassin du Congo » sont analysés (p.38). Il est intéressant de relever que Stanley conçoit alors la colonisation comme un projet commercial et non géopolitique. Dès juin 1875, il présente son projet au Roi belge, basé sur la création d’une grande compagnie de commerce et de chemin de fer. Cet axe s’explique par le fait que l’Afrique est alors perçue comme une terre d’opportunités économiques comme le rappelle le mythe des «Indes africaines» qui se développe, avec en parallèle l’idée d’œuvrer en faveur de la civilisation en affirmant vouloir lutter contre l’esclavage. Cependant, l’idée d’une conquête pacifique, moralement irréprochable et validée par la communauté internationale, est vite modérée par les critiques. Ces dernières émergent dès avril 1891 avec la parution du Congo Mirror où Dennett, ethnologue en devenir, dénonce déjà la brutalité des agents de l’Etat (p. 49). Mais les observations formulées sur le terrain montrent cette complexité de la situation.
Épisodes d’un « grand désordre », 1880-1910
Le chapitre 2 revient sur le rôle et la personnalité d’Henry Morton Stanley, comparé avec Livingston qui le décrit comme : «solitaire dominateur, lisant la Bible et Shakespeare entre deux exploits » et souhaitant avant tout « toucher le public européen avide d’exotisme » (p.63). Mais la recomposition de l’Afrique n’est pas seulement voulue par Léopold II mais aussi par des seigneurs de guerre africains, arabes et swahili. Jean-Luc Vellut offre une analyse des liens complexes et hétérogènes entre les uns et les autres, entre alliances inattendues et résistances réciproques le tout sur fond de misère et de brutalités. Une de ses études s’attarde justement sur deux seigneurs Francis Danis et Ngongo Leteta, figure icônique, mort à la suite d’un complot unissant des officiers belges à un chef africain.
La violence qui prend de l’ampleur à partir des années 1890, et symbolisée par la pratique de l’esclavage qui perdure ou l’utilisation de la chicotte, fait l’objet d’une analyse revenant sur ses causes. Jean-Luc Vellut met en relief l’absence d’une armée régulière, le manque de contrôle efficace, la lassitude des hommes qui, peu à peu se transforment en potentat locaux. Mais, note-t-il dans le même temps, la mise en place d’un système capitaliste qui se greffe sur une économie de traite en violant, de fait, les droits de l’Homme, introduit aussi les germes de la contestation et de la condamnation de ces violences.
CONGO, COLONIE BELGE : VOLETS D’UN ORDRE COLONIAL
Ces éléments sont repris et développés dans la seconde partie, composée des chapitres 3 à 5. Il revient tout d’abord sur la notion de bloc colonial qui se définit comme étant une conjonction réunissant les professionnels du secteur public et privé en métropole et à l’échelon local (p. 95). Cette confusion est d’ailleurs visible avec la nomination dans les années 20 de M. LIPPENS en tant que gouverneur général alors que dans le même temps il est administrateur de sociétés du groupe de la Banque d’Outremer. Dès lors se pose la question du poids et du rôle de l’Etat. Jean-Luc Vellut souligne la déconnexion entre le monde politique de la métropole et le bloc colonial belge et l’explique par le fait qu’en 1908, la majorité catholique du parlement n’accepta l’annexion du Congo qu’à la condition que l’administration de la colonie soit indépendante des finances publiques belges (p. 96). Pour autant l’Etat est-il indifférent envers sa colonie ? Pas complètement dans la mesure où en 1931 à la suite de la révolte des Kwilu, une enquête suivie d’une purge administrative est mise en place.
Les chapitres 4 et 5 reviennent sur le peuplement européen, belge et portugais (ces derniers, représentant une minorité spécifique, traités à part). Trois aspects sont interrogés :
– l’image que l’Européen se donne de lui-même et qu’il souhaite lire dans le regard de l’Africain : Vellut revient sur l’expression de boula matari (« le briseur de roc »), expression qui désigne l’Etat et ses agents mais aussi plus largement l’Européen viril, admiré et accepté par les populations. Le lecteur averti fera de lui-même le lien avec l’œuvre d’Hergé, (non citée ici certes) car l’expression est employée dans Tintin au Congo p. 63. Quelques pages sont également consacrées à la place et l’image de la femme blanche, en opposition à la femme noire, la «ménagère» assimilable à une prise de guerre, une place de la femme pourtant contraire aux idéaux de départ. Les métis ne sont pas oubliés (p.127).
– la vision des vaincus : partie sans doute un peu moins documentée par manque de sources fournies mais elle relève la présence de cette image et cette perception de l’Européen située entre fascination et horreur.
MALAISES COLONIAUX
Après avoir pris une distance avec le terme même de « Résistance » dont le sens reste surtout lié à la Seconde Guerre mondiale en Europe, l’auteur revient à travers les trois chapitres sur les signes montrant qu’un malaise existe dès l’origine dans les colonies. Trois formes sont retenues : la contestation, la misère économique et l’application de la peine de mort.
La première forme est abordée au chapitre 6. Le point de départ de la contestation se situe selon Jean-Luc Vellut le 24 novembre 1876 avec le combat opposant l’expédition de Stanley aux Bakusu à proximité du confluent de la Lueki. Il distingue la période des résistances primaires de 1910 à 1925 et des initiatives prises par des personnalités comme Sombé, née vers 1890 et surnommée « Marie aux Léopards » ou encore la société Aniots. Le cas du mouvement kimbanguiste est également abordé. L’auteur revient sur un fait qui concerne tous les mouvements indépendantistes à savoir l’importance des études menées par les futurs nationalistes dans les structures européennes, religieuses ou étatiques qui les ouvrent sur les notions de liberté et de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. C’est ainsi qu’un mouvement de conscience noire émerge entre 1919 et 1921 avec à sa tête Paul Panda Farnana mais sombre dans la léthargie tout aussi vite jusqu’en 1940, léthargie qui se double d’un rêve noir américain.
Cette première approche se double avec le chapitre 7 d’une analyse de la pauvreté des populations qui souligne d’entrée l’écueil que tout chercheur en histoire sociale a dû affronter « nous sommes documentés sur la pauvreté dans la mesure où il en existe des traces dans les sources ». Ce chapitre revient difficilement de ce fait sur les différentes formes perceptibles de la pauvreté : les crises de subsistances et la famine de 1928-1929 et la notion de Welfare colonial qui émerge (p. 223) mais quelle est son efficacité et quels sont ses effets ? La misère quotidienne reste quant à elle mal connue car minimisée par les Européens. La croyance selon laquelle les Africains n’ont besoin de rien tandis que les relevés notariaux ne prennent pas en considération les spécificités locales contribuent à occulter en grande partie par cette méthode l’approche du phénomène pourtant réel. Les solutions recherchées existent pourtant mais elles sont souvent passéistes si l’on compare sommairement la situation en métropole et au Congo.
Le troisième malaise perceptible et exposé dans le chapitre 8 concerne le cas de la peine de mort. Prévue dès 1886, ce chapitre revient sur quelques cas particuliers illustrant son application inégale en fonction des lieux et des circonstances, dont l’exécution de Mussafiri Bwana François le 22 septembre 1922, condamné à mort pour le meurtre d’un européen sur fond d’adultère (p. 260)
COMMENT RÊVER L’ÂME DU CONGO
La quatrième partie regroupe une série d’études successivement consacrées à l’art africain, à son émergence et à sa reconnaissance en Europe, puis à la présence de la religion chrétienne abordée par le biais du développement du culte de la Vierge Marie au Congo. Phénomène de masse évolutif qui englobe à la fois le spirituel et la vie quotidienne, le thème du syncrétisme est brièvement abordé, montrant que parfois le sens chrétien de certains symboles s’efface comme celui du crucifix kongo, interprété comme le carrefour entre le monde des morts et des vivants.
Puis, enfin il revient sur l’une des figures du roman national congolais Simon Kimbangu. Héros populaire, prophète et thaumaturge qui aurait reçu en avril 1921 une vision prophétique annonçant l’indépendance. Le chapitre 11 revient sur la manière dont la légende s’est construite d’une part en revenant sur la stratégie du Parti Communiste belge qui l’intègre dans le cadre de sa lutte contre l’impérialisme dans les années 20, et d’autre part comment son image se diffuse dans la culture populaire par l’intermédiaire de l’œuvre de Serge Diantantu, auteur de bande dessinée et d’une trilogie consacrée au prophète. Ce chapitre est aussi l’occasion pour Jean-Luc Vellut d’effectuer une digression et de revenir brièvement sur la manière dont Tintin au Congo a été reçu par les européens ayant quitté la métropole (p. 339) mais aussi et surtout d’interroger les matériaux pour l’histoire qui permettent d’appréhender ce phénomène : l’autobiographie de Simon Kimbangu, les écrits des témoins et des intellectuels de l’époque. Le roman national suppose en lui-même une part de mythe et de légende, et celui du Congo n’y échappe pas en établissant pas exemple des liens, fictifs, entre le prophète et le mouvement noir américain. La volonté d’inscrire le kimbanguisme et son fondateur relève aussi d’une tentative de l’intégrer à un mouvement international plus vaste, en insistant sur son caractère non-violent, manière de le mettre au même plan international que Gandhi et Martin Luther King (p. 359) tout en alimentant sa dimension de martyre chrétien. Mais ces exemples montrent surtout que la colonisation n’est pas subie passivement par la population contrairement à qu’une certaine apathie pourrait laisser croire.
RIDEAUX SUR UN TEMPS COLONIAL
La cinquième et dernière partie propose une synthèse sur la lente remise en question de la colonie belge et sa fin en 1960. Le chapitre 12 revient sur les signes d’inquiétude qui émergent et à une certaine prise de conscience de la part des Belges face à la situation, d’autant qu’elle est vivement attaquée et critiquée par le reste de l’Europe. Les années qui précèdent et qui suivent la Première Guerre mondiale voient ainsi émerger divers projets de remise en question des empires coloniaux dont celui d’Eurafrique. Mais ces projets n’ont pour but que de servir un nouvel ordre international conçus entre puissances européennes sans l’avis des Africains. Il est intéressant de relever que les Européens ont tenté d’intéresser Hitler à la question, comme par exemple le mouvement allemand de revanche coloniale. Mais ce dernier ne conçoit pas la colonisation en dehors de l’Europe selon la logique qu’il développe dans Mein Kampf. La Grande-Bretagne quant à elle, tente d’intéresser Hitler en lui proposant un projet basé sur l’idée de généraliser le système de la porte ouverte et d’internationaliser l’investissement en Afrique centrale. En 1938, Pirow, Ministre sud-africain et admirateur du Reich conçoit de son côté un projet de Mittleafrika ayant un double emploi : offrir un foyer de peuplement aux Juifs d’Europe, et répondre à une crainte des Afrikaners en leur assurant par ce moyen une protection contre de futures invasions noires provenant du Nord et orchestrées par la France et l’Italie (p. 419). Puis plus largement l’auteur revient sur la place et le rôle de l’Afrique coloniale dans la Seconde Guerre mondiale. Malgré la faiblesse de sa dimension militaire (15 000 hommes peu équipés et peu formés), l’écroulement du gouvernement belge en juin 1940 laisse un vide politique au Congo, menacé « de devoir devenir un bien sans maître » (p. 437). L’opinion est alors partagée entre ceux qui souhaitent un maintien de la neutralité et l’application du principe de la porte ouverte et les autres appellent à une participation active du Congo à la guerre en appuyant l’effort de guerre de la Grande-Bretagne. Cette dernière tendance, encouragée par cette dernière, finit par l’emporter. A la fin de la guerre le silence s’impose en Belgique sur les événements de la période vécus dans sa colonie, ce qui soulève la question des jeux de la mémoire historique. Les chapitres 14 et 15, pour finir, reviennent sur les signes de l’agitation et les éléments de tensions perceptibles dans les années 50. L’émergence d’un espace public congolais, qui s’exprime à travers des publications comme la voix du Congolais, commence à dénoncer ouvertement le mépris des Européens et les mauvais traitements dont ils font l’objet. Cette situation est constatée dès la fin de la Seconde Guerre mondiale par une commission sénatoriale qui dénonce en 1947 les conditions de détentions dans la prison de Léopoldville. Le dernier chapitre revient sur les étapes et les conditions amenant le roi Baudouin le 13 janvier 1959 à annoncer à la surprise générale sa volonté d’amener le Congo à l’indépendance. L’ouvrage se termine avec une analyse recontextualisée du discours prononcé le 30 juin 1960 par Patrice Lumumba Photo 2 : Patrice Lumumba en janvier 1960 .