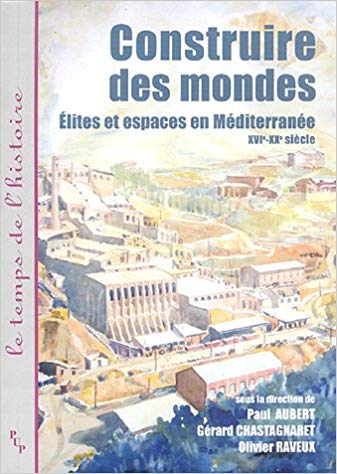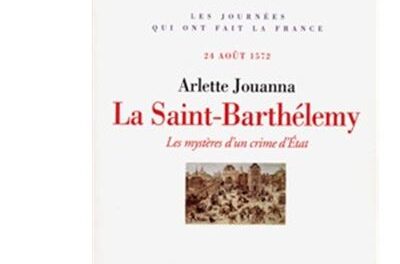Constitué d’un avant-propos en guise de programme fédérateur aux diverses contributions, cet ouvrage de recherche est le fruit d’un colloque tenu en 2001 à Aix-en-Provence, où ont collaboré historiens et civilisationnistes (hispanistes, italianistes…). Au-delà de titres de communications d’apparence très spécialisés, voire abscons pour des néophytes, les organisateurs proposent un jeu permanent sur les échelles afin de montrer la plasticité des espaces méditerranéens, modulant les dimensions en fonction des acteurs et des intérêts. Cette perspective offre une claire illustration du fait que les espaces ne sont en rien naturels et pérennes, mais qu’ils sont toujours construits historiquement, socialement, économiquement, politiquement et culturellement. Les dix-huit communications présentées dans ce volume possèdent deux traits communs qui renforcent ce constat : elles relèvent toutes de sujets méditerranéens et elles analysent les rapports des élites avec la formation de l’espace.
Une première catégorie d’articles traite plus particulièrement des espaces locaux – partie intitulée « La structuration du proche », et les thèmes traités portent sur des espaces limités qui peuvent donner l’impression d’être apposés les uns à côté des autres. Ainsi, pour Monique Chalvet, les mutations de la forêt provençale au XIXe siècle relèvent de la mobilisation des élites locales en fonction des intérêts. Face à la nouvelle administration des Eaux et Forêt née sous la Restauration, ces élites défendent d’abord l’agriculture pastorale, d’un plus grand rapport financier pour les collectivités locales. La collaboration naît de la prise de conscience des dangers d’incendie à partir de la deuxième moitié du siècle, et on assiste à une réorganisation des espaces forestiers avec le reboisement et le regazonnement des montagnes. A ce saltus qui n’a plus rien de sauvage depuis des millénaires, l’analyse de l’exploitation des plaines littorales corses et sardes depuis le XVIIe siècle par Francis Pomponi renvoie au problème de l’action de l’homme, et en particulier des élites politiques, qui sont plus ou moins entreprenantes pour lutter contre l’insalubrité et la malaria et pour transformer ces plaines en espace humanisé et productif. La question de l’eau constitue une des caractéristiques permanentes du monde méditerranéen. L’action de la classe dirigeante florentine en faveur de la construction de deux ponts sur l’Arno illustre cet intérêt porté à la maîtrise de l’espace, mais aussi ses limites puisque l’analyse de Marco Cini, fondée sur les archives de la Società anonima per la costruzione di due ponti sull’Arno entre 1831 et 1836, démontre l’échec de cette initiative productiviste réside dans l’incapacité des élites à se fédérer autour d’un grand projet. A la jonction des espaces ruraux et des espaces urbains, les colonies industrielles catalanes surgissent au milieu du XIXe siècle du décollage de l’industrie catalane, et occupent les moyennes vallées du Llobregat et du Cardoner. « Ce chapelet de morceaux de ville en pleine nature » se compose généralement d’une église et d’une maison de maître qui encadrent la masse des maisons ouvrières, aboutissant à former une micro-société industrielle distincte et éloignée de quelques kilomètres de la municipalité de rattachement, possédant des fonctions économiques, spirituelles et temporelles nettement marquées dans l’espace. Face à cet impact industriel sur l’espace vécu – et de facto sur la société catalane – décrit par Gracia Dorel-Ferré, la réflexion de Xavier Daumalin porte elle sur l’échec des entrepreneurs marseillais à étendre les activités traditionnelles de la soude (et donc du savon) à d’autres secteurs industriels, malgré un démarrage qui a été entamé au XVIIIe siècle : faut-il invoquer une désindustrialisation et une « pastoralisation des économies régionales » consécutives aux guerres révolutionnaires et impériales et au protectionnisme de la Restauration ? Lucien Fagion a choisi une échelle spatiale réduite : celle de la vallée de Valdagno dans le Piémont alpin proche de Vicence pour étudier les élites notariales du XVIe siècle. Dans cet espace, s’exercent les forces d’acteurs divers : patriciat vénitien, bourgeois de Vicence, élites urbaines, tels ces notaires de Trissino auxquels l’auteur s’attache plus en détail, et simples paysans du Contado (domaine rural proche et dépendant de la cité italienne).
L’espace urbain est traversé par les tensions entre les forces économiques : les cas de Valladolid et de Barcelone sont examinés respectivement par Philippe Lavastre et par Stéphane Michonneau. Le premier reconstitue l’accumulation du capital foncier valisolétain au lendemain des désamortissements du XIXe siècle car ces ventes des biens monastiques offrent de nouveaux investissements qui renforcent l’homogénéité sociale des quartiers, et cela d’autant plus qu’il n’existait pas dans cette ville d’ensanche (plan d’agrandissement urbain) à la différence de nombreuses cités espagnoles, dont Barcelone. Toutes les villes possèdent leurs espaces imaginaires, fruit d’un passé recomposé que les toponymes (noms de rues, carrefours) et monuments (statues, édifices…) re-traduisent dans la mémoire de citadins. A la jonction du XIXe et du XXe siècle, les singularités catalanes décalent leurs lieux de mémoire, à mesure du déplacement des symboles identitaires. Outre les quartiers, les parcours et la géographie des dons offrent de nouvelles perspectives pour cette géographique urbaine appliquée à la mémoire barcelonaise.
Après ces approches très circonscrites de la première partie, dont certaines appellent le recours à la micro-histoire et à des espaces interstitiels, la seconde partie du volume décrit de plus vastes espaces au moment des recompositions nationales. Ce point de vue permet de réfléchir sur la pertinence de la notion d’espace national dans le monde méditerranéen puisque l’existence de l’Etat-Nation n’y est nullement une évidence, comme les dernières guerres balkaniques du XXe siècle sont venues le rappeler. Les trois contributions de Michel Sivignon, d’Anne Couderc et d’Etienne Copeaux ouvrent cette partie par des études sur le monde turc – les deux premiers partant de la représentation cartographique du monde hellénique à l’époque ottomane, et le troisième analysant un corpus de cartes scolaires du XXe siècle. A divers titres, ces trois textes offrent des perspectives intéressantes car l’absence d’Etat-Nation et la dilution des peuples dans des espaces irréductibles au modèle français forcent à s’interroger. Ainsi, la production grecque de cartes au début XXe siècle est le fait d’une diaspora qui recompose un espace mental plus que géographique : « la carte de l’édition grecque [début XIXe s.] est une carte dont la Grèce est absente » note le premier auteur p.158. Pour le second, le modèle d’organisation du territoire grec provient indirectement du modèle révolutionnaire français, importé et adapté en Bavière à l’époque napoléonienne, puis réexporté de Bavière vers la Grèce en 1833-34 (p.165) par le roi Otton Ier et ses conseillers. Enfin, depuis 1931-1932, face à l’Occident hellénophile, l’historiographie turque utilise la cartographie historique pour démontrer une « antériorité absolue des Turcs dans l’histoire de la civilisation » (p.185). Dès lors, l’historien peut essayer de reconstituer les voies de cet « atlas imaginaire », atlas qui, à son tour, donne du sens à l’espace vécu par les Turcs. Les deux contributions suivantes portent sur l’Espagne et sur sa dimension nationale. Insistant sur les péripéties de la dichotomie entre territoire, nation et Etat, Paul Aubert décrit les évolutions des divers régimes devant le problème de la construction nationale, à travers les trois constitutions (de 1876, de 1931 et de 1978), et par les perceptions des « périphéries » face à une Castille considérée par les partisans d’un Etat fort comme la métonymie de l’Espagne. Par les voies de l’art, la construction de l’idée nationale progresse aussi au XIXe siècle, d’après Pierre Géal, puisque le principe même des écoles dites nationales, développé par Winckelmann, est adopté dès l’ouverture du Prado en 1819 et devient la règle d’exposition ; ce qui présuppose une continuité et une unité entre des artistes d’époques et de lieux différents à cause d’une origine nationale supposée commune : l’Espagne. Les élites acceptent ce principe d’homogénéisation culturelle qui renforce l’idée d’une nation unique, et pourtant composite, et appuie sa légitimation intellectuelle. Pour sa part, la bourgeoisie négociante italienne de Livourne qu’étudie Samuel Fettah, participe aux combats de l’unité nationale et, en 1860, l’intégration des autres “nations” marchandes (principalement juive et grecque) devient effective, en dépit de trois décennies suivantes durant lesquelles la ville subit une authentique crise d’adaptation au nouveau cadre national italien.
A ces six communications, qui illustrent les apports spatiaux des unités nationales en construction, une dernière partie, plus courte, est consacrée, non plus à l’homogénéisation du territoire, mais à la mobilité « au-delà des frontières ». Dès l’époque moderne, le commerce participe à ce type de mouvement, et le négoce de la cochenille mexicaine, insecte dont le produit permet la teinture, favorise le rayonnement et l’enrichissement des marchands marseillais. Gilbert Buti souligne la nouvelle dimension prise par la cité phocéenne lorsqu’elle franchit les frontières méditerranéennes pour aller redistribuer la cochenille dans toute l’Europe septentrionale. Par le biais d’une biographie, celle d’Hilarion Roux (1819-1898), un ancien commis de Rothschild à Marseille, Gérard Chastagneret dessine les stratégies spatiales qui affectent le redéploiement financier et industriel effectué à partir de la production de plomb au cours du XIXe siècle, production dont l’Espagne était alors le premier pays exportateur. Les jeux d’échelles varient selon la matière première et les marchés d’exportation ; ils épousent les frontières fluctuantes, les oscillations commerciales et les politiques douanières, pour enfin déborder du bassin méditerranéen : la mobilité est encore de mise. Avec le cas de l’adaptation génoise à la formation de l’unité nationale italienne, d’abord contraintes par les troupes piémontaises en 1849, on assiste à la collaboration des élites de l’ancienne république marchande, rompues au commerce et aux emporions coloniaux, avec la nouvelle puissance italienne, considérée partiellement au moins comme étrangère. Pourtant, ces élites réussissent leur intégration et bénéficient de ce nouvel espace national, suivant pour cela la recommandation de Cavour de « s’éloigner de la Méditerranée » (p.295) ; les milliers d’Italiens à destination de l’Amérique s’embarquent à Gênes. La dernière communication largue un peu plus les amarres méditerranéennes pour s’intéresser aux stratégies entrepreneuriales actuelles dans le secteur de la micro-électronique : malgré la puissance américaine, pourquoi reste-t-il des “managers” formés outre-Atlantique s’attachant à « investir dans l’Europe des cités Etats » s’interroge Sylvie Daviet ?
La réunion d’articles qui peuvent paraître fragmentaires au lecteur est un des risque de ce genre d’ouvrages – les publications d’actes de colloques puisqu’il s’agit de rassembler les thèmes fédérateurs afin de trouver comment la, ou les notions-clés sont mises en perspective. Ici, les jeux d’échelles, les stratégies spatiales, et les descriptions des remodelages frontaliers soulignent l’importance du fond méditerranéen et précisent sa fragilité face aux diverses épreuves de la temporalité.
CR par Alain Hugon – université de Caen