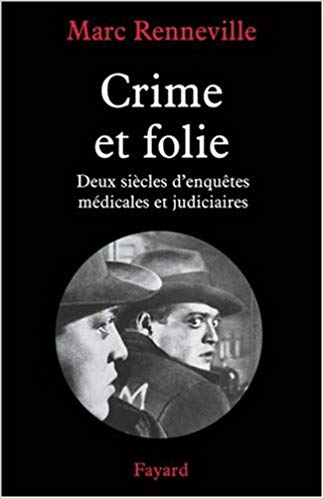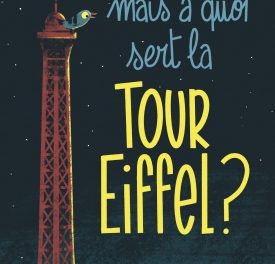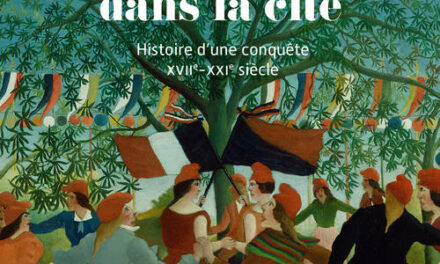Marc Reneville, maître de conférences à Paris-VIII, est connu comme l’historien de la phrénologie (cette méthode qui consistait à évaluer les capacités et l’intelligence humaine en fonction de la taille des crânes, au XIX° siècle). A la suite des travaux de Michel Foucault et de Robert Castel, Marc Renneville se penche sur la généalogie, la pratique et les conséquences d’une évolution : celle de la vision médicale, juridique et culturelle du criminel comme malade, entre un XVIII° siècle de la déraison complète à une médicalisation progressive aux XIX° et XX° siècles.
Le droit d’Ancien régime présente le criminel comme le représentant de la « déraison totale » et comme la figure de la « folie criminelle », genre inguérissable. Le XIX° siècle, à la suite des travaux médicaux, considère progressivement le grand criminel comme un malade qu’il faut soigner en plus de l’écarter de l’espace social. Le criminel devient le représentant de la « folie du crime », genre partiellement guérissable.
Un autre aspect de cette évolution tient dans la lutte entre juristes et psychiatres : que faire des grands criminels ? Comment les écarter de l’espace social ? Faut-il les écarter définitivement ? Sont-ils guérissables ? Comment leur permettre de réintégrer la société ? Plusieurs théories s’avancent, comme celle de la « bosse du crime » liée à la phrénologie, comme celle du « criminel-né » qu’il s’agit de reconnaître et de traquer ; les psychiatres dès la fin du XIX° siècle luttent contre ce lien entre crime et folie en raison de l’absence de « déraison complète » (cf. les crimes des foules).
Dans le même temps le législateur s’interroge : comment répondre aux inquiétudes de l’opinion publique que certains crimes odieux radicalise ? répression à tout crin ? soins comme réponse unique ? S’il se veut d’abord pragmatique dans son approche, le législateur joue entre trois tableaux : la répression comme réponse aux inquiétudes publiques, le suivi médical en prison ou dans des institutions spécialisées comme réponse aux scientifiques, l’appui aux nouvelles sciences (neurobiologie aujourd’hui) comme tentative de reconstruction des individus.
Un dernier élément est abordé, avec intérêt et force informations, par l’auteur, celui de la diffusion culturelle de cette interaction crime/folie, par la presse populaire, les chroniques judiciaires, la télévision et le cinéma : production scientifique comme production culturelle « participent au façonnage d’un imaginaire partagé » (p.15).
Le travail de Marc Renneville est organisé en quatre parties thématiques – ce qui ne facilite pas toujours la lisibilité, même si les thèmes sont bien précisés.
Une première partie cherche, d’une manière fluide, à expliquer la nature du crime d’après les textes de lois et les légistes, de Beccaria à Tocqueville, insistant sur les évolutions des lois pénales, comme cette loi de 1791 qui applique un traitement différent aux fous et aux criminels, première victoire nuancée des réformateurs dans leur volonté de créer un homme neuf, le révolutionnaire que l’éducation peut transformer et rendre bon. Les travaux de Cabanis qui dès 1790 veut faire des prisons des « infirmeries du crime » (p.48) en sont le reflet. Au même moment les premières expérimentation de Philippe Pinel, fondateur en France de la psychiatrie, posent que « les fous sont des malades et non des pêcheurs ou des débauchés ; et qu’il ne faut surtout pas les confondre avec les… criminels ». Son objectif est de soigner les passions, considérées comme les causes et les symptômes de l’aliénation mentale : commence la grande époque des aliénistes. Maladies/santé, raison/aliénation, enfermement/soin, sont les grandes questions que médecins, juristes et policiers vont se disputer tout au long du XIX° siècle. Un chapitre résume ces interrogations : « connaître les criminels, aider les prisonniers », où les études précédentes de l’auteur sur la phrénologie sont réexpliquées avec grande clarté.
La deuxième partie s’interroge plus précisément sur les aspects judiciaires : comment juger un fou s’il l’est ? Les phrénologues, particulièrement sous la monarchie de Juillet, sont parfois utilisés comme experts auprès des tribunaux. La « monomanie homicide » (divisible en kleptomanie, pyromanie, etc.) est étudiée par les disciples de Pinel (comme Esquirol) afin de comprendre la place de la liberté et de la volonté de l’individu dans ses actes : s’il est conscient et libre de ses actes, qu’il soit jugé ; s’il est prisonnier de ses passions donc de sa maladie, qu’il soit soigné ! Plusieurs cas (pp.107-109, très vivants) sont présentés et leurs avocats utilisent ses travaux pour obtenir un éventuel acquittement : l’hérédité est un argument qui semble faire mouche. Assassinats d’enfants, cannibalisme, absence de jugement moral : pour ces cas-là, tous les aspects de la recherche médico-légale, qui naît à ce moment-là, sont expérimentés dans les tribunaux. Progressivement, dans les années 1830/1840, sous l’influence des « théories sur la pauvreté » (p.117) s’impose le principe de limitation de la liberté individuelle, donc de sa responsabilité pénale.
Dans le même temps, les aliénistes débattent fortement de la monomanie homicide, chacun tentant d’imposer un point de vue majeur sur l’autre (qui est le plus malade, le démonome, l’érotomane, le pyromane, le lycanthrope, etc.) : ces controverses aux influences médico-judiciaires permettent de relativiser la part de la conscience dans les actions humaines : c’est la fin complète des théories d’ancien régime. Il n’existe pas de folie totale, les criminels sont donc des patients à soigner. La suite des controverses médicales poussera, par l’étude de cas particuliers bien décrits par l’auteur, à complexifier les théories médicales. Bénédict-Augustin Morel étudie la place de l’hérédité dans les actes de folie apparente et publie en 1860 son « Traité des maladies mentales » dans lesquelles il définit les maladies mentales par leurs causes, dont la première est une folie héréditaire, classée en quatre sous-classes : le nerveux congénitaux, les fous moraux, les maniaques instinctifs et les idiots. Il insiste sur la nécessité de démontrer le caractère pathologique d’un accusé en étudiant sa vie et sa famille – méthode toujours adoptée aujourd’hui…
Mais comment enfermer les malades-criminels, les observer, les soigner ? Le modèle vient d’Angleterre où le « Criminal Lunatic Act » de 1800 enferme le fou criminel et où est construit en 1808 le premier asile pour aliénés criminels. La France n’en dispose pas, entre prisons communes et asiles comme Charenton il n’existe pas de maison mixte. Et à l’intérieur de ces établissements, comment répartir les malades ? En fonction de leur dangerosité sociale ? médicale ? En 1876 est ouverte une annexe asilaire à la prison de Gaillon (Eure). Mais les autres structures restent le choix entre prisons communes, même aménagées, et asiles comme Saint-Anne, à Paris. Dans le même temps, l’essor de la psychologie pathologique (qui remplace la phrénologie), de la préhistoire et de l’anthropologie physique permettent à la science médico-légale de s’inscrire dans la rivalité science/Eglise en même temps que se développe dans la littérature la figure du criminel (Eugène Sue ; Maxime du Camp, adepte de la relégation des malades dans les bagnes) pathogène, ouvrant la voie au naturalisme.
La troisième partie présente l’évolution de ces réflexions autour de la question de la représentation du criminel : existe-t-il un type physique du criminel ? Cesare Lumbroso (1835-1909), le fondateur de l’anthropologie criminelle, et chef de file de « l’école positiviste italienne », tente de répondre le premier à cette question. Les pathognomonistes (type criminel en fonction de la physionomie) collectionnent les photographies de criminels pour s’assurer, sans réel succès, d’un type criminel que la littérature (Zola), le théâtre, la peinture et le cinéma (« Dracula » de Bram Stocker) utiliseront, quand Bertillon s’inspirera des études des uns et des autres pour dresser en 1883 le premier fichier anthropométrique des criminels pour trouver les récidivistes, système généralisé après qu’il a permis en 1892 d’arrêter l’anarchiste Ravachol. L’anthropométrie est à son heure de gloire, permettant de mettre un terme relatif aux inquiétudes récurrentes sur la « perte des repères ou des valeurs de la société » (p.260) : cerner le criminel et expliquer son comportement permet une « reprise du contrôle des corps et des esprits » qui rassure à défaut de soigner. Le « péril sur la civilisation » (Frédéric Le Play) trouvait ainsi une solution par un instrument de lutte contre les éléments qui menaceraient sa pérennité. Très efficaces pages de Renneville sur ce sujet. La relégation dans les bagnes lointains, prônée par Maxime du Camp, cesse en 1898 vers la Nouvelle-Calédonie et en 1938 vers Cayenne, après les enquêtes d’Albert Londres.
Et les foules ? Peut-on leur appliquer les mêmes critères qu’aux simples individus ? Renneville étudie la vision médico-sociale de la psychologie des foules : contagion morale, poids de la suggestion interne, analogie du peuple avec les sauvages, donc propension à la destruction, l’anarchie, expression collective de la laideur et de la peur incontrôlable. Les études les plus abondantes sont liées à la Commune de 1871, étudiée par Taine. La foule des Communards est d’autant plus inquiétante qu’elle est peuplée de femmes, les « pétroleuses » de 1871. Gustave Le Bon puis Sigmund Freud donneront un sens scientifique à ces inquiétudes. Se développe après la première guerre mondiale le primitivisme autour de l’image du « psychopathe indigène » que les combats de la première guerre ont permis de cerner : c’est la naissance de l’ethnopsychiatrie, « expression de la folie du crime modelée par les préjugés de la colonisation » (p.298).
La quatrième partie enfin s’attache à deux éléments : le poids de la psychanalyse dans l’évolution de la science médico-légale, et le poids culturel du couple crime/folie. La théorie mécaniste des instincts, utilisée depuis Freud et jusqu’à Lacan (qui la rejettera) par la psychanalyse, permet d’expliquer les crimes d’enfants par des instincts criminels, dont la figure de l’homme criminel qui « voue un culte à sa mère et méprise les femmes » sera utilisée par les productions culturelles. D’autres interprètent les crimes gratuits comme une démence précoce. Les sœurs Léa et Christine Papin, accusées d’avoir assassiné leur patronne et sa fille en 1933, avec force tortures, sont l’objet d’un « engouement médiatique » important, et presqu’automatiquement condamnées et envoyées en hôpital psychiatrique, sans que les psychiatres se soient accordés sur leur cas médical : l’acte gratuit, incompréhensible, suffit à l’internement. Les enfants de criminels sont également l’objet d’un suivi particulier des tatônnements de la science, autour des notions de « perversités instinctives ».
Pour Albert Petit, en 1900, les délinquants intermédiaires entre fous et criminels sont « une catégorie spéciale de fous moraux », irresponsables et malades souvent héréditaires. Les asiles d’aliénés sont le lieu où le dépistage, la prévention destinée aux futurs aliénés criminels, peuvent être mis en pratique, comme en Italie à partir de 1904. Paul Gorguloff, l’assassin de Paul Doumer en 1932, est condamné à mort et exécuté en pleine polémique sur la prévention qui aurait été possible sur son cas, avant le geste. La nouvelle politique criminelle qui se met en place progressivement tend à régler la peine à la fois en fonction de l’acte et en fonction de la personnalité de l’accusé. Dans le même temps se multiplient les projets d’asile-prisons pour écarter définitivement tous les criminels en puissance ou actifs, malades déclarés ou possibles. Un décret de 1936 crée des services d’examens psychiatriques dans les prisons parisiennes, qui sont ensuite étendues par les réformes de 1945 et 1986 à tous les services pénitentiaires français.
Les derniers chapitres du livre sont sans doute les plus immédiatement intéressants pour des professeurs du secondaires, à défaut d’être les plus originaux ou les plus novateurs. L’auteur cherche à présenter et apprécier la manière dont les productions culturelles abordent l’image du criminel et son évolution en parallèle avec les efforts de la science. Le premier film lié au sujet a un objectif médical, celui de filmer les malades des hôpitaux de Varsovie et Saint-Pétersbourg, afin de constituer progressivement une cinémathèque destinée aux étudiants et médecins. Le crime et ses liens avec la folie sont, avec l’amour, une des thématiques les plus présentes dans le cinéma et la littérature. Le cinéma fantastique allemand, par exemple, présente « l’image sociale de la folie du crime » (p.388) en reflétant les trois caractères sur lesquels les médecins s’affairent aussi : la transgression de la loi, la monstruosité des actes, la peur venue du malade ou éprouvée par l’entourage. Le « Docteur Mabuse » ou « M le Maudit » de Fritz Lang, tirent leur enchevêtrement psychodramatique des théories scientifiques de l’époque. L’auteur remarque que les fous criminels à l’écran sont en majorité des hommes, sans que ce soit vrai dans la réalité. La dérangée Violette Nozière ou les criminelles sœurs Papin sont des raretés cinématographiques. Des films ont participé à la diffusion des théories psychanalytiques, comme ceux tirés des romans de Georges Simenon : le retour mental sur la scène du crime par la narration de son déroulement est une trame classique des aventures de l’inspecteur/psychanalyste Maigret.
Un aspect du sujet sur lequel l’auteur ne s’étend pas est l’analyse des conséquences racialo-hygiénistes des théories de pureté de l’esprit et des corps, des mesures prises contre les « parasites » et « membres gangrenés » du corps social comme le programme T4 allemand appliqué par les nazis contre les handicapés.
Exprimant indirectement sa filiation historiographique avec « l’Histoire de la folie à l’âge classique » de Michel Foucault, l’auteur s’y rattache par le sujet et ses sources premières – la littérature médicale ou les sources judiciaires, par exemple, mais s’en détache par trois éléments. Le premier est l’approche sociologique : pas de « grand renfermement » chez Renneville, la problématique dans/hors de la société n’est abordée que sous l’angle juridique et culturel, pas de vision de l’ordre social sous l’angle répressif. Le deuxième élément de différenciation vient des sujets exploités : Renneville apporte à l’analyse de Foucault l’angle culturel du long terme qui manquait, et ne dit rien des projets bâtis (les prisons) et peu de la surveillance sociale et policière qui découle de la méfiance vis-à-vis de l’aliéné (hors quelques lignes sur Bertillon, bienvenues). Le dernier élément de différenciation vient de l’image donnée de l’aliéné-criminel, étudié dans son aspect anthropologique et culturel, et pas uniquement dans sa vision autorité/répression. Bref, Renneville ne remplace pas Foucault, il le complète à la lumière des approches des travaux historiques des deux dernières décennies. C’est une vision décomplexée (déidéologisée ?) des relations entre crime et folie qui est ici présentée, avec les mêmes armes et des questions nouvelles.
L’auteur achève sa longue étude sur les conséquences juridiques contemporaines liées au couple crime/folie, comme celles du nouveau code pénal de 1994, qui tend à une plus forte pénalisation des « anormaux », notamment pour les crimes sexuels. Une enquête parlementaire, publiée en 2000, chiffrait à 30% le nombre de malades mentaux présents sans soins dans les prisons françaises, chiffre repris par Véronique Vasseur, médecin-chef de la prison de la Santé. Si la pénalisation du crime est en marche, la prise en compte des malades dans le crime est encore lacunaire.
En-dehors de son aspect très utile à tout lecteur pour sa présentation riche, rigoureuse et vivante du sujet, le style même de Marc Renneville, en plus de ses approches nouvelles et fertiles du sujet, vaut le détour. Certaines descriptions de criminels comme Ravachol peuvent aussi permettre de se représenter la société française en 1900. Afin d’illustrer sa connaissance du sujet, on peut compléter le cahier iconographique central avec ceux des écrits de Michel Foucault, comme celui de « Surveiller et punir », qui s’attache à l’étude de la transformation des prisons françaises du XVIII° au XX° siècle. Deux ouvrages liés dans le temps, malgré et par leurs différences, à lire en parallèle.
Hugo BILLARD