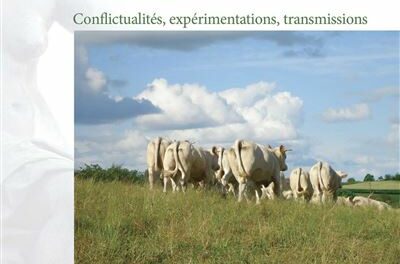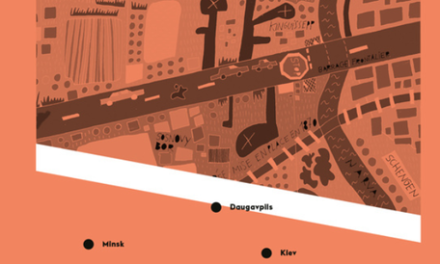Une histoire de femmes en Inde, parce qu’une histoire de cuisine, pourrait être l’objet de cet ouvrage. Oui, mais pas seulement. Il est aussi question d’une Inde qui change, puissance émergente dira t-on, en tout cas, une Inde qui connaît de fortes mutations sociales et économiques, bousculant les règles établies, modifiant les comportements. Le géographe trouvera tout intérêt à s’ouvrir à des champs de recherche qui humanisent les espaces, les pôles et les réseaux. Et le terrain des habitudes alimentaires ou des pratiques autour de la nourriture, comme celui du travail, est un terrain très riche, surtout en Inde où chaque groupe social obéit à des comportements spécifiques. Mais de moins en moins, c’est ce que cet ouvrage s’efforce de montrer.
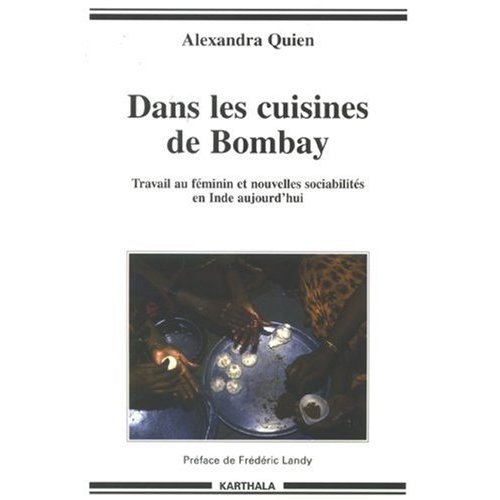
L’ouvrage est issu d’une thèse de 3ème cycle en anthropologie. Il en reste quelques lourdeurs de forme comme la description détaillée (fonctionnement, insertion dans le quartier, bâtiment et équipements) des trois entreprises de restauration collective de Bombay.
Leur vocation est double : d’abord produire des repas pour les centaines de Bombaykars qui ne rentrent pas chez eux pour manger. Face aux exigences de l’urbanisation dans cette ville de plus de 16 millions d’habitants, la cuisine hors-foyer a pris de l’ampleur. Ces entreprises commercialisent ainsi des centaines de plats (repas complets ou thali, snacks…) à partir de recettes populaires et bon marché (dal, chapati, puran poli..) ou de plats-nouvelle cuisine plus onéreux, ou de spécialités parsies, indiennes, chinoises. Production artisanale, réponse personnalisée, livraison… un compromis entre le fast-food et le repas confectionné à la maison.
La deuxième vocation de ces entreprises est d’offrir un emploi à des centaines de femmes : elles ont donc un rôle caritatif et d’utilité publique, mais sont concurrencées par des structures commerciales mieux équipées, employant d’abord des hommes, entreprises à gros budget qui se sont développées avec l’essor de l’industrie agroalimentaire depuis 1991. Les trois univers de travail étudiés sont donc presque exclusivement des univers féminins, et de plus, trois structures dirigées par des femmes.
Les portraits de femmes présentés dans cet ouvrage traduisent l’enquête minutieuse et les entretiens de l’anthropologue soucieuse de dire les réalités et les évolutions.
On y découvre une catégorie de responsables d’entreprises qu’il serait plus judicieux de qualifier de travailleuses sociales, voire de militantes sociales. Elles sont toutes éduquées, parlent l’anglais, sont issues d’un milieu de commerçants ou petits fonctionnaires, ont des époux cadres supérieurs, directeurs d’entreprise, avec parfois des responsabilités politiques ; femmes au foyer, elles sont devenues membres d’une association pour accéder à une vie sociale et défendent de ce fait l’éducation des femmes et le travail, certaines remettant en cause les quotas : « Nous ne devrions pas demander mais prouver. Je ne crois pas en la mendicité » dit Vandana.
Les employées sont issues de milieu défavorisé ; leur portrait décrit leur parcours, du village au bidonville ou au chawl (logement ouvrier), leurs difficultés quotidiennes, leur environnement de vie, et leur envie de s’en sortir. Leur témoignage montre combien ce travail a pu changer leur vie : « La famille de mon mari était très conservatrice et je me sentais toujours opprimée. Mais quand j’ai commencé à travailler, j’ai senti que j’étais capable de quelque chose ».
Parallèlement, les conditions de travail doivent répondre à certains impératifs pour ne pas trop compromettre le statut social des femmes : les femmes de basse caste sont restées attachées à une représentation traditionnelle du rôle de la femme, préférant ne pas travailler si elles le pouvaient ; les employées parsies n’ont pas d’inhibition à travailler car leur communauté valorise l’activité professionnelle. Toutes cependant apprécient la rupture de l’isolement en sortant de la sphère domestique.
Bien plus, les principes hiérarchiques, le statut rituel, l’appartenance communautaire sont souvent bousculés.
Ainsi, la répartition des taches se fait de plus en plus selon le niveau de compétence ou d’instruction et non plus autant sur des critères d’appartenance à la caste. A l’institut parsi, des hindoues étaient employées pour accomplir des tâches ingrates : laver les sols ou broyer les épices qui peuvent irriter la peau, les yeux. Elles ont peu à peu pris des tâches accomplies par les parsies (couper les légumes, servir les snacks) et les gestes impurs comme vider les volailles font l’objet d’un roulement.
Autre exemple lié aux périodes de menstruation où les femmes sont rituellement interdites de cuisine. On observe aussi des évolutions : la direction ne manifeste pas de réticence pour que les femmes travaillent dans ces moments ce qui n’étaient pas le cas des employées au début. Puis, elles ont accepté de cuisiner mais que pour les clients, pas pour les employées. « Je cuisine parce que je n‘ai pas le choix, mais je ne me sens pas à l’aise ». La distinction entre conviction personnelle et obligation professionnelle permet cette évolution, même si les menstruations demeurent synonymes de souillure, et à la maison, la tradition est respectée.
Les nouvelles exigences professionnelles dans une ville comme Bombay ne sont plus soumises comme avant aux contraintes habituelles et favorisent de nouvelles sociabilités : dans la majorité des cas, les plats préparés par des personnes de caste inférieure ne sont pas perçus comme pollués ; les principes de pur et impur qui régissent les rapports humains sont donc largement revisités, ce qui révèle un repli de la religiosité dans l’espace privé.
D’autres mutations sont observées.
Le repas en Inde a longtemps été codifié par des rites religieux et/ou sociaux. Horaires, fréquence, cuit et cru, chaud et froid… autant d’éléments obéissant à des usages normalisés. Chaque met a une place spécifique sur le thali (plateau), le riz en haut, les légumes frits en bas, les puri et le dal à gauche, les chutney à droite… L’habitude est de deux repas par jour…
L’auteur explique ces usages en rappelant les textes normatifs hindous qui font de chaque nourriture une métaphore du cosmos, un lien entre les hommes et les dieux. Et bien sûr, chaque caste a un degré de pureté rituelle à respecter.
Les rituels laissent aujourd’hui place à des considérations nouvelles.
Ainsi, la pratique du jeûne peut se référer encore à un calendrier rituel pour les employées issues de milieux très populaires ; mais elle peut être interdite chez les parsis qui la considèrent comme excessive.
Les interdits alimentaires subsistent mais le personnel observé dans les 3 entreprises disent transgresser certains interdits, pour des raisons sociales (« il est mal venu de refuser des mets avec du ghi – beurre clarifié – quand ils sont offerts avec l’intention de faire plaisir »).
Globalement, on peut observer une forme de sécularisation de la nourriture : la tradition n’est plus la seule référence et de nouvelles valeurs et pratiques sociales émergent, établissant de nouvelles normes de civilité et sociabilité. La notion d’hygiène se substitue à celle de pureté : la nourriture obéit encore aux notions de pur et impur mais en terme d’hygiène, et du coup, les différences de pratiques liées aux castes ou à la religion tendent à s’effacer, très progressivement (« Depuis que je travaille, j’accepte de la nourriture de tout le monde, même des Maratha. Mais je ne l’accepterais pas des musulmans, des chrétiens et des parsis ». ).
L’auteur commente cette évolution en la traduisant par le concept d’hindouité (cher aux nationalistes hindous) : un phénomène où l’hindouisme se transforme en ciment identitaire où les castes perdent de leur force de référence ; la religion est ainsi intrumentalisée mais favorise une forme de sécularisation de la société indienne (effacement des castes au profit d’une catégorie plus vaste).
De même, le végétarisme, associé à un idéal brahmanique de respect du vivant, est apprécié différemment. C’est plus un choix individuel qu’un choix sociétal. Et il tend à se substituer à un végétarisme occidental (le « manger léger » ou « manger naturel »). Par ailleurs, depuis quelques années, on observe un goût de plus en plus prononcé pour la consommation de viande. Certains parlent de dalitisation ( du mot dalit qui désigne les intouchables, les hors-castes situés au bas de l’échelle sociale, mais qui ont franchi quelques étapes dans le processus de démocratisation de la société indienne) : un mot pour dénoncer la présence de plus en plus visible des dalits dans la société et sa conséquence sur les habitudes alimentaires. Il s’agit plus sérieusement d’une conséquence normale de la hausse du niveau de vie pour une catégorie de la population, associée depuis 1991 à une ouverture de l’Inde au marché mondial qui modifie les comportements et le rapport à la viande, rapport rituel mais aussi économique !
De même, l’introduction de plats occidentaux, pâtisseries par exemple, sont signe non seulement d’une ouverture des habitudes alimentaires mais aussi d’une position sociale plutôt élevée.
D’une autre façon, les modifications des comportements alimentaires peuvent être liées à un contexte local particulier. Ainsi, l’une des entreprises étudiées s’inscrit dans le programme alimentaire Zhunka Bhakar lancé en 1995 par le gouvernement du Maharastra contrôlé alors par une coalition du Shiv Sena, (mouvement nationaliste et communautariste hindou) : ce programme est avant tout guidé par des considérations politiques plus que sociales, et vise à promouvoir un plat régional d’origine rurale (une galette de millet – bhakar – accompagné d’une sauce à base de pois chiche – zhunka). L’entreprise de Griha Maitri dont l’époux fait partie de la mouvance Shiv Sena, tient à offrir des plats nourrissants, généreux, qui correspondent à un modèle esthétique de personne enrobée laissant entrevoir quelques bourrelets sortant du sari, signe d’aisance matérielle et de bonne santé.
La nourriture traduit ainsi les changements qui marquent l’Inde aujourd’hui, entre repli sur soi, enracinement et défense identitaire, et uniformisation, voire occidentalisation, en tout cas changements liés au double processus d’urbanisation et de mondialisation.
La nourriture n’est plus, dans un milieu urbanisé, le reflet d’un statut rituel ; elle n’impose plus vraiment une séparation entre les groupes de la société indienne, entre castes mais elle continue à dire des inégalités… selon des critères économiques. Cette analyse, très intéressante et très vivante, des modèles de consommation, montre que les références identitaires sont multiples : caste, classe, ethnie, religion, localité, éducation… et que tout cela tend à se recomposer, la caste n’étant plus le référent déterminant.
C’est Frédéric Landy, géographe, qui préface cet ouvrage : une façon de dire combien nos sciences humaines sont complémentaires.
S’intéresser à l’anthropologie de l’alimentation indienne montre que l’Inde éternelle est capable de dynamismes et d’adaptation : les modes de consommation et leurs évolutions disent les rapports nouveaux entre habitudes et nouveautés (tradition ou modernité). Porter un regard sur les femmes indiennes dans ces trois entreprises de restauration valorise la place de plus en plus importante des femmes dans la société civile.
On regrettera que l’intérêt que porte la chercheuse à la photographie ne soit pas plus présent : quelques images illustrent la préparation traditionnelle des plats, les accessoires utilisés, les thali (plats) de fête…
Images un peu anciennes (années 90).
Le Mumbai d’aujourd’hui est une mégapole moderne qui détruit ses bidonvilles et se mue en métropole moderne et ouverte à toutes les influences et où « l’on ne manque pas de forces vives et de dynamiques pour éviter de copier servilement des modèles venus de l’étranger».